Il n’est plus à prouver qu’arte est la chaîne de la curiosité téléphagique, et ce sera une fois de plus démontré avec la diffusion ce soir de l’intégrale de Little Bird, une série canadienne dont j’avais eu l’occasion de vous parler brièvement à l’occasion de Series Mania l’an dernier. Little Bird n’a pourtant pas un sujet facile, ni même très connu en France, puisque la série s’intéresse au vol légalisé d’enfants indigènes.
L’intrigue de Little Bird trouve son origine en 1968 dans la réserve de Long Pine, dans le Saskatchewan, près de la ville de Regina, lorsqu’un jour, les services sociaux interviennent pour une broutille, et retirent la garde des enfants d’une famille tranquille. Mais l’essentiel de l’intrigue, en revanche, se produit dix huit années plus tard soit en 1985, lorsqu’Esther, étudiante en Droit adoptée par une famille juive de Montréal, se retrouve confrontée au racisme de sa future belle-famille, qui la propulse dans une quête de vérité sur ses origines.

Esther n’avait que 5 ans lorsqu’elle a été adoptée ; ses souvenirs de l’époque où elle s’appelait encore Bezhig sont confus et lointains. En outre, sa mère adoptive l’a découragée de poser trop de questions (ses parents adoptifs étant divorcés, c’est essentiellement cette relation qui sera explorée par la série). Sa vie s’est poursuivie dans la communauté juive de Montréal, où elle s’est liée d’amitié dans l’enfance avec David, le fils d’une autre famille juive aisée, et qui désormais, à 23 ans, est son fiancé. Tout semble avoir tourné pour le mieux : elle, future avocate ; lui, jeune interne en médecine… Mais le jour de leurs fiançailles, Esther entend par hasard une conversation dans laquelle la mère de David tient des propos d’un racisme extrêmement violent. Blessée, Esther décide de quitter la fête, et le lendemain, sur un coup de tête, elle part pour le Saskatchewan, seule piste qu’elle possède sur ses origines.
Rien de plus naturel. Ce que la mère de David a souligné par ses propos dégueulasses, ne pensant être entendue que par des personnes qui lui ressemblent, c’est qu’Esther n’est pas exactement à sa place dans la communauté de juive de Montréal. Or, ce que la jeune femme réalise, c’est qu’elle veut ça, elle aussi. Elle le veut comme elle ne l’a jamais voulu avant. Elle veut être parmi les siens. Elle veut être chez elle.
Little Bird suit cette quête, en même temps qu’elle procède à de nombreux retours dans les années 60, nous dévoilant comment les choses se sont précisément passées pour sa famille.
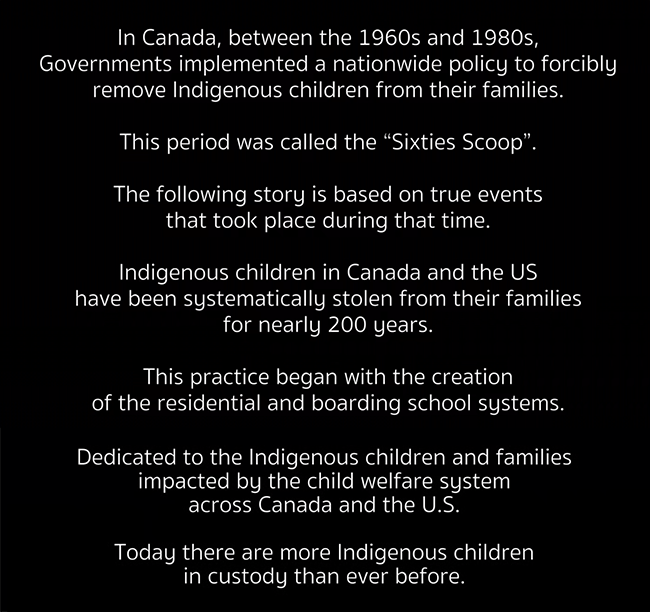 Des détails dont beaucoup seront perdus pour Esther/Bezhig, mais auxquels la série nous donne accès parce qu’il ne s’agit pas d’individualiser l’histoire de son héroïne, mais bien de l’employer pour nous donner une leçon d’Histoire comme les livres en produisent peu. Et une Histoire encore récente, voire même d’actualité. En effet, au Canada, selon les chiffres les plus récents, les enfants indigènes ne représentent que 7,7% des enfants du pays… mais 53,8% des mineures placées. C’est dire si l’histoire de Little Bird n’est pas qu’une oeuvre à vocation historique : ses effets sont toujours palpables dans les communautés autochtones. Parler de l’Histoire, c’est donc parler d’une continuité. Aujourd’hui encore, les First Nations se battent toujours contre les services sociaux coloniaux. Des histoires comme celle de Bezhig continuent de s’écrire.
Des détails dont beaucoup seront perdus pour Esther/Bezhig, mais auxquels la série nous donne accès parce qu’il ne s’agit pas d’individualiser l’histoire de son héroïne, mais bien de l’employer pour nous donner une leçon d’Histoire comme les livres en produisent peu. Et une Histoire encore récente, voire même d’actualité. En effet, au Canada, selon les chiffres les plus récents, les enfants indigènes ne représentent que 7,7% des enfants du pays… mais 53,8% des mineures placées. C’est dire si l’histoire de Little Bird n’est pas qu’une oeuvre à vocation historique : ses effets sont toujours palpables dans les communautés autochtones. Parler de l’Histoire, c’est donc parler d’une continuité. Aujourd’hui encore, les First Nations se battent toujours contre les services sociaux coloniaux. Des histoires comme celle de Bezhig continuent de s’écrire.
En 1968, à partir du moment où un incident attire l’attention des autorités sur la famille (la police d’abord, puis les services sociaux contactés par elle, tout ça en une seule journée), il est clair que toute parole, tout comportement, toute émotion y compris parfaitement légitime, sont prêtes à être pathologisées et criminalisées. Lorsque les assistantes sociales interviennent ce jour-là, les choses vont aller très vite ; Patricia, la mère, qui est seule à la maison avec les trois plus jeunes enfants, est rapidement prise à partie. Sa terreur puis sa colère face à la situation (qui est son pire cauchemar devenu réalité) sont utilisées comme des preuves de son incapacité à s’occuper de ses enfants. Les trois petites lui sont immédiatement retirées, et elle est même menotée à sa cuisine. Lorsque le père, Morris, revient en fin de journée avec son fils ainé Leo dans la voiture, les enfants sont déjà loin ; son indignation face au traitement de sa famille, et sa colère face à la violence vécue, sont là encore reçues par les policiers présents comme un comportement déviant. Il est immédiatement roué de coups et embarqué… il finira sa vie à l’hôpital peu de temps après. Pendant ce temps, désemparée, Patricia essaie en vain de retrouver la garde des trois enfants enlevées ; mais tout ce qu’elle fait et dit, si tant est qu’on lui donne la parole, est utilisé contre elle. Quand le jugement de garde a lieu, les enfants sont déjà bien loin. Le message est clair : une fois que le système a mis la main sur vous, il ne vous lâchera plus…
A cette violence initiale, d’autant plus insensée qu’elle découle directement du traitement des populations indigènes (comme par exemple leur reprocher leurs conditions de vie quand il n’y a ni l’eau ni l’électricité dans la réserve), s’en ajoute donc une autre, plus lente, au fil des années. Bezhig en fait les frais : tout est fait pour gommer son identité et détruire son appartenance, de près ou de loin. Le choix par les services sociaux des Rosenberg comme famille adoptante est parlant : elles habitent à l’autre bout du pays, sont d’une autre religion, etc. Au moment où elle commence à passer du temps à Regina pour essayer de remonter la trace de sa propre histoire, la jeune femme rencontre sur un parking un certain Cliff, un inconnu avec lequel elle échange quelques mots amicaux ; dans ses propres paroles, Bezhig qui trahit qu’elle parle des First Nations comme d’une altérité, pas d’un groupe auquel elle appartient. Et qu’elle n’a, évidemment, pas les codes de sa propre culture (ne comprend pas la question de Cliff, « where are you from ?« , comme une marque d’appartenance tribale par exemple ; ou elle parle de costume que la fille de Cliff porte pour un pow wow). Tout lui a été volé. Il s’avère également que le certificat de naissance de Bezhig a été modifié après son adoption, coupant son lien avec sa famille en plus de changer son nom. Devenue Esther, elle n’a jamais appris la langue de sa communauté Ojibwe, ou même… la prononciation de « Bezhig ». Imaginez qu’on vous prenne jusqu’à la capacité de prononcer votre propre nom ! Lorsqu’elle prend la mesure de tout ce qui lui a été confisqué, Bezhig va d’ailleurs s’indigner : « You can’t just stick a new name on a person and pretend that nothing happened« .
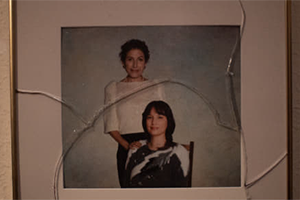 Toutefois, le propos de Little Bird est très clair : si cette violence est systémique, elle n’est pas anonyme. En fait la série est très intéressée par le rôle que jouent les protagonistes non-indigènes dans le drame vécu par la famille de Bezhig Little Bird. La déshumanisation fait ce système, mais ce système est porté, protégé et perpétué par les protagonistes telles que les flics (trop heureux de frapper le père Morris) ou les assistantes sociales. Il y a un moment terrible pendant lequel une assistante sociale plus expérimentée (et la plus sévère, aussi) explique à sa jeune consoeur qui hésite à démissionner : « You have to think to yourself, I’m saving these children from a life of poverty. You know, the best thing to do at the end of a long day is do what men do. Go home, kiss that handsome husband of yours, or better still, wrap your legs around him, pour yourself a drink, kick your feet up, and watch something on television. Not the news. You know, something funny. And try not to think about the office too much, okay ?« . Se répéter qu’on a raison, ne surtout pas s’interroger, balayer d’un geste la vérité de ce que l’on voit et de ce que l’on fait pour éviter de remettre en question notre responsabilité… Little Bird insiste sur ce point parce que c’est bien beau de dire que dans l’abstraction, des choses atroces ont été infligées à des générations d’autochtones, mais par qui ? Qu’est-ce qui motivait ces personnes à effacer tant ? Qu’est-ce qui leur permettait de se regarder dans le miroir tout en continuant d’arracher des enfants à leur mère ? …Qu’est-ce qui les autorisait à adopter les enfants d’autrui, sous couvert de quels mensonges, aussi ? Little Bird aura quelques mots choisis pour la mère adoptive de Bezhig ; l’adoption transraciale est, après tout, au coeur de son intrigue.
Toutefois, le propos de Little Bird est très clair : si cette violence est systémique, elle n’est pas anonyme. En fait la série est très intéressée par le rôle que jouent les protagonistes non-indigènes dans le drame vécu par la famille de Bezhig Little Bird. La déshumanisation fait ce système, mais ce système est porté, protégé et perpétué par les protagonistes telles que les flics (trop heureux de frapper le père Morris) ou les assistantes sociales. Il y a un moment terrible pendant lequel une assistante sociale plus expérimentée (et la plus sévère, aussi) explique à sa jeune consoeur qui hésite à démissionner : « You have to think to yourself, I’m saving these children from a life of poverty. You know, the best thing to do at the end of a long day is do what men do. Go home, kiss that handsome husband of yours, or better still, wrap your legs around him, pour yourself a drink, kick your feet up, and watch something on television. Not the news. You know, something funny. And try not to think about the office too much, okay ?« . Se répéter qu’on a raison, ne surtout pas s’interroger, balayer d’un geste la vérité de ce que l’on voit et de ce que l’on fait pour éviter de remettre en question notre responsabilité… Little Bird insiste sur ce point parce que c’est bien beau de dire que dans l’abstraction, des choses atroces ont été infligées à des générations d’autochtones, mais par qui ? Qu’est-ce qui motivait ces personnes à effacer tant ? Qu’est-ce qui leur permettait de se regarder dans le miroir tout en continuant d’arracher des enfants à leur mère ? …Qu’est-ce qui les autorisait à adopter les enfants d’autrui, sous couvert de quels mensonges, aussi ? Little Bird aura quelques mots choisis pour la mère adoptive de Bezhig ; l’adoption transraciale est, après tout, au coeur de son intrigue.
Little Bird est l’occasion progressivement pour Bezhig de lever le voile sur une partie de son passé. Jamais tout : il est des choses qu’on ne peut pas restituer, et même pas reconstituer. Mais sa tenacité paie à plusieurs reprises, aidée par un peu de chance. Elle trouve ainsi la trace de sa jeune soeur, Dora (« The whole time I was like ‘I know I have a sister somewhere’, I didn’t know if I was making it up« ), ce qui permet à la série de parler d’autres trajectoires. Puis Bezhig va se mettre en quête de réponses sur l’aîné de sa fratrie, Leo, et sur ce qui a pu arriver à son frère Niizh… Tout le monde dans la famille de Bezhig n’a en effet pas connu le même sort qu’elle. Se pose au travers des parcours de chacune la question de la vulnérabilité des enfants adoptées, notamment dans les adoptions transraciales (vulnérabilité aux abus, notamment, mais aussi à la difficulté d’être crue plutôt que les enfants biologiques), celle des traumatismes avec lesquels vivent les parents indigènes ayant vu leur famille fracturée par les autorités blanches, celle des destinées qui semblent s’inscrire dans les stéréotypes, d’être blamée pour les schémas que l’on reproduit faute de choix… Beaucoup de souffrance est mise au jour par les recherches de Bezhig sur sa famille. Et encore, elles n’ont pas fait l’expérience des pensionnats pour enfant autochtones ; c’est en revanche le sujet d’une autre série, Pour toi Flora, dont je vous propose du coup une review ici.
Pendant tout ce temps, Little Bird multiplie les parallèles entre 1968 et 1985, les protagonistes des deux époques fréquentant plusieurs fois les mêmes lieux à dix huit années d’écart. Les unes au pire moment de leur vie, les autres essayant de comprendre ce qui s’est passé à ce moment-là. C’est comme si elles passaient les unes à côté des autres, sans pouvoir se voir. Les réponses nous sont données, mais restent insaisissables à Bezhig…
C’est un long, poignant parcours que celui qui consiste à revenir en arrière et fouiller méticuleusement dans chaque plaie. A mesure que la série avance, les spectatrices réalisent que cette quête de vérité détruit autant qu’elle construit : on ne rouvre pas si facilement les portes de la mémoire. Pas quand ce qui se cache derrière est aussi douloureux. Et pourtant, que pourrait-elle faire d’autre ? Revenir sur ce qui fait mal lui permet, paradoxalement, d’avancer. Explorer cette douleur l’autorise à envisager d’aller de l’avant, cette fois avec TOUTE la vérité.
Malgré sa brièveté, Little Bird n’oublie pas de parler de la façon dont Bezhig peut se réparer. Comment cette quête lui permet, grâce à certaines réponses, de renouer avec ses origines, et de se trouver accueillie par sa communauté. De la même façon que Cliff lui dit avec tendresse qu’il dansera pour elle au pow wow, Bezhig trouve de l’hospitalité, de coeur et de fait, dans une communauté dont progressivement elle apprend la culture. Sa culture. Tout ne sera pas effacé. Tout ne sera pas résolu. Certaines plaies seront même neuves ; trouver les siens c’est désormais avoir plus à perdre. Mais Little Bird veut finir sur une note d’espoir, pour toutes les petites filles indigènes qui veulent rentrer chez elles.






