« La nourriture n’a-t-elle pas meilleur goût quand on la partage ? »
Ce qui est vrai d’un bon petit plat l’est autant d’une œuvre artistique. Comme, par exemple, une série, aussi je ne pourrais être plus ravie de vous parler de Maiko-san Chi no Makanai-san, la première série japonaise de Netflix pour 2023. Elle est apparue cette semaine sur la plateforme, sous le titre international de The Makanai: Cooking for the Maiko House (mais pas en France où on a préféré Makanai, dans la cuisine des maiko), et on la doit entre autres à Hirokazu Koreeda, qui a co-écrit, co-réalisé et co-produit la série.
On se retrouve, le temps de 9 petits épisodes, transportées à Kyoto, plus précisément dans le quarter traditionnel de Gion. C’est là que subsistent quelques unes des dernières yakata du pays, ces maisons où l’on abrite et forme les geiko (à Kyoto, on emploie ce terme plutôt que geisha) de demain. Même si au 21e siècle, l’âge d’or du métier est désormais derrière lui, il reste encore des jeunes filles pour rejoindre ces établissements aux rites centenaires, afin de maintenir en vie une tradition artistique qui autrement serait à bout de souffle.
Deux adolescentes de 16 ans, Kiyo et Sumire, font justement ce choix dans Maiko-san Chi no Makanai-san ; les deux amies ont quitté leur ville natale d’Aomori, dans le nord du pays, pour venir à Kyoto ensemble et rejoindre une yakata du nom de Saku. Le parcours qui s’annonce pour elles à partir de là sera long. D’abord, elles s’occuperont de maintenir la yakata tout en prenant des cours traditionnels, le temps se familiariser avec leur nouveau milieu ; puis elles deviendront maiko, c’est-à-dire apprenties, et commenceront à faire des représentations devant un public ; plus tard, elle accèderont, enfin, au statut de geiko.
Ou, disons que c’est l’une des possibilités.
Car très vite il apparaît que, si Sumire se révèle prometteuse, Kiyo, elle, n’est pas franchement douée, que ce soit pour l’ikebana, le niveau de langage, ou la mai, cette danse aux gestes mesurés et symboliques qui exige une précision impeccable. Les trois premiers mois passent (et, ce, dés le premier épisode) sans que l’adolescente ne parvienne à progresser.

L’environnement est très bienveillant à Saku, la maison étant tenue par une ancienne geiko au cœur tendre du nom d’Azusa, laquelle est secondée par la doyenne Chiyo qui lui a passé le relai il y a quelques années, mais vit toujours sur place entre autres pour former les jeunes recrues. Lorsque Sumire et Kiyo arrivent, la yakata abrite déjà trois maiko : Kikuno, Kotono, et Tsurukoma, qui certes sont légèrement plus âgées mais avec lesquelles les points communs ne manquent pas. Il faut aussi compter sur Ryouko, la fille qu’Azusa a eu lors d’un premier mariage et qui a aujourd’hui 17 ans, mais si elle vit sur place, elle suit une scolarité normale et n’est pas entrée dans le monde des geiko. Dans ce gynécée tentant de faire perdurer les traditions japonaises anciennes, on ne voudrait rien tant que voir Kiyo réussir. Mais il semblerait que cela ne relève pas du domaine du possible.
Alors que faire ? Après quelques courtes hésitations, Azusa réalise que le potentiel de Kiyo est ailleurs. D’une façon étonnamment naturelle, elle abandonne sa formation pour devenir makanai-san, c’est-à-dire la personne chargée du makanai (le repas de la maison, ou du personnel). Et elle y excelle !
Eh oui ! Je vous ai bien eue, en fait Maiko-san Chi no Makanai-san est une « série d’appétit » ! Je vous parle depuis des années, maintenant, de ce sous-genre dramatique typiquement japonais consistant à adosser une série à une exploration culinaire. Sauf que contrairement à beaucoup de ces séries (quoique pas toutes), Maiko-san Chi no Makanai-san est hautement feuilletonnante, reflétant le parcours initiatique de ses deux protagonistes centrales ; elle révèle cependant, dans les détours de son intrigue, un superpouvoir secret, celui d’être aussi un formidable ensemble drama.
Ce qui frappe instantanément dans la façon qu’a Kiyo de bifurquer vers la tenue de la cuisine de Saku, c’est combien ce choix n’est absolument pas un conflit. Elle ne le vit pas comme un échec ; en fait, son seul soucis, quand on lui annoncé qu’elle ne ferait jamais une bonne maiko, a été de s’imaginer séparée de Sumire. Du coup, cet emploi comme makanai-san est idéal, puisqu’il lui permet à la fois de briller par ses talents culinaires, qui s’avèrent précieux, et de rester aux côtés de son amie pendant que celle-ci poursuit son propre parcours dans la hiérarchie geiko. Pour Kiyo, ne pas devenir maiko n’est pas un échec. Quand Sumire réussit (et elle semble très bien partie !), cela ne crée aucune sorte de fossé. Il n’y a, à aucun moment, ni amertume ni jalousie, parce que Maiko-san Chi no Makanai-san n’est pas le genre de fictions qui s’intéresse à des émotions aussi basiques et soapesques. Et puis, Kiyo fait pleinement partie de la yakata, elle est une part importante de son fonctionnement, quand bien même elle est invisible pour le public, et ne sera jamais prise en photo par les touristes.
Grâce à cette situation apaisée, Maiko-san Chi no Makanai-san peut explorer la vie de la yakata Saku, et se glisser aux côtés de ces jeunes filles et femmes qui ont choisi un mode de vie si atypique.
Rappelons par exemple, même si théoriquement ce cliché devrait être mort et enterré maintenant, que les maiko et geiko, bien qu’oeuvrant en soirée dans des établissements nocturnes, ne sont pas des travailleuses du sexe. Ce sont des artistes, des interprètes, des personnalités publiques. Paradoxalement, ce vers quoi elles tendent, c’est être elles-mêmes ; les apprenties de Saku, et à sa façon, Kiyo aussi, sont là pour découvrir qui elles sont. Et le devenir, tout en devenant autre : s’impreigner des traditions de ce milieu, c’est se changer. Venues de tout le pays, les maiko et geiko parlent en effet en Kyoto-ben (ou dialecte de Kyoto), adoptent le vocabulaire spécifique de leur milieu, apprennent un maintien particulier, portent des vêtements et du maquillage traditionnels, apprennent à vivre avec un style capillaire peu adapté à la vie moderne… On y adopte même un nouveau nom ! C’est une performance particulière de la féminité qui passe par des artifices et des changements (qui rappelle un peu le drag par certains aspects), mais qui à terme garantissent un moyen d’expression artistique et intime. Pour ne pas dire politique, vu la façon dont les maiko et geiko doivent négocier leur rapport à une féminité moderne en accord avec les principes traditionnels qu’elles tentent très consciemment de préserver.
Devenir autre pour devenir soi. Or, on ne devient pas soi par dépit : trouver le bonheur est essentiel.
 Dans tout cela, Maiko-san Chi no Makanai-san s’assure d’un double-rôle pour la nourriture : veiller au bien-être des femmes qui vivent à la yakata, et offrir des opportunités de voir comment elles vivent, au quotidien, cette existence hors du commun.
Dans tout cela, Maiko-san Chi no Makanai-san s’assure d’un double-rôle pour la nourriture : veiller au bien-être des femmes qui vivent à la yakata, et offrir des opportunités de voir comment elles vivent, au quotidien, cette existence hors du commun.
Ce que fournit Kiyo dans ce contexte, c’est une cuisine quotidienne et populaire, pas de la nourriture haut de gamme qu’on associe avec l’image des geiko. Pourtant la qualité doit être là, et elle doit accomplir plus que nourrir les maiko : elle doit les aider dans les coups durs, les accompagner dans les moments de joie, les rassembler autour d’une même table… C’est un art intime par essence, celui que de rester attentive aux besoins de chacune. Dans le premier épisode, Kiyo apprend d’ailleurs une grande leçon : il faut faire plaisir à tout le monde, malgré les origines et préférences variées, pour que chacune trouve dans la nourriture sa comfort food idéale. A partir de là, Kiyo développe (ou avait peut-être un terrain favorable qui peut à présent s’épanouir) un talent pour sentir le plat dont quelqu’un a besoin (c’est très similaire à l’idée que Shinya Shokudou se faisait, régulièrement, des plats que le Master décidait de cuisiner de lui-même, et qui finissaient par combler parfaitement le besoin d’une cliente avant même qu’elle ne passe la porte).
Faire en sorte que d’autres se sentent bien, c’est, en réalité, tout un art. L’excellence se juge ici au bonheur qu’apporte un plat ; et Kiyo trouve, justement, son propre bonheur en donnant du bonheur à d’autres.
Précisément, Maiko-san Chi no Makanai-san est une série sur l’art que l’on aime, et l’art que l’on donne. C’est le plaisir des plats que l’on prépare pour autrui… mais aussi pour soi, pour se sentir utile, pour se sentir soi-même. De la même façon qu’on prépare une performance de mai. Contrairement à la grande majorité des séries d’appétit, la nourriture est ici surtout montrée de près lors de la préparation ou du dressage, pas vraiment quand elle est mangée ; les plans se font alors plutôt lointains, la scène s’intéressant alors surtout à la façon dont le plat est reçu et partagé. Maiko-san Chi no Makanai-san n’est pas une série qui veut nous faire ressentir le goût de chaque plat, elle veut nous faire ressentir le plaisir qu’on trouve à le voir apprécié par quelqu’un d’autre, et si possible, plusieurs personnes. Ces deux performances artistiques, en tant que makanai-san ou que maiko/geiko, n’existent que dans le moment présent, et n’existent que comme un don. On ne cuisine pas pour soi, et on ne danse pas pour soi. Ce sont des arts qui ont de l’influence sur les autres, même si l’effet est parfois imperceptible sur le moment (comme le démontrera tendrement l’épisode du Nouvel An).
Au-delà, la série est un commentaire sur le rapport intime que l’on entretient avec son art, quelle que soit la nature de celui-ci. « Tu peux tomber amoureuse de ton art, pas que d’un homme », dira la geiko la plus populaire de Kyoto à Sumire dans un épisode ; et l’expression de cet amour, c’est de partager cet art plutôt que de le garder pour soi. Si Kiyo continue d’être considérée comme une membre de la maison à titre égal avec l’apprentie Sumire ou les trois maiko de la maison, c’est justement parce que la série ne considère pas que le travail que l’on fait détermine qui l’on est. En revanche, qui l’on est détermine ce que l’on fait. Or, c’est cela qui détermine ce que l’on donne à d’autres. Ainsi, il importe de trouver la bonne place pour soi, qui nous correspond, dans le monde (ça se sent par exemple lorsque le père de Sumire vient en ville), parce que c’est ce qui nous permet à la fois de nous exprimer et de faire profiter à d’autres de notre talent. « On peut cuisiner, ou être la personne qui mange. On peut être la personne qui part ou celle qui reste. Et aucun de ces choix n’est meilleur ou pire que les autres », dira la grand’mère de Kiyo dans l’une des rares scènes nous rappelant que, à Aomori, sont restées quelques personnes chères qui ont donné d’elles-mêmes aux adolescentes pour qu’elles puissent un jour devenir des jeunes femmes pleins de talent. Cette conviction que chaque personne a sa place dans le monde, un art fut-il simple mais vital dans lequel briller, et des choses à apporter aux autres sans besoin de se mesurer (« tu n’as pas besoin d’être la meilleure »), c’est ça, qui anime Maiko-san Chi no Makanai-san.
L’atmosphère de Maiko-san Chi no Makanai-san est douce, chaleureuse, joyeuse. Les épisodes embaument votre vie comme un bon plat qui a mijoté des heures. Mais c’est tout de même un plat « exotique » pour beaucoup.
Dans cette maisonnée pas comme les autres, modernes mais configurée pour perpétuer des traditions menacées d’extinction (raison d’être des personnages, bien souvent), on vit dans un monde un peu à part. On n’a pas le droit de porter des lunettes lorsqu’on est en costume, il ne faut pas utiliser son portable (ou idéalement ne pas en avoir), on ne peut pas quitter la formation de maiko ou alors en étant certaine de ne pas y revenir, et on ne peut être à la fois geiko et mariée, et ainsi de suite. Or on a là des femmes qui, dans leur immense majorité, pensent que ces traditions doivent être maintenues (…même si elles ne s’opposeraient pas à quelques nuances de modernité à l’occasion), et qui dédient leur vie à faire perdurer ce système. Cela peut être étonnant.
En outre, la série se déroule presque totalement en Kyoto-ben (à l’exception bien-sûr des quelques scènes à Aomori, qui elles ont plutôt recours au Tsugaru-ben), fait appel à tout un vocabulaire très spécifique d’un univers méconnu, surtout qu’on nous en montre ici les coulisses. Seront donc nommés toutes sortes d’objets complètement inconnus au bataillon ici, et des rites qui le sont à peine plus. Ces éléments traditionnels, en un sens, sont la raison pour laquelle Netflix a commandé la série (c’est, comme beaucoup de séries d’appétit, l’adaptation d’un manga éponyme) : l’exotisme est encore, très souvent, un produit d’appel pour ses séries non-anglophones. Mais ce peut aussi être un frein considérable, comme si le style de Koreeda n’était déjà pas assez lointain des standards nord-américains ou européens…
…D’autant que c’est le moment où j’arrête mes compliments de façon brutale, et vous annonce que Maiko-san Chi no Makanai-san n’a bénéficié d’absolument aucun effort pour se montrer accessible à un public néophyte. J’ai regardé la série avec les sous-titres anglais (par habitude ; je ne sais pas si j’aurais été mieux servie avec les sous-titres français, vous me raconterez) et c’est un absolu carnage.
Plein de termes sont reproduits tels quels dans les sous-titres (quoique parfois avec des variations orthographiques parce qu’on n’a pas décidé de quelle romanisation on voulait se servir, et non, ce ne sera pas toujours Hepburn). Les mots tombent donc sans aucune explication. Alors, tout d’un coup on vous dit un mot et si vous ne savez pas ce que c’est, eh bah pas de bol (un jour il faudra vraiment qu’on parle de la tradition de l’explication culture dans les fansubs, parce que les plateformes ont des leçons à prendre de ce milieu). Un mot employé quotidiennement, comme « ookini » (du Kyoto-ben pour « arigatou« ) n’est jamais explicité, juste ponctuellement traduit directement, ou parfois livré tel quel ; on peut en induire le sens à force, mais pour quelqu’un qui regarde la série sans connaissance linguistique je ne suis pas sûre que ça donne particulièrement envie. Les dialectes sont en outre systématiquement effacés par la traduction, certains termes portant parfois une nuance dans une scène sans que les spectatrices non-nipponophones ne puissent y avoir droit.
Pire, il y a des passages qui sont, je ne vois pas d’autre explication, des aberrations dues à une traduction automatique ; par exemple « se no« , qui se dit pour faire un compte à rebours par exemple avant de prendre une photo, a été traduit en « say no« . Dire non à quoi, à la photo que toutes se sont réunies pour prendre ? D’où ? Pourquoi ? Beaucoup, beaucoup d’expressions idiomatiques deviennent ainsi, dans les sous-titres anglais, parfaitement idiotiques, en raison d’une improvisation totale au moment de l’adaptation. Il y a par exemple un simple « douzo, yoroshiku onegaishimasu » (dont l’équivalent en français serait « je vous en prie, je m’en remets à vous », formule de politesse quand on se place sous l’autorité de quelqu’un) qui devient tout d’un coup :
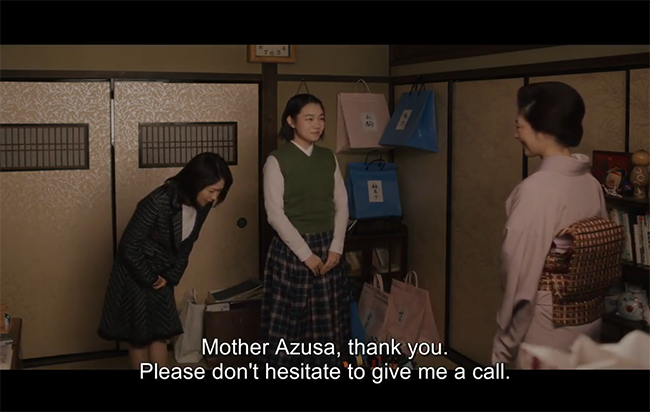
Hey, si vous vouliez écrire vos propres dialogues, fallait pas faire traductrice comme métier. Pour ce coup-là, on peut difficilement accabler Google Traduction…
Alors après, je comprends que, lorsqu’on n’a rien expliqué à personne avec la plus petite note de traduction, on a besoin de faire dire des choses aux personnages pour simplifier. A de nombreuses reprises, les sous-titres emploient par exemple le nom d’Azusa alors que quelqu’un vient de l’appeler « Okaasan » (« maman », en raison de sa position de matriarche), et sur le coup ça a du sens… jusqu’à ce que quelqu’un s’émeuve plus tard de toutes ces femmes qui s’appellent l’une l’autre par « maman » ou « sœur », alors qu’elles ne sont pas liées par le sang. Bah oui mais on n’a pas le temps de repasser sur les épisodes déjà traduits, Netflix a pas prévu dans la deadline ni le budget, alors tant pis. Pareil quand la série se pique d’utiliser le nom de naissance d’une protagoniste alors que c’est son nom de maiko qui a été employé (…on a beau avoir eu tout une scène juste avant sur l’importance de l’emploi d’un nom plutôt que l’autre, rien à faire). Il n’y a juste pas les moyens de faire un travail, je vais même pas dire décent, mais au moins cohérent.
Tout est à l’avenant. C’est rageant pour quelqu’un qui est habituée à ce que ses sous-titres aient un minimum de, euh, comment ça s’appelle déjà ? Oui : passion pour le sujet. Ou soucis de bien faire. Ou juste professionnalisme. Et je n’imagine pas à quel point ça doit être frustrant pour quelqu’un qui n’a pas les références de regarder une série et de n’en comprendre que la moitié. Des incohérences comme ça, ça donne l’impression que c’est la faute de la série, quand on n’a pas le bagage linguistique pour on ne peut pas l’inventer.
Comment vous voulez inciter les gens à sortir de leur zone de confort et tenter des perles comme Maiko-san Chi no Makanai-san, de la jolie slow TV sans retournement de situation à couper le souffle ni même vraiment de conflit externe… quand on voit la façon dont sont malmenées les personnes curieuses qui voudraient la regarder ? Le mépris de Netflix pour ses propres productions originales est un puits sans fond.
Alors qu’on a ici une oeuvre délicate, elle est passée au rouleau compresseur sans aucune forme d’égards pour sa forme… ou son fond. Parce que Maiko-san Chi no Makanai-san est une touchante lettre ouverte d’un artiste sur son rapport à l’art, son amour pour celui-ci, les sacrifices consentis et même embrassés à pleine bouche en son nom, et son désir de partager, autant que possible, avec autrui, cet amour et son expression. Le partage est gâché par une plateforme qui n’en a cure, et se soucie uniquement du temps que vous allez passer devant les épisodes pendant ses premiers jours de mise en ligne. Pour le reste, il ne faut pas compter sur Netflix.
Alors je compte sur vous.










C’est terrible parce que j’ai super envie de commenter la partie sur la traduction, qui me touche personnellement, mais je ne peux pas, parce que ce serait discuter publiquement de mon travail, et c’est quelque chose que j’essaie de ne jamais faire… la frustration est réelle >_<
Désolée. u_u J’avais pas réfléchi que ça te donnerait ce genre de dilemme.
Et pour être claire j’accable plus Netflix que les traductrices ici (quoique quand même sur certains trucs, genre inventer un coup de fil dans une phrase qui n’en fait pas mention pour une intrigue qui n’en fera jamais usage, ça j’ai eu du mal), parce qu’on sait bien que c’est un problème de délais et de financement de la traduction/des sous-titres. Netflix, d’une façon générale, n’en a rien à foutre de la qualité du produit fini. Même pour un réalisateur pourtant mondialement connu comme Koreeda.
I’m mad that this uploaded on the platform the day after my subscription ended ?
Oh well, I’ll save it for when/if I re-subscribe ?
Well there are ways…