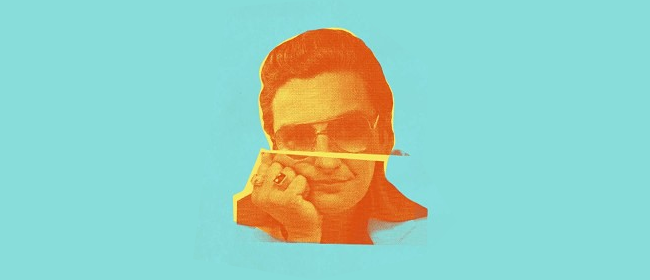On ne peut pas dire que vous avez manqué de lecture, ces dernières semaines ! J’ai fait mon possible pour vous parler de plein de séries d’horizons différents et… devinez quoi ? Il m’en reste. Je vous le mets ? Bah écoutez, ça tombe bien, c’est ce à quoi servent les articles Take Five !
Voici donc 5 séries que j’ai vues ce mois-ci et qui n’ont pas eu droit à leur propre review de « pilote« . Pour certains, vous allez vite découvrir que ce n’est pas passé loin : j’ai eu des choses à en dire, c’est simplement que j’ai manqué de temps (ou parfois, d’énergie) pour les aborder. L’une de ces séries peut aussi, si le reste de sa saison est à la hauteur, potentiellement décrocher une review plus longue d’ici quelques temps. Bref, il y a toujours plein de raisons pour lesquelles le Take Five est salvateur. Je vous laisse faire votre marché dans les reviews d’octobre, vous y trouverez peut-être une perle à découvrir vous-même… ou pour laquelle faire du lobby dans l’espoir que je lui consacre un peu plus que quelques paragraphes.

 66-5 (2023)
66-5 (2023)

L’autre série de Canal+ cet automne, c’était 66-5, qui a moins fait parler d’elle… et à mon sens c’est une erreur. Pour grossir le trait, 66-5 c’est The Good Wife si The Good Wife avait eu l’ombre d’une conscience de classe. Le premier épisode est déjà plein à craquer d’enjeux, et laisse plus qu’entendre quelque chose d’encore plus complexe pour les suivants. L’héroïne de la série est Roxane Bauer, une jeune avocate encore verte, qui exerce au sein d’un prestigieux cabinet parisien. Le cabinet Bauer, cependant, est celui de son beau-père, et elle y travaille aux côtés de son mari, Samuel ; ce qui ne veut pas dire qu’elle n’est pas compétente, mais elle n’y est, en tout cas, pas juste à cause de ses qualités professionnelles. Lorsque Samuel est accusé de viol par une ancienne stagiaire, tout s’écroule… et les Bauer ont tôt fait de l’écarter afin de minimiser autant que possible les dégâts en matière d’image publique. Coïncidence scénaristique, Roxane est alors appelée dans sa ville natale de Bobigny pour des affaires familiales, mais ce faisant, croise la route de son amie d’enfance qui lui demande d’aider son compagnon ; celui-ci, en prison, voit son cas aggravé suite à une bête histoire de parloir. N’ayant pas grand’chose à faire, et se sentant obligée de rendre service à cette amie, voilà donc Roxane qui se retrouve, pour la première fois, à plaider… bien loin des procès auxquels elle se destinait initialement dans son cabinet parisien.
66-5 n’en a pas fini. La série veut aussi établir d’autres choses, comme les relations tendues de Roxane avec non seulement sa belle-famille mais aussi sa propre famille. Par petites touches, l’épisode met en lumière, en tout cas en partie, les raisons pour lesquelles la jeune femme a fait son possible pour prendre de la distance. Mais en filigrane, et c’est probablement ce qui sera le plus instrumental dans les développements ultérieurs de l’intrigue, 66-5 veut aussi raconter les toutes premières interactions de Roxane avec la Justice… lorsqu’elle était adolescente. Il y a un mille-feuilles de choses qui se trament ici, et tout cela est délivré sans lourdeur (hors celles inhérentes à un épisode d’exposition qui a besoin de faire tout ça de façon pédagogique tout en délivrant une intrigue judiciaire). Le portrait se dessine lentement de Roxane, une femme pétrie de contradictions et pourtant relativement cohérente avec elle-même, qui, comme le veut l’expression de circonstance, « n’a pas oublié d’où elle vient » mais déterminée à ne pas revenir en arrière. Pas de chance pour elle, elle va quand même le faire, réexaminer le passé, et peut-être même se confronter à son premier amour sous un jour nouveau. Les tourments qui entourent Samuel ne plaident pas pour autre chose. 66-5 est solide, son aspect legal drama tient la route parce qu’il repose sur une exploration des recoins les moins flatteurs du monde judiciaire plutôt que sur des effets rhétoriques, et le portrait qui s’annonce de son héroïne tient pour le moment plutôt bien la route. Le genre de série qui ne peut que bénéficier de se voir allouer un peu de temps pour prendre en maturité ; ce que France2 n’a pas fait pour Le Code (ni oubli, ni pardon), j’espère que Canal+ le fera pour 66-5. Ah, ça, on fait moins le buzz qu’une enquête à la David Simon, mais c’est pas une raison.
 Inspirez Expirez (2023)
Inspirez Expirez (2023)

Deux connaissances qui ne s’apprécient pas énormément l’une l’autre se retrouvent embarquées de force par leurs amies communes dans une retraite de yoga au fond des bois. Inspirez Expirez n’est, cependant, pas qu’une comédie sur ce tandem que tout sépare (quoique notez bien, elle l’est aussi), mais avant tout un thriller se déroulant dans un huis clos atypique. Car dans la retraite exclusivement féminine où les deux héroïnes se retrouvent, à peu près toutes les femmes ont une raison de se tenir à distance des hommes… et justement, l’épisode démarre alors que le cadavre d’un homme a été retrouvé !
La police interroge donc tout le monde, et c’est l’occasion pour Inspirez Expirez de nous expliquer un peu mieux le contexte. Rien de révolutionnaire dans cette structure, mais ça fonctionne, parce que déjà c’est une comédie, et surtout parce qu’on a tout de suite la sensation de pénétrer dans un Agatha Christie ayurvédique. Personnellement, je ne suis pas captivée par ce genre de série, mais il faut admettre que ça change des cozy mysteries qui à ce stade se ressemblent tous (de par leur nombre, principalement). Je ne sais pas trop pourquoi, mais ça m’a aussi un peu rappelé Série noire. Peut-être plus par association d’idées que parce qu’il y a réellement une parenté… En tout cas, si vous avez épuisé votre réserve d’épisodes d’Only Murders in the Building, c’est clairement par ici qu’il vous faut recentrer votre attention.
 Jiu Yi Ren (2023)
Jiu Yi Ren (2023)
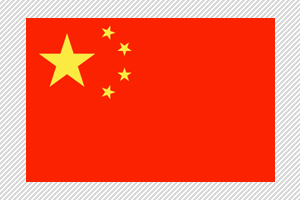
Ce qui avait commencé comme un banal test d’un premier épisode de série parmi tant d’autres pourrait bien se transformer en l’un de mes visionnages automnaux. Et pour une fois, c’est même pas la faute du poster. Jiu Yu Ren (ou Faithful de son titre international) est une série qui commence humblement en s’intéressant à Lin Ru Lan, une jeune fille qui a rejoint le palais impérial en tant qu’apprentie brodeuse. Avec son amie Meng Wan, un peu plus âgée qu’elle, elle vit un quotidien rempli de fils de soie au sein de l’atelier mené par un certain Wu Lian, Maître-brodeur employé par la puissante Madame Ning, l’une des concubines de l’Empereur. Même si sa vie n’est pas très excitante au regard des activités de la cour impériale, Ru Lan est relativement heureuse ; elle admire, en outre, le talent et la douceur du Maître Wu, un homme au tempérament calme que toutes les brodeuses adorent de loin. Tout bascule cependant lorsqu’une autre apprentie brodeuse décède dans des circonstances suspectes, qui intriguent toutes les apprenties, mais surtout Ru Lan. Jusque là rien d’incroyable, c’est même assez similaire au démarrage de l’intrigue de Yanxi Gonglue.
Ru Lan commence ce qui ne peut qu’être qualifié d’enquête informelle, ce que la série a le bon sens de ne pas traiter comme un ersatz de série policière, et dépeint au contraire comme une réaction naturelle pour une jeune fille sensible et menant une vie autrement très banale. De nature naïve et ingénue, mais curieuse et têtue, Ru Lan commence à se poser des questions, à défaut d’être dans une position qui lui autorise à en poser. Wan l’avertit de ne pas s’en mêler, mais c’est trop tard ! Ru Lan a commencé à entendre des « témoins », recouper des « données », relever des « preuves »… Jiu Yu Ren ne les présente pas explicitement comme telles, mais sans aucun doute possible, l’investigation bat son plein. Sauf que, là où ce premier épisode de Jiu Yu Ren fait vraiment un travail épatant, c’est dans sa chronique d’une innocence perdue. Cette enquête n’a pas pour but de simplement comprendre comme une brodeuse est tombée en pleine nuit au fond d’un puits. Cette enquête révèle une toute autre question, plus pertinente, plus complexe, plus intime aussi. Et vu les liens entre l’atelier de broderie et le reste de la cour impériale, ainsi que la rapidité avec laquelle certaines révélations sont faites dans ce premier épisode, on imagine aisément comment les implications pourraient nous mener très loin dans une série de deux douzaines d’épisodes. Jiu Yi Ren marque ici un très bon début qui augure d’excellentes choses pour la suite de son intrigue, grâce à une capacité à élargir son focus avec tact et les apparences de la légèreté. Non, vraiment, vraie bonne surprise de ce mois écoulé.
 Motel Valkirias (2023)
Motel Valkirias (2023)
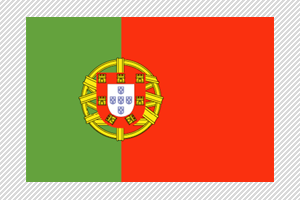

Trois femmes se trouvent à la frontière entre le Portugal et la Galicie, au même moment, dans la même chambre d’un motel pourri. Trois femmes dont la vie semblait sans espoir, sans personne sur qui compter. Trois femmes qui ne se connaissaient même pas quelques jours plus tôt. Trois femmes qui se trouvent soudainement au-dessus du cadavre d’un homme. L’exposition de Motel Valkirias est lente, et ça lui va bien. La série se dit ouvertement inspirée par les westerns, et ce sera peut-être vrai par la suite, mais elle m’a pour le moment plutôt évoqué une approche Southern gothic. Dans tous les cas, l’ambiance est impeccable, rien à redire. L’intrigue est, par conséquent, un peu moins intéressante pour le moment, et pour en arriver au cadavre, il faudra trois quarts d’heure de patience.
L’épisode a en plus l’intention d’introduire ces protagonistes très progressivement, commençant par Lucía, la chanteuse qui travaille dans un club de strip tease tout en élevant sa fille. Son ex, profondément jaloux, essaie de lui en retirer la garde, mais pas spécialement par affection pour la petite, juste à des fins de contrôle. Alors Lucía s’enfuit en pleine nuit, sa gamine sur la banquette arrière, et échoue dans cet hôtel quasiment désaffecté, le sus-mentionné Motel Valkirias. Celui-ci est tenu par Carolina, une vieille femme sur la paille qui est à deux doigts de perdre l’établissement, lequel est couvert de dettes. On comprend grâce à un échange qu’elle a perdu sa fille, qui a disparu il y a longtemps maintenant et dont elle continue d’espérer qu’elle réapparaîtra un jour. Le motel est son phare, et elle veut le garder à tout prix. Absolument tout prix. Quant à Eva, l’actrice dont la carrière est en train de flancher, elle est ce jour-là convoquée par son maître-chanteur dans une des chambres ; il lui réclame, une nouvelle fois, de l’argent qu’elle n’a pas. Désespérée, elle ne semble avoir plus rien à quoi s’accrocher…
Quel rôle vient cet homme jouer, pour qu’il devienne bientôt un cadavre ? Je m’en voudrais de trahir le suspense, mais cette histoire dépasse, en tout cas, et de loin, les murs de ce motel. Et augure d’une dramédie un peu folle qui va sûrement créer encore plus de problèmes à ces trois femmes avant qu’elles n’aient le moindre espoir de régler ceux qu’elles avaient déjà ! Co-production entre le Portugal et la Galacie, Motel Valkirias n’est pas la série la plus originale qu’il m’ait été donné de voir, mais ses intentions sont ailleurs, et ça fonctionne plutôt bien.
 Red Dwarf (1988)
Red Dwarf (1988)

Je suis bien consciente que ça n’en a pas toujours l’air, mais je regarde aussi des séries plus anciennes, pour ma culture. En l’occurrence, je n’avais jamais jeté un œil à Red Dwarf, alors qu’il s’agit d’une série de science-fiction qui, bon an mal an, existe au total depuis 35 années. C’est pas Doctor Who, mais ce n’est quand même pas rien. Étant en outre peu versée en comédies britanniques (dont je partage rarement le style humoristique), Red Dwarf constituait pour moi un gros angle mort. Et donc, voilà comment on en est arrivées là ce mois-ci.
Le premier épisode (non sans ironie nommé « The End ») est celui plutôt d’un sitcom se déroulant dans un milieu professionnel que d’une série de SF pur jus ; on y suit Dave Lister, un tir-au-flanc jovial qui a de grands rêves et une petite motivation à les réaliser. Il travaille sur un navire minier appelé le Red Dwarf, et j’emploie vraiment le terme « travaille » de façon très généreuse ici. Naturellement, il partage sa chambre avec un employé qui est tout son contraire : Arnold Judas Rimmer, un technicien ambitieux mais qui hélas, malgré tous ses efforts et son attitude de premier de la classe, n’arrive jamais à s’élever. Cela s’illustre dans ce premier épisode lorsque Rimmer tente de passer le concours d’ingénieur, et qu’en plus d’être un piètre tricheur, il s’évanouit dans la salle d’examen. Bref, ils sont tous les deux aussi nuls l’un que l’autre. A la suite d’une énième bévue, puisque Lister cache un chat domestique sur le vaisseau mais qu’il est suffisamment con pour se prendre en photo et la faire développer au labo du Red Dwarf, notre héros est envoyé en stase punitive pour 18 mois sans paie… et se réveille environ 3 millions d’années plus tard. C’est que, pendant son sommeil, la totalité de l’équipage a péri. Totalité ? Non, pas exactement : Rimmer a été ressuscité sous la forme d’un hologramme.
Le premier épisode de Red Dwarf m’a semblé un peu lent, probablement en grande partie parce que je connaissais déjà l’incident initiateur qui allait conduire au funeste destin de l’équipage du navire, et que ceci ne se produit que vers la toute fin de l’épisode. Le reste est, comme je vous le disais, plutôt une workplace comedy, insistant sur les attitudes opposées des deux personnages centraux. La dynamique fonctionne relativement bien (et Lister, faute d’être intelligent, et au moins grandement sympathique). Si vous répondez bien aux petites piques que s’envoient deux protagonistes parfaitement stupides, mais chacun à sa façon, ce pourrait bien être votre genre d’humour. Je suis en revanche un peu surprise que des personnages que je tenais pour acquis à force de voir des photos de la série… ne figurent pas du tout dans cette introduction ; mais vous voyez, c’est typiquement le genre de raisons pour lesquelles il fallait quand même que je jette un oeil à cet épisode un jour où l’autre.
Il importe finalement assez peu que Red Dwarf soit de la science-fiction. Cela semble relever plus du prétexte que d’autre chose, et je ne suis pas absolument convaincue de la « nécessité » de ce cadre pour raconter ce que ce premier épisode laisse entrevoir de la série. Mais eh, qui suis-je pour discuter la recette d’une série qui est presque aussi vieille que moi ?
Un panorama plutôt hétéroclite ce mois-ci, comme vous le voyez ! Mais assez parlé de moi : j’ai envie de savoir ce que VOUS avez regardé au mois d’octobre…

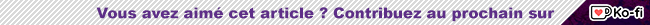
Lire la suite »