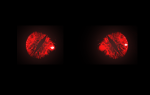« Oh, une nouvelle romcom sud-coréenne à base de musique ! Ce doit être parfaitement innocent et adorable. De toute façon, je ne m’attache jamais à ces séries, alors ça ne coûte rien d’y jeter un œil. Ce sera une heure vite passée, surtout que dernièrement j’ai regardé des choses plutôt dures. Mais là, avec un titre comme Muindoui Diva (c’est-à-dire Castaway Diva), aucun risque ! Voilà qui va me faire le plus grand bien ».
…
*soupir*
Bon eh bah. Parlons-en.

Sur le papier, Muindoui Diva (une série lancée par TvN ce weekend, et également mise à disposition à l’international par Netflix) laissait présager de la légèreté, de la légèreté, et encore de la légèreté. Jugez plutôt : « Après avoir passé 15 ans seule sur une île déserte, une chanteuse en herbe réintègre la société et ne recule devant rien pour réaliser son rêve : devenir une diva« . C’est le résumé de Netflix soi-même. Le matériel promotionnel était coloré et gai (pour le prouver, je vous en ai mis plusieurs exemples au fil de cette review), et bien-sûr, la promesse d’une romcom musicale n’est généralement pas de vous faire sangloter à trois heures du matin, prostrée au-dessus de votre clavier. Pas que ça me soit arrivé. La preuve : il était 3h30.
Dans les faits, hélas, ce n’est pas aussi simple. Cette même Muindoui Diva n’arrive pas à s’empêcher de raconter ce qui se déroule avant que son héroïne ne se retrouve sur une île déserte. Bah oui, vous comprenez, il vous faut le contexte ! Et le contexte, le voici. Accrochez-vous.
On est en 2007 et Jung Ki Ho vit avec son père, un homme qui l’élève seul et dont il est terrifié. Ki Ho est un adolescent solitaire, et qui passe tout son temps libre à travailler sur le port de l’île de Chunsam où il réside, ainsi qu’à offrir ses services pour transporter ses camarades en vélo après les cours en échange d’un petit billet. On découvre très rapidement que sa préoccupation première, c’est de mettre de l’argent de côté. La raison à cela devient vite apparente lorsque son père rentre le soir et le bat comme plâtre, ignorant que l’adolescent a caché une caméra dans sa chambre, qui enregistre le moindre détail de cette violence vraisemblablement coutumière.
 Dans la même classe, Seo Mok Ha est une adolescente qui vit avec son père, un veuf gérant d’un petit restaurant de poison. Sur l’île de Chunsam où elle a toujours vécu, il n’y a guère que la mer qui fasse vivre la population, de toute façon : c’est un bled paumé, où les gens ont un lourd accent provincial et pas beaucoup d’avenir hors du port. La jeune fille, elle, a d’autres rêves : elle admire de tout son cœur la chanteuse Yoon Ran Joo, dont Mok Ha s’est convaincue qu’elle est secrètement originaire de Chunsam mais qu’elle a changé son nom, son apparence, et sa façon de parler, et a ainsi trouvé le succès à Séoul. Rien n’indique vraiment que cette théorie soit correcte, mais l’essentiel, c’est que Mok Ha ait quelque chose à quoi se raccrocher. Tout justement, quelque chose lui a donné de l’espoir : l’agence artistique qui gère la carrière de Ran Joo a lancé une audition en ligne, pour laquelle il suffit d’enregistrer un clip musical dans lequel les candidates interprètent un titre de la chanteuse. Mok Ha a choisi Dream Us, une ballade à la guitare pleine d’espoir. Elle a la capacité vocale, elle a la guitare, elle a l’espoir. Le seul truc qui lui manque… c’est une caméra numérique. Ce n’est pas le moindre des détails, mais elle apprend que Ki Ho, avec lequel pourtant elle ne s’entend pas, est féru de video et équipé pour tourner le clip de ses rêves. Après une après-midi passée ensemble, convaincues que les deux ados n’ont rien en commun, l’affaire est dans le sac (ou plutôt dans la clé USB). Hélas, après cela, Mok Ha est aux abonnées absentes.
Dans la même classe, Seo Mok Ha est une adolescente qui vit avec son père, un veuf gérant d’un petit restaurant de poison. Sur l’île de Chunsam où elle a toujours vécu, il n’y a guère que la mer qui fasse vivre la population, de toute façon : c’est un bled paumé, où les gens ont un lourd accent provincial et pas beaucoup d’avenir hors du port. La jeune fille, elle, a d’autres rêves : elle admire de tout son cœur la chanteuse Yoon Ran Joo, dont Mok Ha s’est convaincue qu’elle est secrètement originaire de Chunsam mais qu’elle a changé son nom, son apparence, et sa façon de parler, et a ainsi trouvé le succès à Séoul. Rien n’indique vraiment que cette théorie soit correcte, mais l’essentiel, c’est que Mok Ha ait quelque chose à quoi se raccrocher. Tout justement, quelque chose lui a donné de l’espoir : l’agence artistique qui gère la carrière de Ran Joo a lancé une audition en ligne, pour laquelle il suffit d’enregistrer un clip musical dans lequel les candidates interprètent un titre de la chanteuse. Mok Ha a choisi Dream Us, une ballade à la guitare pleine d’espoir. Elle a la capacité vocale, elle a la guitare, elle a l’espoir. Le seul truc qui lui manque… c’est une caméra numérique. Ce n’est pas le moindre des détails, mais elle apprend que Ki Ho, avec lequel pourtant elle ne s’entend pas, est féru de video et équipé pour tourner le clip de ses rêves. Après une après-midi passée ensemble, convaincues que les deux ados n’ont rien en commun, l’affaire est dans le sac (ou plutôt dans la clé USB). Hélas, après cela, Mok Ha est aux abonnées absentes.
En allant voir chez elle ce qui se passe, Ki Ho y découvre la police : Mok Ha a appelé les services d’urgence après une énième nuit que son père a passé à la battre, et à détruire ses affaires. Dont sa guitare et sa précieuse collection de CD de Ran Joo, l’enfoiré.
 Déjà que je n’en menais par large quand Ki Ho s’est fait battre par son père, mais voir cette pauvre Mok Ha se faire violenter m’a absolument terrassée. Les lectrices de longue date de ces colonnes le savent : ce genre de sujet me touche un peu trop personnellement pour me laisser insensible dans la fiction. Là, franchement, je n’en pouvais plus. Les palmiers de l’île déserte ne pouvaient pas arriver assez vite. Je pétais un peu les plombs.
Déjà que je n’en menais par large quand Ki Ho s’est fait battre par son père, mais voir cette pauvre Mok Ha se faire violenter m’a absolument terrassée. Les lectrices de longue date de ces colonnes le savent : ce genre de sujet me touche un peu trop personnellement pour me laisser insensible dans la fiction. Là, franchement, je n’en pouvais plus. Les palmiers de l’île déserte ne pouvaient pas arriver assez vite. Je pétais un peu les plombs.
…Quand en plus l’officier de police présent sur les lieux, et essayant odieusement de temporiser la situation (« bon, vous avez juste essayé de discipliner votre fille qui s’est mal comportée, ça a un peu dérapé, ça arrive, elle va s’excuser d’avoir appelé la police ») s’est révélé être le père de Ki Ho, alors là…
A partir de ce point de l’intrigue, l’épisode inaugural de Muindoui Diva opère un tournant. Il n’est plus vraiment question d’énumérer les malheurs des deux adolescentes. Ki Ho, qui a vu depuis la rue la scène se dérouler, comprend désormais que contrairement à ce qu’il croyait, lui et Moh Ka ont beaucoup en commun. Il leur reste toutefois une différence fondamentale : lui doit se tirer par ses propres moyens, mais Moh Ka, elle, bénéficie d’une main tendue depuis l’extérieur de l’île. C’est que, voyez-vous, malgré l’abattement de l’adolescente, il a envoyé en secret son clip d’audition… et elle a été choisie pour venir à Séoul ! Une chance inespérée de, eh bien, de changer son nom, son apparence, et sa façon de parler, et ainsi trouver le succès à Séoul. Ou en tout cas quelque chose de cet ordre. Il lui fait donc promettre que la prochaine fois que son père veut la toucher, elle devra venir chez lui pour prendre la fuite ensemble.
 Il ne faut pas attendre longtemps pour que le paternel imbibé de Mok Ha tente de défoncer la porte de sa chambre afin de passer sa frustration sur elle. Alors, en pleine nuit, pieds nus sous la pluie, la voilà à toquer à la fenêtre de Ki Ho, et les deux adolescentes se mettent en chemin vers le port. Leur objectif : prendre le premier ferry, au petit matin.
Il ne faut pas attendre longtemps pour que le paternel imbibé de Mok Ha tente de défoncer la porte de sa chambre afin de passer sa frustration sur elle. Alors, en pleine nuit, pieds nus sous la pluie, la voilà à toquer à la fenêtre de Ki Ho, et les deux adolescentes se mettent en chemin vers le port. Leur objectif : prendre le premier ferry, au petit matin.
A ce stade, je ne vous cache pas que j’oscillais vaguement sur ma chaise, la morve me coulant jusqu’au menton, dépensant toute mon énergie à ignorer que je savais, parce que j’avais donc lu le résumé, que Mok Ha n’arriverait pas à Séoul. Je ne savais pas comment, mais il était évident qu’elle allait d’abord finir sur une île déserte, parce que… la série repose sur cela ! Et c’était absolument intolérable en ce moment précis. En fait, je ne voulais plus voir les palmiers du tout. Pour ma propre santé mentale, il fallait absolument que Ki Ho et Moh Ka arrivent à Séoul, soient accueillies à bras ouverts par l’agence artistique de Ran Joo, et sauvées de leur adolescence insoutenable.
Alors certes, tout cela, c’est du mélodrame. Résolue à faire pleurer dans les chaumières sur le sort tragique de son héroïne et de l’ami de celle-ci, Muindoui Diva fait tout son possible pour rendre les choses aussi dures que possible. Ça passe d’ailleurs par une troisième scène de violence, cette fois entre le père de Moh Ka et Ki Ho, dont je vous passe le détail des circonstances, mais qui se conclut sur la séparation des deux ados. Les ficelles sont grosses comme celles d’un filet de pêche, cela, même noyée dans mon océan d’émotions j’étais capable de le voir. Mais en un sens, c’est aussi louable que Muindoui Diva ne se soit pas juste dit qu’il suffirait de raconter tout cela plus tard, dans des flashbacks balancés au moment le plus opportun ; j’aurais aussi protesté devant cette pratique.
C’est juste que, punaise, c’était vraiment pas écrit dessus quand j’ai lancé l’épisode sur le mode « allez juste pour me détendre, et après je vais me coucher ».
 Juré, à un moment, Muindoui Diva va devenir un peu plus joyeuse. Comme promis sur les posters. D’ailleurs, j’avais pas menti, vous avez vu : ils sont vraiment colorés et gais.
Juré, à un moment, Muindoui Diva va devenir un peu plus joyeuse. Comme promis sur les posters. D’ailleurs, j’avais pas menti, vous avez vu : ils sont vraiment colorés et gais.
Il est cependant vital de noter que ce moment ne va pas réellement être au rendez-vous dans le premier épisode. Non, ne comptez pas trop dessus, car Moh Ka, en plus de ne pas arriver à Séoul et d’échouer sur une île déserte, doit aussi composer avec la mort de sa brute de père. Ce qui évidemment apporte des émotions mêlées. Apparemment on a décidé d’empiler les traumatismes comme des Lego aujourd’hui dans Muindoui Diva.
Honnêtement, à partir de là, les choses ne peuvent que s’améliorer. Peut-être pas du tout au tout (quoique, le trailer de l’épisode suivant a l’air plus optimiste), mais on voit mal comment ça pourrait être pire. Ce n’est pas un challenge ! Avant de nous laisser aller pleurer sous la douche, Muindoui Diva nous fournit un mystérieux montage des années à venir pour Ki Ho. Et surtout, montre une Moh Ka apaisée, qui a passé 15 années sur son île coupée de tout, et s’y est créé une vie à peu près confortable. En tout cas, libre. Elle y a une petite hutte, plein d’objets de récupération, ses pommes de terre qu’elle fait pousser, les coquillages qu’elle a appris à pêcher… bref, c’est The Blue Lagoon. Sans l’inceste et la nudité infantile.
On sait là encore que cette vie n’est pas vouée à durer, et qu’à un moment Moh Ka va retourner à la civilisation, mais au moins, pour le moment, elle est apaisée.
Et c’est bien tout ce que l’on peut espérer vu la situation. La célébrité et l’amour en plus de ça, c’est presque de la gourmandise.
Bon, pour moi, ça ne fait pas encore 15 ans, mais à ma façon aussi je vis sur une île déserte, alors j’ai bon espoir. Dream Us.