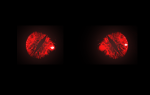SkyShowtime (une plateforme qui rappelons-le est l’équivalent de Paramount+ dans certains pays nordiques et européens, mais sans la marque Paramount+ parce que pourquoi se simplifier la vie) a lancé en ce mois d’octobre une co-production entre la Finlande et la Suède, et c’est l’occasion pour moi de remarquer que je regarde beaucoup de moins de séries scandinaves depuis quelques temps. Tiens, je me demande à quoi ça tient. A part quelques fictions Viaplay, on dirait que je suis devenue difficile.
Enfin bon, on adressera ce problème ultérieurement ; en attendant, constatons avec un plaisir non dissimulé que Kodnamn: Annika est pour une fois une série d’espionnage, pas spécialement un genre dans lequel la région s’est distinguée ces dernières années. Plus intéressant encore, l’intrigue démarre dans le monde de l’art ! Voilà qui est original ! Kodnamn: Annika avait, au moins sur le papier, retenu mon attention.

Tout part d’une toile de Helene Schjerfbeck, une œuvre qui s’apprête à être proposée lors d’enchères très haut de gamme dans une maison de ventes suédoise. Une opération de grande envergure est organisée à cette occasion ; la jeune agente finlandaise Emma Haka, pourtant encore en formation, est recrutée pour en faire partie, et dépêchée en Suède séance tenante.
Alors qu’elle apprenait encore à maîtriser les nuances complexes du travail d’infiltration, la voilà donc qui en quelques heures doit s’inventer une légende, s’adapter aux méthodes de travail sur le terrain, et surtout, maîtriser sa nervosité. Et ce dernier point, en particulier, n’est pas gagné d’avance, en partie parce que le nom qu’elle s’est trouvé, « Annika Stormere », lui est personnel. Mais ne lui a-t-on pas appris qu’il était plus simple de mentir de façon réaliste lorsqu’on utilise des éléments qui sont vrais ?
On a un peu de mal à comprendre, au début, certains des enjeux du premier épisode de Kodnamn: Annika. Le côté professionnel est assez évident, bien-sûr : Emma/Annika est appelée à se faire passer pour une experte en art lors de l’opération, afin de vérifier si l’œuvre mise aux enchères est authentique ou s’il s’agit d’un faux. Côté personnel, il n’y a pas non plus des masses de complexité : dans la vie, Emma vit avec son compagnon Sampo, un comédien. Si j’ai bien compris, il ignore qu’elle travaille pour les renseignements et croit qu’elle travaille effectivement dans l’art.
Où est le problème, me direz-vous ? Eh bien c’est le problème : je n’arrive pas à déterminer où exactement se situe le problème. Est-ce la nervosité palpable d’Emma lorsqu’elle endosse la personnalité d’Annika qui est contagieuse ? Est-ce le fait que la série semble entretenir le flou sur la backstory d’Emma ? Est-ce le fil rouge (…sans jeu de mot) qui est établi au fil de cette opération ? Peut-être un mélange de tout cela ; toujours est-il que j’ai eu plusieurs fois l’impression d’avoir du mal à discerner certaines choses dans cette exposition. Sans parler de la possibilité que les sous-titres ne soient pas parfaitement traduits ; ça s’est vu avec Netflix, et je connais encore mal la qualité moyenne des sous-titres de SkyShowtime dont d’ailleurs c’est la première série originale scandinave.
 Par exemple, j’ai cru comprendre qu’Emma avait été faussaire avant de rejoindre les services finlandais… mais c’est ce que j’ai déduit de certaines allusions, ce n’est pas clairement affirmé dans un sens ou dans l’autre. Un autre moment qui m’a un peu mélangée est mon incapacité à dire précisément dans quelle mesure Sampo connaît la profession d’Emma ; au début je pensais qu’il l’ignorait ; sur la fin de l’épisode j’ai été prise par le doute. Ce ne sont pas en soi des choses qui empêchent de comprendre l’action de cet épisode, mais ce sont plein de nuances qui changent l’interprétation des dynamiques auxquelles on assiste.
Par exemple, j’ai cru comprendre qu’Emma avait été faussaire avant de rejoindre les services finlandais… mais c’est ce que j’ai déduit de certaines allusions, ce n’est pas clairement affirmé dans un sens ou dans l’autre. Un autre moment qui m’a un peu mélangée est mon incapacité à dire précisément dans quelle mesure Sampo connaît la profession d’Emma ; au début je pensais qu’il l’ignorait ; sur la fin de l’épisode j’ai été prise par le doute. Ce ne sont pas en soi des choses qui empêchent de comprendre l’action de cet épisode, mais ce sont plein de nuances qui changent l’interprétation des dynamiques auxquelles on assiste.
Cette confusion est aggravée par ce que traverse Emma/Annika dans ce premier épisode, c’est-à-dire que cette opération réveille quelque chose d’intime. On ne sait juste pas précisément quoi. Le choix de légende qu’elle fait sur le moment, quand sa supérieure lui intime de choisir « quelque chose qui te ferait réagir si je le criais dans la rue », fait tiquer son supérieur direct ; vers la fin de l’épisode, on apprendra qu’Emma connaissait une Annika Storm qui est aujourd’hui décédée. Qui était-elle pour Emma ? Ne comptez naturellement pas sur le premier épisode pour nous le révéler tout de suite, vous plaisantez j’espère. Plus tard pendant l’opération, Emma/Annika croise une femme suédoise dans la foule de la maison de ventes, qui croit la reconnaître. Approchant la jeune agente avec curiosité, la Suédoise prononce des paroles en apparence sibyllines, avant de finalement s’éloigner, mais qui ont l’effet de réveiller quelque chose de traumatique en Emma, ce qui manque de lui faire foirer l’opération. Ces mots ont-ils été utilisés à dessein pour déclencher quelque chose, s’agit-il d’un conditionnement ancien ? Vous en savez autant que moi.
Et puis, il y a ces flashs rouges qui défilent devant les yeux d’Emma, ajoutant à sa désorientation pendant toute cette journée. Sa supérieure pensait bien faire en essayant de donner à la jeune femme des outils pour ne pas lâcher sa légende pendant cette opération : « as-tu une ancre ? un rappel visuel, une couleur, une formule ? » ; Emma a choisi le rouge. Mais le rouge semble être évocateur pour elle de choses bien avant cette opération, ce qui ne fait qu’ajouter à la cacophonie dans sa tête pendant une journée si importante.
Bref, Kodnamn: Annika fait un travail formidable lorsqu’il s’agit de décrire à quel point Emma/Annika s’emmêle ; pas de chance, elle fait aussi du bon boulot pour ne pas rendre les choses claires à ses spectatrices. Et au stade de ce premier épisode, je n’arrive même pas à cerner dans quelle mesure c’est voulu.
Pendant ce temps, l’intrigue progresse. L’opération réserve quelques surprises, notamment parce qu’Emma n’avait pas été informée de tous les tenants et aboutissants, mais qu’elle réussit à les déduire, et s’appuie sur ses conclusions pour prendre de l’initiative. Un risque que personne ne lui a demander d’endosser, et qui alerte un peu sa hiérarchie, mais qui donne des résultats ! Emma/Annika parvient à s’introduire auprès des deux personnes les plus importantes de la vente aux enchères : le galleriste Rasmus Ståhlgren, que tout le monde lui présente comme très dangereux, et l’acheteuse finale de la toile, une mystérieuse française. Ignorant les avertissements de ses collègues plus expérimentées, Emma/Annika entreprend de se rapprocher de Rasmus… et tout cela est parfaitement compréhensible. On peut sentir à la fois la nervosité de la jeune agente, son désir de bien faire, et son zèle lorsqu’elle pense percevoir une opportunité. Trois facettes qui semblent en contradiction les unes avec les autres, mais qui créent un personnage cohérent tout de même, paradoxalement.
Trois facettes qui en évoquent trois autres : Emma Haka, Annika Stormare et… Annika Storm. Le vrai mystère sur lequel la série porte, en réalité.
J’espère qu’au-delà de cet épisode inaugural de Kodnamn: Annika, l’impression de confusion s’estompera. Il est difficile pour moi de le jurer, par contre il m’est également difficile d’affirmer que cette impression de brouillard est nécessairement une mauvaise chose. La série semble appartenir à cette race assez récente de thrillers qui jouent moins de retournements de situation à couper le souffle que de la difficulté à maîtriser les détails complexes de son univers. Honnêtement ? Si mon premier réflexe est souvent la répulsion face à ces séries (ne suis-je pas supposée comprendre ce que je regarde ?! c’est frustrant de ne pas être en mesure de le faire immédiatement), eh bien, ma foi… à la condition que cette désorientation soit volontaire et temporaire, j’apprécie aussi l’ambiguïté que cela apporte, moins spectaculaire que des twists renversants, plus psychologique. Et plus moderne dans ce qu’elle dit à la fois du monde et des identités que l’on y croise, lesquelles nous échappent plus souvent qu’il n’est confortable de se l’avouer.
Lire la suite »























 En 1973, la télévision publique pakistanaise lance une série basée sur un roman de l’auteur Shabbir Shah. A l’époque, PTV est encore jeune (ses premières émissions datent de 1964), et transmet en noir et blanc ; mais cela n’empêche pas cette série de devenir l’une des plus emblématiques de l’histoire de la télévision pakistanaise. Son sujet ? Elle se déroule dans le Punjab rural, au cœur d’un petit village pauvre, et explore les complexités découlant du
En 1973, la télévision publique pakistanaise lance une série basée sur un roman de l’auteur Shabbir Shah. A l’époque, PTV est encore jeune (ses premières émissions datent de 1964), et transmet en noir et blanc ; mais cela n’empêche pas cette série de devenir l’une des plus emblématiques de l’histoire de la télévision pakistanaise. Son sujet ? Elle se déroule dans le Punjab rural, au cœur d’un petit village pauvre, et explore les complexités découlant du 



 Mais revenons à nos moutons (pardon, trop tentant), et parlons des intrigues en elles-mêmes. Parce qu’elle est en grande partie placée sous le signe de la légèreté (son rythme en témoigne), Déter met en place, pour l’instant au moins, des enjeux assez simples. Personne ne se présente d’emblée avec une tragédie grecque à jouer. Au cours de cette première semaine (encore une fois, je me base sur l’omnibus), on apprendra par exemple que Mehdi espère rejoindre un incubateur de talents dans la tech ; qu’Elsa n’a d’yeux que pour les bovidés du lycée et pas tellement les personnes humaines ; que son frère Basile n’est absolument pas sérieux et qu’il se contrefout de mettre en péril sa scolarité ; que Cloé est… euh, bon pour l’instant elle n’a pas trop d’intrigue perso, mais elle est instrumentale dans la vie sociale du bahut ; que Lia est en train de tomber sous le charme d’un étudiant plus âgé en BTS agricole, Noé ; et que Sohan a tout fait pour intégrer ce lycée à cause d’un ancien élève, Max. Cette première semaine est aussi l’occasion de voir comment Sohan s’intègre à ce monde auquel jusque récemment il était étranger, de le voir tisser des débuts d’amitié ou au contraire se mettre à dos certaines élèves.
Mais revenons à nos moutons (pardon, trop tentant), et parlons des intrigues en elles-mêmes. Parce qu’elle est en grande partie placée sous le signe de la légèreté (son rythme en témoigne), Déter met en place, pour l’instant au moins, des enjeux assez simples. Personne ne se présente d’emblée avec une tragédie grecque à jouer. Au cours de cette première semaine (encore une fois, je me base sur l’omnibus), on apprendra par exemple que Mehdi espère rejoindre un incubateur de talents dans la tech ; qu’Elsa n’a d’yeux que pour les bovidés du lycée et pas tellement les personnes humaines ; que son frère Basile n’est absolument pas sérieux et qu’il se contrefout de mettre en péril sa scolarité ; que Cloé est… euh, bon pour l’instant elle n’a pas trop d’intrigue perso, mais elle est instrumentale dans la vie sociale du bahut ; que Lia est en train de tomber sous le charme d’un étudiant plus âgé en BTS agricole, Noé ; et que Sohan a tout fait pour intégrer ce lycée à cause d’un ancien élève, Max. Cette première semaine est aussi l’occasion de voir comment Sohan s’intègre à ce monde auquel jusque récemment il était étranger, de le voir tisser des débuts d’amitié ou au contraire se mettre à dos certaines élèves.
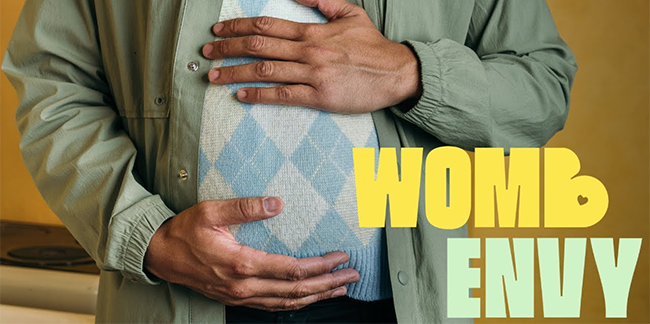
 Dans ce contexte, l’exubérante The Divine n’est pas qu’une amie imaginaire taquine. Même si, en drag queen fière de l’être, elle apporte également une énergie chaotique dans la vie de Max (à qui elle n’était jamais apparue jusqu’alors), elle sait aussi être de bon conseil, le rabrouer lorsqu’il se complait dans ses travers, ou le rappeler à la raison lorsqu’il oublie son identité d’homme gay. Jongler entre tout ça n’est pas toujours facile, voire parfois contradictoire, mais The Divine le fait avec bonne humeur, un verre à la main, et toujours un fantastique costume sur le dos (ce n’est probablement pas un hasard que l’interprète de The Divine ait créé la série…).
Dans ce contexte, l’exubérante The Divine n’est pas qu’une amie imaginaire taquine. Même si, en drag queen fière de l’être, elle apporte également une énergie chaotique dans la vie de Max (à qui elle n’était jamais apparue jusqu’alors), elle sait aussi être de bon conseil, le rabrouer lorsqu’il se complait dans ses travers, ou le rappeler à la raison lorsqu’il oublie son identité d’homme gay. Jongler entre tout ça n’est pas toujours facile, voire parfois contradictoire, mais The Divine le fait avec bonne humeur, un verre à la main, et toujours un fantastique costume sur le dos (ce n’est probablement pas un hasard que l’interprète de The Divine ait créé la série…).