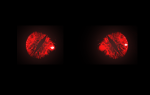Mon visionnage de la première saison de Silo aura été… ambivalent. Oui, voilà, disons ça.
Après un très solide premier épisode, pas fantastique mais néanmoins solide, puis un deuxième épisode intrigant mais en demi-teinte, j’ai commencé à perdre un peu la foi, et j’avoue qu’essayer de la retrouver au fil de la saison a été une lutte avec moi-même. Tentée à plusieurs reprises d’abandonner, j’ai finalement achevé cette première saison la nuit dernière. La seconde est déjà commandée par Apple TV+, ce qui est bon signe. D’ailleurs décidemment entre For All Mankind, See, Invasion, Foundation, Severance, Hello Tomorrow! et Silo, la plateforme est très en jambes côté science-fiction !
A l’issue de ce visionnage, je suis… bon, pas ravie, mais ça n’est pas la débâcle. Juste frustrée. Plusieurs points me posent problème, et pour autant, d’autres ont (clairement à dessein) stimulé mon imagination. C’est à la fois agréable et agaçant quand ça se produit. C’est quand même plus simple quand tout est soit bon, soit mauvais !
Alors tentons donc d’en parler, de cette première saison. Peut-être m’apporterez-vous une perspective différente. D’ailleurs, j’ai un peu le sentiment que Silo, entre autres choses, appelle à cela : des perspectives différentes.
A noter qu’une partie de cette review inclut des spoilers, mais ils seront dûment précédés d’un avertissement ; le reste devrait pouvoir être lu en toute quiétude.

Silo commence, et ça n’aura pas échappé aux spectatrices ayant vu Ascension (reviewée il y a quelques années juste ici), de façon assez familière pour une série de science-fiction, a priori dystopique.
On y présente une société humaine vivant intégralement dans un gigantesque silo (ci-après « le Silo ») comptant 144 niveaux différents, qui abritent, mais aussi nourrissent et administrent, 10 000 personnes. Cela fait au moins 140 ans que l’existence de ces gens ressemble à cela ; un incident ayant eu lieu 140 ans plus tôt (« the Rebellion« ) a en effet effacé toute l’Histoire ayant précédé ces événements.
De prime abord, le Silo ressemble à un plan qui a très bien tourné. Si la vie est limitée spatialement, et a des conséquences en matière de gestion des ressources par exemple (le recyclage y est vu comme une extrême nécessité), le premier épisode nous montre une vie plutôt confortable. On n’y manque ni d’eau, ni de nourriture ; aucun rationnement n’est à dénoter notamment à cause des larges fermes installées dans les « Mids« , les étages du milieu où l’on trouve des terres cultivables ainsi que des élevages. En fait on n’y manque tellement de rien qu’on découvrira au fil de la série qu’il n’est pas impossible d’avoir un animal de compagnie ! L’organisation du Silo repose sur l’idée que toute personne travaille et donc contribue à l’équilibre de la société ; techniquement il n’y a donc pas de laissées pour compte, même si, bon, il y a encore des gens avec un certain privilège de classe (qui vivent « Up Top« , dans les étages du haut) et d’autres avec des métiers physiques et/ou mal considérés (les groupes sociaux de « Deep Down« , les étages du bas). Mais même comme ça il n’y a pas exactement de misère, et tout le monde semble manger à sa faim.
En fait, c’est une société qui malgré ses règles de vie strictes (éditée dans « the Pact« , son texte de loi) est dans l’ensemble assez libre. Personne n’est forcé de vivre dans le Silo, après tout : quiconque le demande sera autorisée à sortir ; il lui sera demandé de nettoyer l’unique capteur externe qui filme la surface, et qui s’encrasse avec les ans ; même à cela, personne n’est toutefois obligé. Avec un bémol important : l’air à la surface semble irrespirable, et jusque là toutes les personnes sorties pour « nettoyer » sont décédées sous les yeux du public. Toujours après avoir nettoyé le capteur extérieur.
 En-dehors de ça, le microcosme du Silo obéit principalement à deux règles fondamentales : ne jamais instaurer d’outils d’automatisation de la montée/descente de l’immense escalier central du Silo, qui est le seul moyen de traverser les étages ; et une limitation technologique, notamment en matière de miniaturisation et plus largement d’informatique. Ces deux tabous principaux sont en fait l’expression d’une interdiction plus importante, mais généralement tue : les objets issus de la civilisation avant la Rebellion, et avant le Silo, même, sont interdits. Cela étant, il s’échangent à l’occasion sous le manteau, sous l’appellation de reliques.
En-dehors de ça, le microcosme du Silo obéit principalement à deux règles fondamentales : ne jamais instaurer d’outils d’automatisation de la montée/descente de l’immense escalier central du Silo, qui est le seul moyen de traverser les étages ; et une limitation technologique, notamment en matière de miniaturisation et plus largement d’informatique. Ces deux tabous principaux sont en fait l’expression d’une interdiction plus importante, mais généralement tue : les objets issus de la civilisation avant la Rebellion, et avant le Silo, même, sont interdits. Cela étant, il s’échangent à l’occasion sous le manteau, sous l’appellation de reliques.
Comme le dit le Pact, en des termes parfois repris comme des psaumes : « We do not know why we are here. We do not know who built the Silo. We do not know why everything outside the Silo is as it is. We do not know when it will be safe to go outside. We only know that day is not this day« . Ce n’est jamais le bon jour pour penser au-delà du Silo.
Il y a, toutefois, quelque chose de dérangeant dans ce monde cloisonné, et il se perçoit dés le premier épisode au travers des expériences d’un couple, l’ingénieure en informatique Allison Becker et son mari le Shérif Holston Becker. Car qui dit espace limité, dit contrôle des naissances.
En un certain sens, cela tombe sous l’évidence vu la situation. Les couples reconnus (l’équivalent du mariage aux yeux du Pact) se voient délivrer au compte-goutte des autorisations de procréer, les implants contraceptifs des femmes sont alors retirés pour un an ; si une grossesse ne se produit pas dans le temps imparti, ils sont ensuite réimplantés. Certains dialogues suggèrent que ce procédé conduit à 250 naissances par an pour la population fixe de 10 000 humaines. Ces mesures sont généralement comprises et acceptées par la population, et vous me direz, forcément, depuis 140 ans elle n’a rien connu d’autre ! Et puis dans l’ensemble, la société semble juste et fonctionnelle… mais le démarrage de l’intrigue de Silo pose la question.
Une société fonctionnelle peut-elle vraiment être juste ?

Le premier épisode de Silo fait, il faut le dire, un travail spectaculaire pour installer tout cela, ou en tout cas une grande partie de ces ingrédients quitte à détailler certains aspects par la suite. En matière de world building, c’est de la belle ouvrage, il n’y a pas grand’chose à redire. Le problème inverse d’Ascension, honnêtement. Tout au plus interrogera-t-on certains points évoqués furtivement dans les dialogues mais n’appartenant pas (au moins pour le moment) au focus de la série. Par exemple, la première saison de Silo évoque régulièrement des mines… mais ça creuse depuis 140 ans et ça n’est toujours pas sorti du Silo ? Comment n’est-on pas tombées à court de minerai exploitable, depuis le temps ? Un peu surprenant mais admettons. Et puis effectivement, ce n’est pas le sujet. Ou pas encore.
En particulier, la série est attentive à décrire non pas l’organisation pratique, mais plutôt administrative et politique du Silo. Cette hiérarchie, représentée par ce gigantesque escalier en spirale central, se matérialise par le bureau de la maire Jahns, secondée par le bureau du Shérif Becker. Leur pouvoir est partagé avec « Judicial« , dirigé par l’autoritaire juge Meadows, à la tête de la branche juridique qui possède ses propres forces de sécurité, et « IT« , supervisée par l’humble fonctionnaire Bernard Holland et qui est le domaine de la collecte, l’organisation et le traitement des données.
Lorsque commence la série, Allison Becker vient de recevoir l’autorisation de se faire retirer son implant contraceptif pour la troisième fois ; avec son mari le shérif Holston Becker, c’est leur dernière chance d’avoir un enfant vu leurs âges.
Le premier épisode déroule non sans maestria l’année de leur vie passée à tenter de concevoir cet enfant, hélas sans y parvenir ; Silo passe un temps infini à détailler (comme un nombre grandissant de séries, l’avez-vous remarqué ?) les hauts et les bas de ce parcours de fertilité. Au bout d’un an, mais en réalité plutôt trois ans si on compte les tentatives précédentes, la santé mentale d’Allison est sur les rotules ; elle s’est même tournée vers l’aide moins médicale, et à la limite de l’ésotérique, de Gloria, une vieille femme qui fait de l’accompagnement officieux en fertilité. C’est d’elle qu’est venu le doute : et si en réalité, ce n’était pas un accident ? Et si quelqu’un, en haut lieu, ne voulait pas qu’Allison ait un enfant ?
Il faut dire qu’Allison est une personne curieuse, posant beaucoup de questions qui gênent un peu à IT. Pire encore, pendant cette année éreintante, elle est aussi entrée dans l’orbite de George Wilkins, un informaticien de Deep Down qui lui a fait découvrir une surprenante relique : un disque dur plein à craquer de videos d’avant. Elle le sait, parce qu’elle l’a aidé à en craquer les mesures de protection pour accéder au contenu… et l’a donc vu.
A la fin de l’épisode introductif, Allison semble totalement paranoïaque. Cependant, elle démontre à son mari qu’elle l’est pour une bonne raison, en extirpant d’elle-même un implant contraceptif… qui ne lui a donc pas été retiré par le médecin comme on lui avait fait croire. A la suite de quoi elle demande à sortir du Silo, ce qui lui est évidemment accordé. C’est dans le Pact.
Comme toutes celles qui sont sorties avant elle, elle meurt devant la camera du capteur en surface, laissant son mari dévasté. Dans l’épisode qui suit, Silo chronique comment il tente de faire son deuil, commence à se poser des questions, et… finalement demande à sortir également. Pour mourir devant le capteur à son tour.
Alors déjà, une chose est claire et va le rester : Silo ne ressent aucune forme d’hésitation à tuer ses personnages. Cela va continuer de se produire avec une certaine régularité, quand bien même les protagonistes concernées peuvent être influentes voire instrumentales dans la vie du Silo. Ou incarnées par des interprètes célèbres. Et cela, avec assez peu de flashbacks pour les représenter à l’écran une fois décédées, d’ailleurs. Constamment remplacées par une galerie de nouveaux visages, les vies se succèdent dans Silo… Cela retranscrit une impression de continuité assez fidèle à la logique utilitariste de la vie dans ce Silo : tout le monde y a sa place, mais pas plus. Une fois une personne disparue, la vie continue. La vie au sens large du Silo en dépend.
…D’ailleurs cette idée que les habitantes du Silo sont l’équivalent de cellules dans son organisme est prégnante jusque dans le générique, qui accumule les parallèles entre la structure brutaliste limite cyberpunk et les images superposées d’un corps humain (pilier central qui devient une colonne vertébrale, escaliers qui ressemble à une hélice d’ADN, flux de passantes qui évoque un flux sanguin…). C’est saisissant, presque horrifique, et ça m’a conduite à élaborer des théories qui, pour le moment du moins, ne sont pas avérées ; cela dit ça ne les invalide pas nécessairement pour la suite, on verra. Reparlons-en en saison 2.

D’autres de mes théories, en revanche, se sont révélées exactes à la toute fin de la saison. En particulier celle que j’avais formulée dés la fin du deuxième épisode… ce qui est un peu frustrant.
C’est que, ayant tué les deux héroïnes de ses deux premiers épisodes, Silo finit par s’intéresser à Juliette Nichols. Cette ingénieure en mécanique vit à Deep Down, mais est originellement issue des Mids, et va donc se voir promue Up Top, endossant le rôle de Shérif à la mort de Holston Becker. Faire mourir les deux actrices noires majeures de la série, pour céder la place à une héroïne blanche… the optics aren’t great, Silo.
Forcée de s’adapter à la vie Up Top, mais aussi à la hiérarchie gouvernementale, Juliette n’a accepté que pour une raison : elle veut connaître la vérité sur la mort de George Wilkins, qui était son amant, leur union ayant été tenue secrète au lieu d’être reconnue légalement. Cette investigation va la conduire à poser des questions gênantes. C’est d’autant plus vrai que George était un passionné de reliques, et qu’il en avait d’ailleurs collectionné un bon paquet. Juliette en porte une à son poignet, certes autorisée légalement (c’est une vieille montre qu’elle a réparée après que George la lui ait offerte), mais qui éveille tout de même les soupçons. La nostalgie des jours passés, ce n’est pas très Silo.
Au fil de cette enquête, qui est moins policière qu’elle n’est intime (et franchement tant mieux, parce que virer au cop show ça m’aurait bien cassé les pieds, et oui je fais encore allusion ici à Ascension) ou politique, Silo soulève des choses très intéressantes. Peut-être trop.
Il faut dire qu’elle est captivée par l’aspect conspirationniste de son intrigue. C’était inévitable vu l’atmosphère dystopique, je pense. « They » (« on ») revient dans le discours de nombreuses protagonistes pour interroger la volonté d’une main invisible, mais toute puissante, dans la vie des habitantes du Silo. Qui a tué qui ? Pourquoi ? Car il apparaît très vite qu’il ne s’agit pas de meurtre crapuleux, mais que ces morts successives au sein du Silo, avant même de parler de celles qui ont lieu devant le capteur à la surface, ont une raison d’être imbriquée dans la raison d’être du Silo lui-même.
A mesure que se révèlent les « méchants » de la série, Silo tient tout un discours sur la façon dont l’organisation de cette société n’a rien d’accidentel ni de démocratique. Que le modèle d’élections municipales ne vous trompe pas : dans le Silo, le peuple n’a pas son mot à dire ou juste de façon superficielle ; « on » pense pour lui. « On » décide de tout pour lui, du plus prosaïque (qui habite dans quel logement ?) au plus abstrait (pour quelle raison sommes-nous ici ?). Tout le volet de la saison touchant de près ou de loin aux reliques montre à quel point la chasse idéologique aux objets légués, à l’Histoire, et à la curiosité intellectuelle, est capitale dans le maintien du Silo. La plupart du temps, cet équilibre est maintenu sans violence visible. Mais quand c’est nécessaire, « on » considère que la survie du Silo dépend du maintien de cette main-mise, et on n’hésite pas à employer la force. Contrôler le peuple, c’est contrôler ce à quoi il croit avant tout, cela évite d’avoir les mains pleines de sang.
Silo se fascine pour cette histoire d’ingénierie sociale pervertie. Parfois aux dépens du reste. Pas toujours, heureusement.
Attention après l’image, je commence à évoquer quelques spoilers mineurs. D’autres spoilers plus graves viendront quelques paragraphes plus loin.

Au fil de ses recherches, Juliette soulève le point qui, déjà, avait été à l’origine du problème des Becker : le Silo fonctionne sur des bases profondément eugénistes. Le fait que ce soit majoritairement accepté ne le rend pas nécessairement acceptable !
Ce qui est un peu surprenant, surtout si l’on considère ce que fait la science-fiction d’ordinaire avec ce type d’intrigues, c’est que pour Silo, cet eugénisme est, paradoxalement, plus socio-politique qu’autre chose.
Pour une société vivant avec un pool génétique fermé, c’est étonnant. Cette dimension n’est jamais évoquée sous l’angle biologique par qui que ce soit (et d’ailleurs les unions sont entièrement libres, contrairement aux mariages arrangés d’Ascension). Il ne semble y avoir aucune crainte de consanguinité. On apprendra qu’il n’y a même pas de sélection génétique dans l’attribution des autorisations d’enfanter. Par exemple Paul Billings, le second de Juliette au bureau du Shérif, est ainsi atteint d’un mal appelé « Syndrome », et s’il le garde secret c’est pour des raisons strictement professionnelles. C’est également la curiosité historique et donc politique d’Allison Becker qui est sanctionnée (ainsi que des Flamekeepers, un groupe dont on découvre l’existence au fil de la saison) par des choix eugénistes. Ou encore, après qu’Allison ait découvert dans le premier épisode qu’il peut arriver qu’on fasse croire à des couples qu’il leur est autorisé de procréer, tout en le rendant physiquement impossible, se pose aussi la question du pourquoi. Comme le fait remarquer Juliette, pourquoi mentir aux gens et leur faire croire que leur reproduction est autorisée mais échoue… plutôt que de simplement ne pas leur donner l’agrément ? Quelle perversion silencieuse à se défausser même de cette responsabilité-là, et blâmer le corps de ces femmes, quand en réalité on décide du destin de familles entières à leur place !
Il y a donc tout un angle mort, un peu surprenant, en matière de réflexion sur les enjeux de cet eugénisme. On joue strictement l’angle conspirationniste (« on » manipule la natalité). Et pourtant… cette société profondément eugéniste se retrouve par des moyens détournés dans d’autres aspects, presque comme accidentellement.
Bien que les choses ne soient pas corrélées explicitement par l’intrigue, cette société est bel et bien dirigée par des principes validistes : la peur du Syndrome, qui conduit à un déclassement social ; ou encore le recours aux internements forcés pour raisons politiques, en sont des exemples. Rien que la vie dans le Silo est conditionnée par la capacité à le traverser, ses 144 étages demandant une journée de marche à quelqu’un en bonne santé pour aller du premier au dernier étage, et vice versa. Ce qui limite d’autant la mobilité sociale…
Dans Silo, cependant, l’exploration de l’angle médical est presque toujours écartée. A la place, la médecine est strictement une branche exécutive de Judicial (sans vraiment beaucoup en discuter, étonnamment). Par curiosité téléphagique autant que personnelle, j’aurais aimé que la série explore cet aspect, mais elle avait beaucoup d’autres choses à examiner.
 On trouve ainsi un autre thème fascinant dans les différentes intrigues de la série : l’idée d’un confinement dans le confinement. Plusieurs protagonistes secondaires de Silo vivent en effet un enfermement supplémentaire ; là où les 10 000 humaines du Silo n’en sont jamais sorties (ou alors pour mourir dehors, à peine quelques mètres plus loin), plusieurs sont les personnages qui s’enferment encore plus dans leurs quartiers. Mentionnons par exemple Regina, l’ex de George, qui vit calfeutrée dans son appartement avec son chat, se faisant délivrer des plateaux à manger. Il y a aussi Gloria, la conseillère en fertilité qui se retrouve internée en cours de saison. Et puis bien-sûr, Martha Walker, figure maternelle pour Juliette, qui a passé les 25 dernières années dans son atelier, incapable d’en franchir la porte (représentation de l’agoraphobie ? on dirait bien !). Ce sont des protagonistes, bon, déjà, féminines… intéressant ! Mais surtout des protagonistes vivant de toute évidence à la marge, ce qui paradoxalement leur confère une capacité à voir ce qui est invisible aux autres. Humainement, politiquement, historiquement… ce sont des femmes qui savent lire au-delà de leur propre destinée ; qui l’ont interrompue, en un sens, pour préserver ce qu’elles savent. Enfermées dans des petits espaces, leur vue est large, et perçante. Salvatrice.
On trouve ainsi un autre thème fascinant dans les différentes intrigues de la série : l’idée d’un confinement dans le confinement. Plusieurs protagonistes secondaires de Silo vivent en effet un enfermement supplémentaire ; là où les 10 000 humaines du Silo n’en sont jamais sorties (ou alors pour mourir dehors, à peine quelques mètres plus loin), plusieurs sont les personnages qui s’enferment encore plus dans leurs quartiers. Mentionnons par exemple Regina, l’ex de George, qui vit calfeutrée dans son appartement avec son chat, se faisant délivrer des plateaux à manger. Il y a aussi Gloria, la conseillère en fertilité qui se retrouve internée en cours de saison. Et puis bien-sûr, Martha Walker, figure maternelle pour Juliette, qui a passé les 25 dernières années dans son atelier, incapable d’en franchir la porte (représentation de l’agoraphobie ? on dirait bien !). Ce sont des protagonistes, bon, déjà, féminines… intéressant ! Mais surtout des protagonistes vivant de toute évidence à la marge, ce qui paradoxalement leur confère une capacité à voir ce qui est invisible aux autres. Humainement, politiquement, historiquement… ce sont des femmes qui savent lire au-delà de leur propre destinée ; qui l’ont interrompue, en un sens, pour préserver ce qu’elles savent. Enfermées dans des petits espaces, leur vue est large, et perçante. Salvatrice.
Dans ce monde vivant déjà en vase clos, on trouve aussi l’idée (certes courante en matière de dystopie) de milieux sociaux qui ne se mélangent pas : Up Top, les Mids et Down Deep restent des mondes également refermés sur eux-mêmes. On y méprise les autres groupes allègrement. Cet enfermement est à la fois une question de classe, et une question d’espace, une barrière physique invisible représentée par les immenses escaliers du Silo. L’ascension (ha !) sociale est quasi-inexistante. On le voit avec la maire Jahns, qui n’a pas changé d’étage depuis des années, faute d’être capable à son âge d’entreprendre le voyage. Les deux problématiques sont imbriquées dans la conception-même du Silo, et dans son fonctionnement utilitariste.
Cet enfermement non pas dans le Silo, mais dans des sous-groupes du Silo, explique d’ailleurs pas mal le taux de suicide. Il se manifeste par des demandes à sortir du Silo… soit par un geste désespéré, par-dessus une rambarde de ses immenses escaliers. Mais la vie du Silo continue.
Tant de douleurs sont infligées au nom du bien commun…
Attention : les spoilers sur la fin de la saison commencent après la prochaine image.

En un sens, ce qui rend Juliette différente, ce n’est pas tant d’être la première à apprendre la vérité. Pour beaucoup de choses, elle ne l’est d’ailleurs pas, mais devient simplement la dépositaire d’un savoir entretenu par ses aînées enfermées. Non, ce qui la distingue, c’est d’être une voyageuse. On parle de quelqu’un qui dés ses 13 ans a entrepris de quitter un milieu plutôt confortable (elle est fille de gynécologue obstétrique dans les Mids) partir pour Mechanical (la section technique de Down Deep). Lorsque la série s’intéresse à elle à partir de l’épisode 3, elle part pour Up Top à la faveur d’une promotion inattendue, qui d’ailleurs laisse tout le monde circonspect au moins temporairement. On ne manquera pas de le lui faire remarquer.
Ce qui rend Juliette différente, ce n’est pas ce qu’elle sait, c’est sa capacité à n’avoir pas peur de sortir de ce à quoi elle devrait être limitée.
De ce point de vue là, et de beaucoup d’autres, la conclusion de la première saison de Silo est tout-à-fait logique : il était assez évident que Juliette allait être la première personne à survivre à une sortie du Silo. Et, encore une fois, c’est plutôt prévisible lorsqu’on prête attention à la réalisation de l’épisode 2. Le cliffhanger, cependant, est plus surprenant… et représente une large part de ma frustration.
« We do not know why we are here. We do not know who built the Silo. We do not know why everything outside the Silo is as it is. We do not know when it will be safe to go outside. We only know that day is not this day« .
…et à la fin de la saison, on ne le sait toujours pas ! On n’a répondu à absolument aucune de ces questions ! Peut-être parce que ces mots ouvrent la série dans le monologue introductif du shérif Becker lisant le Pact, je m’imaginais que, bon, on n’aurait certainement pas toutes les clés, mais l’intrigue progresserait dans ce sens. On gagnerait quelque chose. Des miettes, au moins.
Le premier épisode le suggérait. Le second, un peu déroutant, le suggérait quand même. Le troisième ? Plus du tout. A partir de là, la saison a tout un ventre mou pendant lequel les conspirations, les quêtes de vérité individuelles (qui a tué qui et pourquoi et qui est impliqué et comment), ainsi que les intrigues secondaires voire tertiaires, occupent tout l’espace confiné du Silo. Pour finalement nous délivrer une conclusion qui répond à ces questions par… un status quo ! Ce qu’on nous dit être le monde en-dehors du Silo est effectivement le monde en-dehors du Silo ! Pour moi qui me disais, vu que je ne reconnaissais aucune constellation, que le Silo n’était peut-être même pas sur Terre, je suis tombée de haut par cette révélation qui n’en est pas vraiment une ; je m’attendais vraiment à un twist plus impressionnant.
La seule question à laquelle Silo répond dans son season finale, tentant de provoquer la surprise… c’est la question à propos de laquelle elle nous avait volontairement induites en erreur.
C’est frustrant. Alors certes, cette révélation, cette confirmation devrais-je dire, que le monde est effectivement dévasté arrive juste avant le twist final du cliffhanger. Et en l’occurrence, je n’avais pas imaginé qu’il pouvait y avoir plus d’un silo ; je m’imaginais au mieux d’autres humaines, hors du Silo. Là, clairement, il y en a des dizaines.
Soyons claires : en matière de perspectives d’avenir, ça peut être intéressant : si la série le veut, elle peut très bien ne pas du tout utiliser notre Silo connu pour tout ou partie des intrigues futures (la saison 2 étant déjà commandée). Mais les questions subsistent. Elles s’accumulent, même. Pourquoi ces silos ? Ont-ils tous le même fonctionnement (on pensera à Fallout ou ARK: Survival Evolved) ? Leur Histoire enregistrée est-elle uniformément limitée à 140 ans, ou la Rebellion est-elle un événement qui n’a eu lieu que dans notre Silo ? Dans quelle mesure est-ce une expérimentation, une forme d’ingénierie sociale encore plus large, et dans quelle mesure le destin de ce silo a-t-il évolué de façon unique et organique ? On ne sait pas. On ne sait rien. On sait juste que du coup, l’idée que tous les moyens sont bons pour assurer la sécurité des « 10 000 uniques survivantes » du Silo est rendue caduque en l’espace d’un seul plan, puisqu’il en reste sûrement bien plus (en admettant que les autres silos soient toujours fonctionnels).
A part ça, on en sait autant qu’au début de la série. Vous admettrez qu’on ne regarde pas 10 épisodes pour ne rien apprendre.
Un peu à contrecœur, j’ai l’impression d’avoir perdu du temps. Un peu, seulement, parce que comme j’ai eu laaargement l’occasion de le démontrer, Silo n’est pas une mauvaise série. Elle prend la mise en place de son univers au sérieux (hein Ascension ?), elle prend ses personnages au sérieux, elle prend plusieurs de ses thèmes au sérieux. Cela étant, pour une série reposant en grande partie sur un mystère et une mythologie brumeuse, on est un peu sur du Lost pour le moment.
Cette phase de piétinement n’a aucune raison de subsister en saison 2 ; mais si ce devait être le cas, je serais d’autant plus sévère.


Lire la suite »

 Cet exil forcé, évidemment, n’est pas une partie de plaisir. Et Seishuu est en plus un citadin dans l’âme. Quand il débarque dans le Sud du pays, il est épaté d’apprendre que le village est à 4h de marche de l’aéroport, et qu’il y a, genre, quatre bus par jours pour faire la navette. Les péripéties pour se rendre à bon port ne vont donc pas spécialement le mettre de bonne humeur… Il est accueilli dans une petite maison traditionnelle qui a été mise à sa disposition, et très vite, il comprend où il a mis les pieds.
Cet exil forcé, évidemment, n’est pas une partie de plaisir. Et Seishuu est en plus un citadin dans l’âme. Quand il débarque dans le Sud du pays, il est épaté d’apprendre que le village est à 4h de marche de l’aéroport, et qu’il y a, genre, quatre bus par jours pour faire la navette. Les péripéties pour se rendre à bon port ne vont donc pas spécialement le mettre de bonne humeur… Il est accueilli dans une petite maison traditionnelle qui a été mise à sa disposition, et très vite, il comprend où il a mis les pieds. Si Seishuu a un ego plus vaste que l’océan, il est aussi vaguement conscient de devoir sa position sociale, dans son cercle professionnel, à ce que l’on appellera pudiquement « des circonstances ». Il est né d’un calligraphe célèbre, a été formé par lui, et aujourd’hui on ne peut nier que l’influence de son père, au moins indirecte, lui vaut d’avoir été remarqué. S’il était parti de rien, Seishuu aurait-il pu aller aussi loin ? Aurait-il seulement choisi la calligraphie, d’ailleurs ? La question se pose, et en particulier elle se pose à Seishuu, d’une manière forcément déplaisante. C’est bien là toute la raison de son implosion en plein vol pendant la cérémonie de récompense, après tout : entendre de la bouche d’un expert l’expression de ses pires doutes était la pire chose qui puisse lui arriver.
Si Seishuu a un ego plus vaste que l’océan, il est aussi vaguement conscient de devoir sa position sociale, dans son cercle professionnel, à ce que l’on appellera pudiquement « des circonstances ». Il est né d’un calligraphe célèbre, a été formé par lui, et aujourd’hui on ne peut nier que l’influence de son père, au moins indirecte, lui vaut d’avoir été remarqué. S’il était parti de rien, Seishuu aurait-il pu aller aussi loin ? Aurait-il seulement choisi la calligraphie, d’ailleurs ? La question se pose, et en particulier elle se pose à Seishuu, d’une manière forcément déplaisante. C’est bien là toute la raison de son implosion en plein vol pendant la cérémonie de récompense, après tout : entendre de la bouche d’un expert l’expression de ses pires doutes était la pire chose qui puisse lui arriver.




















 La mise en place de Sweet Kaaram Coffee n’est pas seulement efficace en diable, elle établit aussi des choses très intéressantes sur ses protagonistes, et sur son ton. Aspirant à de la légèreté, la série superpose des dialogues enlevés, un sens du montage particulièrement aiguisé, et un soundtrack omniprésent, pour nous assurer de ses intentions : on veut nous voir sourire. Que l’aspect dramédique ne vous induise pas en erreur, toutefois : derrière le côté très grand public de sa réalisation, la série a une jolie âme, et une volonté de fer lorsqu’il s’agit de détailler les nuances de ses protagonistes.
La mise en place de Sweet Kaaram Coffee n’est pas seulement efficace en diable, elle établit aussi des choses très intéressantes sur ses protagonistes, et sur son ton. Aspirant à de la légèreté, la série superpose des dialogues enlevés, un sens du montage particulièrement aiguisé, et un soundtrack omniprésent, pour nous assurer de ses intentions : on veut nous voir sourire. Que l’aspect dramédique ne vous induise pas en erreur, toutefois : derrière le côté très grand public de sa réalisation, la série a une jolie âme, et une volonté de fer lorsqu’il s’agit de détailler les nuances de ses protagonistes.

 Hartklop n’a pas nécessairement inventé grand’chose… mais dans le domaine de la série hospitalière, je ne suis pas sûre que ce soit possible d’innover beaucoup. Bon, enfin, ce n’est pas impossible, mais admettez qu’après 712 millions d’épisodes de grandes séries médicales étasuniennes ET locales (genre Hillside, Jozi-H, Durban Gen ou Wounds), ça devient tendu. En fait, je ne suis même pas convaincue que ce soit souhaitable ! Les séries médicales sont avant tout des séries dramatiques basées sur l’émotion, rarement des fictions où le concept importe beaucoup. Il y a une raison pour laquelle, historiquement (et encore à ce jour), le soap opera se mêle bien de médical : on est bien souvent dans le même registre. C’est simplement qu’aux émotions soulevées traditionnellement par le soap, vient s’ajouter régulièrement de l’adrénaline.
Hartklop n’a pas nécessairement inventé grand’chose… mais dans le domaine de la série hospitalière, je ne suis pas sûre que ce soit possible d’innover beaucoup. Bon, enfin, ce n’est pas impossible, mais admettez qu’après 712 millions d’épisodes de grandes séries médicales étasuniennes ET locales (genre Hillside, Jozi-H, Durban Gen ou Wounds), ça devient tendu. En fait, je ne suis même pas convaincue que ce soit souhaitable ! Les séries médicales sont avant tout des séries dramatiques basées sur l’émotion, rarement des fictions où le concept importe beaucoup. Il y a une raison pour laquelle, historiquement (et encore à ce jour), le soap opera se mêle bien de médical : on est bien souvent dans le même registre. C’est simplement qu’aux émotions soulevées traditionnellement par le soap, vient s’ajouter régulièrement de l’adrénaline.
 La brûlure ardente suit Lidia partout où elle va. Même quand, au culot, elle parvient à entrer quelque part où elle n’était pas la bienvenue, cela ne la quitte pas. Il n’y a pas vraiment de victoire à s’être introduite dans l’univers des hommes ; il n’y a que l’amertume de savoir qu’on y aurait eu toute sa place si les choses étaient plus justes.
La brûlure ardente suit Lidia partout où elle va. Même quand, au culot, elle parvient à entrer quelque part où elle n’était pas la bienvenue, cela ne la quitte pas. Il n’y a pas vraiment de victoire à s’être introduite dans l’univers des hommes ; il n’y a que l’amertume de savoir qu’on y aurait eu toute sa place si les choses étaient plus justes. Elle ne peut certainement pas compter sur Enrico, en tout cas. Quant à sa belle-sœur Teresa, une femme conservatrice, voit par exemple d’un mauvais œil le comportement de Lidia (« Si Dieu voulait que tu sois avocat, il ne t’aurait pas faite femme », lui dira-t-elle, m’évoquant accidentellement un dialogue de la première saison de The Great ; ça n’est jamais une mauvaise chose !). Elle craint, en outre, que celle-ci ne déteigne sur Marianna, encore jeune et impressionnable. Cela conduira à quelques frictions… Hélas, dans La legge di Lidia Poët, la sororité n’existe pas. En fait, à sa grande surprise, Lidia Poët trouve le plus grand soutien auprès de deux hommes : son amant Andrea, et… Jacopo, qui s’avère plus progressiste que sa sœur. A ses côtés, elle n’est pas jugée, et il lui vient en aide professionnellement autant qu’il le peut.
Elle ne peut certainement pas compter sur Enrico, en tout cas. Quant à sa belle-sœur Teresa, une femme conservatrice, voit par exemple d’un mauvais œil le comportement de Lidia (« Si Dieu voulait que tu sois avocat, il ne t’aurait pas faite femme », lui dira-t-elle, m’évoquant accidentellement un dialogue de la première saison de The Great ; ça n’est jamais une mauvaise chose !). Elle craint, en outre, que celle-ci ne déteigne sur Marianna, encore jeune et impressionnable. Cela conduira à quelques frictions… Hélas, dans La legge di Lidia Poët, la sororité n’existe pas. En fait, à sa grande surprise, Lidia Poët trouve le plus grand soutien auprès de deux hommes : son amant Andrea, et… Jacopo, qui s’avère plus progressiste que sa sœur. A ses côtés, elle n’est pas jugée, et il lui vient en aide professionnellement autant qu’il le peut.

 On en oublierait presque ces histoires d’armoire magique, mais je vous rassure, on va y venir. Car au fil de l’épisode, Carol commence à voir apparaître Kyung, la star principale d’ACT, le « all rounder » qui sait tout faire mais qui garde une part de mystère, le danseur infaillible qui, récemment, a justement failli. Il lui apparaît dans sa chambre comme si c’était la chose la plus naturelle du monde, et Carol, qui a bien assez de soucis comme ça, décide dans un premier temps qu’il s’agit d’une hallucination. Vous vous doutez bien qu’on ne ferait pas toute une série s’il s’agissait réellement d’une hallucination ! Il semblerait que Kyung soit bel et bien en train d’entrer via la porte de la large armoire en bois, tapie dans le fond de sa chambre, dont elle a accidentellement brisé le miroir au début de l’épisode.
On en oublierait presque ces histoires d’armoire magique, mais je vous rassure, on va y venir. Car au fil de l’épisode, Carol commence à voir apparaître Kyung, la star principale d’ACT, le « all rounder » qui sait tout faire mais qui garde une part de mystère, le danseur infaillible qui, récemment, a justement failli. Il lui apparaît dans sa chambre comme si c’était la chose la plus naturelle du monde, et Carol, qui a bien assez de soucis comme ça, décide dans un premier temps qu’il s’agit d’une hallucination. Vous vous doutez bien qu’on ne ferait pas toute une série s’il s’agissait réellement d’une hallucination ! Il semblerait que Kyung soit bel et bien en train d’entrer via la porte de la large armoire en bois, tapie dans le fond de sa chambre, dont elle a accidentellement brisé le miroir au début de l’épisode. 



 En-dehors de ça, le microcosme du Silo obéit principalement à deux règles fondamentales : ne jamais instaurer d’outils d’automatisation de la montée/descente de l’immense escalier central du Silo, qui est le seul moyen de traverser les étages ; et une limitation technologique, notamment en matière de miniaturisation et plus largement d’informatique. Ces deux tabous principaux sont en fait l’expression d’une interdiction plus importante, mais généralement tue : les objets issus de la civilisation avant la Rebellion, et avant le Silo, même, sont interdits. Cela étant, il s’échangent à l’occasion sous le manteau, sous l’appellation de reliques.
En-dehors de ça, le microcosme du Silo obéit principalement à deux règles fondamentales : ne jamais instaurer d’outils d’automatisation de la montée/descente de l’immense escalier central du Silo, qui est le seul moyen de traverser les étages ; et une limitation technologique, notamment en matière de miniaturisation et plus largement d’informatique. Ces deux tabous principaux sont en fait l’expression d’une interdiction plus importante, mais généralement tue : les objets issus de la civilisation avant la Rebellion, et avant le Silo, même, sont interdits. Cela étant, il s’échangent à l’occasion sous le manteau, sous l’appellation de reliques.


 On trouve ainsi un autre thème fascinant dans les différentes intrigues de la série : l’idée d’un confinement dans le confinement. Plusieurs protagonistes secondaires de Silo vivent en effet un enfermement supplémentaire ; là où les 10 000 humaines du Silo n’en sont jamais sorties (ou alors pour mourir dehors, à peine quelques mètres plus loin), plusieurs sont les personnages qui s’enferment encore plus dans leurs quartiers. Mentionnons par exemple Regina, l’ex de George, qui vit calfeutrée dans son appartement avec son chat, se faisant délivrer des plateaux à manger. Il y a aussi Gloria, la conseillère en fertilité qui se retrouve internée en cours de saison. Et puis bien-sûr, Martha Walker, figure maternelle pour Juliette, qui a passé les 25 dernières années dans son atelier, incapable d’en franchir la porte (
On trouve ainsi un autre thème fascinant dans les différentes intrigues de la série : l’idée d’un confinement dans le confinement. Plusieurs protagonistes secondaires de Silo vivent en effet un enfermement supplémentaire ; là où les 10 000 humaines du Silo n’en sont jamais sorties (ou alors pour mourir dehors, à peine quelques mètres plus loin), plusieurs sont les personnages qui s’enferment encore plus dans leurs quartiers. Mentionnons par exemple Regina, l’ex de George, qui vit calfeutrée dans son appartement avec son chat, se faisant délivrer des plateaux à manger. Il y a aussi Gloria, la conseillère en fertilité qui se retrouve internée en cours de saison. Et puis bien-sûr, Martha Walker, figure maternelle pour Juliette, qui a passé les 25 dernières années dans son atelier, incapable d’en franchir la porte (