Ce n’est pas tous les jours, et c’est heureux, qu’on voit des séries sur la militarisation de la jeunesse. La Corée du Sud nous en a pourtant fourni un exemple, et elle sait de quoi elle parle, en ce printemps avec Banggwa Hoo Jeonjaenghwaldong. Vous avez peut-être entendu parler d’elle sous son titre anglophone, Duty After School, qui apparemment est également le titre international du webtoon qui l’a inspirée.
Sa première saison, proposée sous la forme de deux parties, diffusées l’une en mars et l’autre en avril, s’appuie sur plusieurs genres. Teen drama, série de science-fiction, série militaire, horreur même… tout se mélange.
Pour être honnête, j’étais partagée quant à l’idée de démarrer cette série. D’abord parce que je craignais la redondance : sur le papier, il me semblait que Banggwa Hoo Jeonjaeng Hwaldong n’était qu’une transposition à un genre différent de ce qui avait fait la (relative) popularité de Jigeum Uri Hakgyoneun quelques mois plus tôt. Troquer des zombies contre des aliens ? Ok, rien de nouveau sous le soleil. Mais… mais d’un autre côté, je ne sais pas résister à de la science-fiction militaire, l’un de mes sous-genres favoris. L’un des sous-genres qui m’a fait aimer les séries, en fait. Donc, eh bien…

Banggwa Hoo Jeonjaeng Hwaldong démarre au sein de la classe 3-2, en dernière année de lycée. C’est principalement le point de vue de Kim Chi Yeol qui nous sert de point d’entrée : le jeune homme, un peu introverti, observe de loin l’activité de la classe : les filles populaires (et notamment la jolie Lee Na Ra), celles qui le sont moins (comme No Ae Seol), les têtes de classe (l’intello solitaire Jang Young Hoon), les responsables (la déléguée Kim Yoo Jung), les pitres (à l’instar de l’exubérant Woo Hee Rak) ou encore les bourreaux harceleurs (Kwon Il Ha étant résolument le pire). Une classe normale. Parfaitement normale. Etonnamment normale, en fait, vu les circonstances : un an plus tôt, d’étranges sphères violacées sont apparues, suspendues dans l’atmosphères terrestres, immobiles.
Il est difficile de ne pas voir dans Banggwa Hoo Jeonjaeng Hwaldong une métaphore de l’épée de Damoclès qui pend, à ce jour encore, au-dessus des adolescentes sud-coréennes, comme le font ces sphères alien qui ont débarqué avant que la série ne commence. Le pays est toujours menacé par la Corée du Nord, quand bien même ce conflit ne ressemble pas nécessairement à l’idée qu’on se fait d’une guerre ouverte (ce qui se passe en Ukraine, par exemple). Quelque chose que les jeunes ne peuvent oublier, vu l’ampleur du service militaire dans leurs vies à tous les égards. Banggwa Hoo Jeonjaeng Hwaldong se contente d’employer la science-fiction pour pousser cette logique plus loin, et de se demander : que se passerait-il si cette militarisation de la société sud-coréenne devait s’accentuer encore ? Et, en particulier, si elle devait concerner la jeunesse encore plus qu’aujourd’hui ?
Ainsi, la vie a continué sous les objets violets dans le ciel. Le premier épisode dépeint une vie normale en-dehors de ce rappel incongru : le lycée, les cours particuliers, les amourettes, et les plaisanteries… L’existence de toutes s’est ajustée à la réalité. Pourtant, celle-ci est sous la menace de nouveaux ajustements, déplaçant une fois encore le curseur de ce qui est normal pour toute une classe d’âge en forçant les lycéennes à suivre un entraînement militaire. Alors, bon, « forcer » peut paraître exagéré : un formulaire leur a été remis, ce n’est pas obligatoire. Mais en offrant des crédits supplémentaires dans la course scolaire, l’institution éducative et militaire sait bien ce qu’elle fait. Et hors de question de faire l’impasse sur quelques points supplémentaires, quand l’avenir universitaire et donc l’avenir tout court se joue parfois à trois fois rien !
L’entraînement militaire par lequel, du jour au lendemain, la classe 3-2 est forcée de passer, souligne à quel point ces adolescentes n’étaient pas prêtes pour tout cela. Et pourquoi l’auraient-elles été, d’ailleurs ? Leur condition physique est à plusieurs reprises soulignée par des grimaces d’incompréhension, de douleur, d’épuisement. Leur incapacité à comprendre la discipline militaire, également, est reprise plusieurs fois. Mais si la série, parfois, s’en amuse, elle ne la critique pas. Ce n’est pas une façon de dire que les jeunes, de nos jours, sont si dissipées et molles qu’il leur faudrait une bonne guerre. C’est au contraire une façon de démontrer combien leur innocence a été rompue brutalement.
Cette brutalité ne fait pourtant que commencer, alors que les fameuses sphères violettes changent de comportement. La seconde partie du deuxième épisode entre dans le vif du sujet, opérant un tournant qui emprunte plus aux codes horrifiques qu’à la fiction de guerre. Les paniques successives, le décompte de plus en plus élevé de victimes humaines (dans l’école et… en-dehors), la terrifiante impression que rien ne peut être fait pour arrêter la catastrophe, font bientôt basculer Banggwa Hoo Jeonjaeng Hwaldong dans une atmosphère post-apocalyptique. Bientôt, l’entraînement cède la place à l’urgence, et avec elle, la survie ; la série a la bonne idée de ne pas rester dans l’enceinte du lycée, ce qui certes, met en pause les questionnements sur le rôle des institutions (et donc des adultes) dans le sort des adolescentes embrigadées, mais permet à l’intrigue de ne pas s’enliser.
Ainsi, la « classe 3-2 » devient le « peloton 2 ». De lycéennes, ses jeunes héroïnes deviennent réservistes, et finalement soldates. Les mois s’éffilochent et les horreurs s’accumulent sous leurs yeux.
Banggwa Hoo Jeonjaeng Hwaldong s’interroge au nom de ses jeunes protagonistes (et spectatrices) : « et nous, dans tout cela ? » ; si peu de personnages adultes s’en soucient. Qu’advient-il de nos joies, nos peines, nos loisirs, nos centres d’intérêt, nos amours, nos espoirs ? Notre futur ? Quel est le projet pour nous, quand nous subissons ce monde qui s’écroule et qu’il nous faut prendre des précautions dont nos aînées ont été incapables, dans l’urgence ? Bon, inutile de préciser que cette interrogation n’a rien de purement sud-coréenne.
 Au fil de son histoire, découpée en arcs brefs mais vifs de deux épisodes chacun (donc trois arcs dans la première partie, deux arcs dans la seconde), Banggwa Hoo Jeonjaeng Hwaldong adresse tous les sujets courants dans ce type de fiction ; ce n’est pas original, mais c’est efficace. Par moments, l’évolution du peloton 3-2 emprunte des chemins extrêmement banalisés (mais pour quelqu’un qui a regardé l’intégralité de Falling Skies, il n’y a pas vraiment raison de se plaindre). Comme dans les meilleures séries de guerre (et plusieurs autres), la guerre y est montrée comme absurde en plus de violente.
Au fil de son histoire, découpée en arcs brefs mais vifs de deux épisodes chacun (donc trois arcs dans la première partie, deux arcs dans la seconde), Banggwa Hoo Jeonjaeng Hwaldong adresse tous les sujets courants dans ce type de fiction ; ce n’est pas original, mais c’est efficace. Par moments, l’évolution du peloton 3-2 emprunte des chemins extrêmement banalisés (mais pour quelqu’un qui a regardé l’intégralité de Falling Skies, il n’y a pas vraiment raison de se plaindre). Comme dans les meilleures séries de guerre (et plusieurs autres), la guerre y est montrée comme absurde en plus de violente.
Sauf qu’ici en particulier, on ne questionne pas sa raison d’être : les sphères SONT dangereuses et l’invasion n’a, a priori, pas été provoquée. Ce qui rend la guerre absurde n’est, à aucun moment, son motif, la défense des vies humaines tombant sous le sens, mais son mode de recrutement. Banggwa Hoo Jeonjaeng Hwaldong dénonce la façon dont les vies des jeunes sont déconsidérées. Le terme de « chair à canon » prend ici tout son sens, et évidemment le fait que cette chair à canon soit mineure au début de l’intrigue joue un rôle prépondérant dans le propos. Au risque de me répéter, il n’est pas rare dans les séries adolescentes de tenir un discours sur l’absence de fiabilité des générations précédentes (l’officier Lee et son adjoint Kim, les deux soldats formant puis accompagnant le peloton 3-2, sont les seuls auxquels on peut faire confiance… et ce sont des anticonformistes). Ce thème est de toute évidence important pour la génération qui est principalement visée par la série, et il est ici bien exploité, parce qu’il s’imbrique parfaitement dans les questions de responsabilité de vie ou de mort.
Toutefois Banggwa Hoo Jeonjaeng Hwaldong veut aussi aller au-delà, et c’est un aspect vraiment intéressant de son propos, entre deux scènes d’action ou de teenageries : elle interroge le système qui encourage les jeunes à risquer leur vie… sous le prétexte de l’améliorer. Le fait que la vie de ces jeunes ploie sous la pression de ces examens, ça, c’est un problème. Le fait que quelques points de plus pour le concours d’entrée à l’université soit puisse inciter des gosses à accepter un entrainement militaire, ça, c’est un problème. Et le fait que des adolescentes se retrouvent à brader leur innocence au nom d’un avenir qui ne leur est même pas garanti, ça, c’est un problème. Quand elle parle de tout cela, Banggwa Hoo Jeonjaeng Hwaldong en parle incroyablement bien, avec un propos vraiment rare, et précieux. Et sa conclusion tente d’essayer de s’efforcer d’effleurer la dimension socio-économique de la problématique, aussi… avec plus ou moins de bonheur.
« Pourquoi les adultes nous ont-elles donné des armes ? Elles auraient dû nous empêcher de les tenir » ! Le sentiment de trahison progresse à mesure que les horreurs défilent. Les jeunes recrues de Banggwa Hoo Jeonjaeng Hwaldong comprennent (mais trop tard) qu’on les a sacrifiées. Le rôle des adultes était de les protéger non en leur donnant des armes, mais plutôt en leur permettant de vivre leur jeunesse pleinement, et joyeusement. De faire l’impossible pour que leur seul souci dans la vie reste le lycée, les cours particuliers, les amourettes, et les plaisanteries.
Parfois difficile à regarder, surtout dans les premières interactions avec les « sphères » (qui en fait ne sont pas sphériques tout le temps… d’ailleurs les effets spéciaux sont vraiment très bons), n’hésitant pas à employer des jump scares et ne reculant pas devant les atrocités (je ne m’attendais pas autant à des prises de vue de corps mutilés, mais on en est là), nerveuse dans ses scènes d’action parce que, quelque soit le degré de maîtrise des armes, il reste toujours un fond de panique… Banggwa Hoo Jeonjaeng Hwaldong aurait pu être l’un de mes coups de cœur de l’année. Elle m’aurait suffisamment tenue éveillée pour obtenir ce titre.
Seulement voilà, deux choses l’en empêchent. Et ce ne sont pas des petits empêchements.
D’abord, la seconde partie (celle diffusée en avril) est vraiment, vraiment en-dessous de la première (celle de mars). Honnêtement, on est à la limite de l’accident de parcours. A la rigueur, j’aurais compris le premier arc d’avril si la série n’avait pas eu de conclusion, et que Banggwa Hoo Jeonjaeng Hwaldong espérait revenir pour une nouvelle saison d’ici un an ou deux. Or, comme la série a bel et bien une fin (et oh, croyez-moi, j’y reviens !), on a plutôt le sentiment de jouer les prolongations pour faire du remplissage. Le passage à la prison ? Non mais sérieusement, ya rien qui tient. Sans parler de la kelleyrisation d’un personnage dans la deuxième partie de la série ; ça coûtait pourtant rien de le mentionner vite fait à des fins de continuité. Non vraiment, si vous voulez regarder la série, ya rien de mal à s’arrêter à la fin du 6e épisode et à totalement ignorer la seconde partie de Banggwa Hoo Jeonjaeng Hwaldong, même moi qui suis une puriste ne saurais vous le reprocher.
Et puis, surtout, je fais partie de celles (et on a l’air d’être assez nombreuses) interloquées par sa conclusion finale. Quand bien même… oui ok, admettons, elle fait sens, si on veut, on peut racler un peu et y trouver du fond… elle gâche quand même un peu la note générale de la série tant elle finit par brouiller le propos. Pire, cette conclusion nous est délivrée, avant de l’annuler, puis de la rétablir, puis l’amenuiser avec une… j’ose à peine vous le dire… séquence musicale finale ?! Je, euh, non, j’ai pas d’explication non plus. D’autant que la chanson ne dit rien que la série n’ait déjà dit plus tôt.
Si Banggwa Hoo Jeonjaeng Hwaldong n’était pas aussi effrayée par son sujet, ou au moins le ton de son sujet, ç’aurait pu être une très bonne série. Pas parfaite, mais bonne. Genre, facilement capable d’atterrir dans le Top10 de mon année, et je vous dis ça, on n’est même pas encore en juin. Elle avait toutes ses chances, mais cette seconde partie de saison, et la conclusion (pour ne pas dire la chute) ont pas mal ruiné de choses.
Pour autant, je maintiens ce que j’ai dit : Banggwa Hoo Jeonjaeng Hwaldong tient un propos rare sur la militarisation de la jeunesse, et à la portée dépassant largement les frontières coréennes. Donc je recommande quand même d’y jeter un oeil… si vous avez les tripes.


























 Là où j’ai le plus de mal, cependant, c’est sur le choix de Sara pour ouvrir la série. Cette histoire d’accident de voiture qui me semble compliquée, et pas vraiment en accord avec les autres intentions de la série. Ça fait un peu thriller au rabais, là où le reste des Randonneuses s’escrimait à poser les bases d’un human drama (ce n’est pas sale) aussi sincère que possible.
Là où j’ai le plus de mal, cependant, c’est sur le choix de Sara pour ouvrir la série. Cette histoire d’accident de voiture qui me semble compliquée, et pas vraiment en accord avec les autres intentions de la série. Ça fait un peu thriller au rabais, là où le reste des Randonneuses s’escrimait à poser les bases d’un human drama (ce n’est pas sale) aussi sincère que possible.
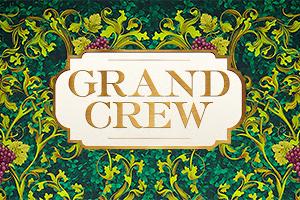 Grand Crew continue d’explorer comment ces personnages peuvent grandir… et en même temps, cultive une certaine idée de l’innocence. Une innocence mûre : elle n’est pas aveugle aux réalités de la vie, mais elle est préférable aux prises de tête. Le fameux « passage à l’âge adulte » que dépeint Grand Crew implique aussi, voire surtout, un plus grand confort financier, une palette de choix élargie, et des possibilités de goûter à un raffinement nouveau. Du coup c’est plus compliqué qu’à la vingtaine, et en même temps plus facile de trouver de la joie, et d’en exprimer toutes les facettes. Our multitudes got multitudes. Tout cela était présent dans la saison précédente, mais se retrouve renforcé par les intrigues de ce nouveau cru.
Grand Crew continue d’explorer comment ces personnages peuvent grandir… et en même temps, cultive une certaine idée de l’innocence. Une innocence mûre : elle n’est pas aveugle aux réalités de la vie, mais elle est préférable aux prises de tête. Le fameux « passage à l’âge adulte » que dépeint Grand Crew implique aussi, voire surtout, un plus grand confort financier, une palette de choix élargie, et des possibilités de goûter à un raffinement nouveau. Du coup c’est plus compliqué qu’à la vingtaine, et en même temps plus facile de trouver de la joie, et d’en exprimer toutes les facettes. Our multitudes got multitudes. Tout cela était présent dans la saison précédente, mais se retrouve renforcé par les intrigues de ce nouveau cru.
 Le personnage devient plus riche, acquiert des dimensions supplémentaires. Le rituel des petits déjeuners (la seule condition qu’il a posée à son abdication) l’oblige à se confronter à Catherine, à échanger avec elle aussi bien sur le plan de la légèreté que sur la complexité de leur relation (un peu comme les dîners du vendredi soir dans Gilmore Girls). Il y a en Peter une réelle volonté de travailler sur lui-même, et il semble petit-à-petit mieux comprendre ses propres limites ; The Great étudie son cheminement intérieur, et teste la sincérité de son changement. Elle semble aussi, imperceptiblement, continuer d’explorer la question de sa masculinité, qui même si les inclinations naturelles de Peter se contredisent parfois (violence extrême ET préciosité assumée) semblent peut-être indiquer que Peter est plus heureux quand il s’adonne à ce qui l’amuse ou l’excite, comme la nourriture, plutôt que lorsqu’il joue les bonhommes virils. En parallèle, il développe une intelligence stratégique rarement vue jusqu’à présent (et écoute mieux les conseils qu’on lui donne, aussi, notamment d’Elizabeth), et fait même le meilleur discours politique de sa vie alors qu’il est en captivité ! Sa joie pour la paternité, qu’il prend de plus en plus au sérieux et qu’il interroge d’autant plus qu’il semble mieux accepter que le rapport qu’il entretenait avec ses parents était néfaste, prend aussi une place intéressante qui termine de donner de la substance au personnage, a fortiori parce que même ses proches la trouvent souvent étrange. Tout ça sans jamais l’éloigner de son rôle d’olibrius obsédé par la bonne bouffe, le sexe et la violence, qui restent dans sa nature mais qu’il semble dompter comme jamais. Dompter… mais pas totalement abandonner ? C’est là tout le défi.
Le personnage devient plus riche, acquiert des dimensions supplémentaires. Le rituel des petits déjeuners (la seule condition qu’il a posée à son abdication) l’oblige à se confronter à Catherine, à échanger avec elle aussi bien sur le plan de la légèreté que sur la complexité de leur relation (un peu comme les dîners du vendredi soir dans Gilmore Girls). Il y a en Peter une réelle volonté de travailler sur lui-même, et il semble petit-à-petit mieux comprendre ses propres limites ; The Great étudie son cheminement intérieur, et teste la sincérité de son changement. Elle semble aussi, imperceptiblement, continuer d’explorer la question de sa masculinité, qui même si les inclinations naturelles de Peter se contredisent parfois (violence extrême ET préciosité assumée) semblent peut-être indiquer que Peter est plus heureux quand il s’adonne à ce qui l’amuse ou l’excite, comme la nourriture, plutôt que lorsqu’il joue les bonhommes virils. En parallèle, il développe une intelligence stratégique rarement vue jusqu’à présent (et écoute mieux les conseils qu’on lui donne, aussi, notamment d’Elizabeth), et fait même le meilleur discours politique de sa vie alors qu’il est en captivité ! Sa joie pour la paternité, qu’il prend de plus en plus au sérieux et qu’il interroge d’autant plus qu’il semble mieux accepter que le rapport qu’il entretenait avec ses parents était néfaste, prend aussi une place intéressante qui termine de donner de la substance au personnage, a fortiori parce que même ses proches la trouvent souvent étrange. Tout ça sans jamais l’éloigner de son rôle d’olibrius obsédé par la bonne bouffe, le sexe et la violence, qui restent dans sa nature mais qu’il semble dompter comme jamais. Dompter… mais pas totalement abandonner ? C’est là tout le défi. Celle-ci arrive à se rendre finement incontournable pour Catherine, d’abord en l’aidant dans sa grossesse, puis dans ses cas de conscience avec Peter, et finalement dans les affaires de l’empire. Et pourtant elle est aussi imprévisible ; la gentille tante est, l’air de rien, une joueuse de talent lorsqu’il s’agit de politique ! Elle a su se mettre à l’écart le temps que la guerre civile trouve une issue, elle a su se rapprocher de Catherine, elle a su l’influencer vis-à-vis de Peter, et même avec son propre neveu, on ne sait pas toujours si elle ménage les sentiments de Peter comme un enfant, ou si elle prépare vraiment un plan B. Elle n’est pas tombée de la dernière pluie. Il y a clairement des moments pendant lesquels elle semble apprécier le pouvoir de suggestion qu’elle a acquis sous le règne de Catherine, et que c’est une promotion pour elle par rapport à ce que Peter lui laissait, c’est-à-dire le royaume de la luxure et de l’absurde. Mais son soutien à Catherine est intéressant, et apparaît comme sincère, parce qu’il passe par un conseil avisé (Elizabeth est très attentive à la survie de la dynastie, outre son lourd traumatisme vis-à-vis des enfants) différent de celui de Marial.
Celle-ci arrive à se rendre finement incontournable pour Catherine, d’abord en l’aidant dans sa grossesse, puis dans ses cas de conscience avec Peter, et finalement dans les affaires de l’empire. Et pourtant elle est aussi imprévisible ; la gentille tante est, l’air de rien, une joueuse de talent lorsqu’il s’agit de politique ! Elle a su se mettre à l’écart le temps que la guerre civile trouve une issue, elle a su se rapprocher de Catherine, elle a su l’influencer vis-à-vis de Peter, et même avec son propre neveu, on ne sait pas toujours si elle ménage les sentiments de Peter comme un enfant, ou si elle prépare vraiment un plan B. Elle n’est pas tombée de la dernière pluie. Il y a clairement des moments pendant lesquels elle semble apprécier le pouvoir de suggestion qu’elle a acquis sous le règne de Catherine, et que c’est une promotion pour elle par rapport à ce que Peter lui laissait, c’est-à-dire le royaume de la luxure et de l’absurde. Mais son soutien à Catherine est intéressant, et apparaît comme sincère, parce qu’il passe par un conseil avisé (Elizabeth est très attentive à la survie de la dynastie, outre son lourd traumatisme vis-à-vis des enfants) différent de celui de Marial. Cela s’illustre par exemple par le problème de la libération des serfs. L’impératrice se réjouit de cette décision humaniste (…quoique prise sous la pression), mais se confronte aux faits : la noblesse russe est vent debout contre cette mesure, et au bord de la révolte. Plus que des compromis, Catherine doit finalement affronter une défaite et reculer après avoir essayé d’imprimer un changement conséquent.
Cela s’illustre par exemple par le problème de la libération des serfs. L’impératrice se réjouit de cette décision humaniste (…quoique prise sous la pression), mais se confronte aux faits : la noblesse russe est vent debout contre cette mesure, et au bord de la révolte. Plus que des compromis, Catherine doit finalement affronter une défaite et reculer après avoir essayé d’imprimer un changement conséquent. Cette saison, plus encore que la précédente (mais en utilisant les graines alors plantées), tient un discours formidable sur le rapport à des parents maltraitants ou toxiques, notamment. Catherine est prise de crises d’angoisse et d’urticaire, dont on comprend à demi-mots qu’elle était coutumière avant d’arriver en Russie, et qui réapparaissent à l’arrivée de Joanna en Russie. Elle tente d’impressionner une mère… qui ne le sera jamais, ou du moins pas par ce qui compte. Lorsque Catherine réalise que Joanna, avec laquelle elle pense avoir une relation si aimante et parfaite (qui se manifeste par toutes sortes de private jokes, notamment), la méprise en réalité, et la considère comme une déception, c’est violent. Cette réalisation dévastatrice que nos parents ne sont pas toujours telles qu’on les croyait, ou, pire, telles qu’on les espérait, c’est une grande part de ce qui se dit dans cette saison.
Cette saison, plus encore que la précédente (mais en utilisant les graines alors plantées), tient un discours formidable sur le rapport à des parents maltraitants ou toxiques, notamment. Catherine est prise de crises d’angoisse et d’urticaire, dont on comprend à demi-mots qu’elle était coutumière avant d’arriver en Russie, et qui réapparaissent à l’arrivée de Joanna en Russie. Elle tente d’impressionner une mère… qui ne le sera jamais, ou du moins pas par ce qui compte. Lorsque Catherine réalise que Joanna, avec laquelle elle pense avoir une relation si aimante et parfaite (qui se manifeste par toutes sortes de private jokes, notamment), la méprise en réalité, et la considère comme une déception, c’est violent. Cette réalisation dévastatrice que nos parents ne sont pas toujours telles qu’on les croyait, ou, pire, telles qu’on les espérait, c’est une grande part de ce qui se dit dans cette saison.










