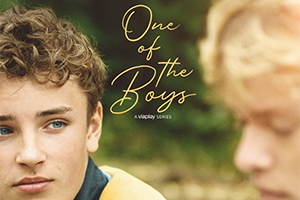Une nouvelle édition lilloise de Series Mania s’est écoulée et, faute de pouvoir y assister en chair et en os, j’ai au moins pu regarder ce qui se passait du côté de Series Mania+, la plateforme de visionnage permettant de rattraper une partie du festival.
Un système encore imparfait (il y a une série dont j’ai perdu la trace en cours de route !), et qui, bien-sûr, même s’il était parfait, serait encore largement incomplet (ne serait-ce qu’à cause des avant-premières les plus prestigieuses qui elles, naturellement, ne sont pas mises en ligne). De toute façon, sans même parler de la question du catalogue réservé à la presse et aux professionnels, auquel j’avais accès à l’époque de la tenue du festival au Forum des Images, forcément, rien ne remplacera jamais une présence physique lors de l’évènement, mais voilà, se trimbaler jusqu’à Lille ce n’est juste pas faisable.
Ce qui reste quand on a fait toutes ces soustractions ne manque pas de mérite, cependant, et permet en tout cas de se rincer l’oeil avec des séries souvent inédites chez nous, et, parfois, qui le resteront. Espérons que ce ne sera pas le cas des meilleures d’entre elles !

Comme l’an passé, je vous ai donc préparé un gigantesque récapitulatif de ce que j’ai vu, dans chaque catégorie. Fidèle à la tradition et à la limitation hélas de l’espace-temps, je n’ai reviewé que le premier épisode de chacune d’entre elles ici (…car quand on veut tout voir, on ne peut pas tout voir), mais même comme ça on se retrouve avec pas moins de 36 séries !
Du coup, ça va vous faire un peu de lecture, forcément…

A noter que Les Gouttes de Dieu / Kami no Shizuku n’a pas été mise en ligne, mais c’est pas grave, on aura laaaaargement l’occasion d’en reparler. Pas de bol non plus pour The Power, probablement parmi les séries « trop grosses » pour risquer la disponibilité gratuite sur le site du festival à quelques jours du lancement mondial. En revanche gros accident de parcours avec Best Interests, dont je pourrais jurer que la série devait être mise en ligne à partir de mercredi (toutes les autres fictions britanniques cette année étaient disponibles, en plus !), mais que je n’ai pas réussi à trouver. Je ne sais toujours pas comment ça a pu se produire, est-ce que je me suis mal organisée ? Mais bon, c’est pas comme si je manquais de séries à reviewer !
 Actor
Actor
 Dramédie
Dramédie
Outre le prix officiellement récolté hier soir, Actor aura également décroché le record de l’épisode le plus long de cette édition de Series Mania (mais bon, qu’est-ce que 1h08 quand on a l’habitude des séries turques, par exemple !). Un format assez atypique pour une série qui est, d’ailleurs, plus proche de la dramédie qu’autre chose, puisqu’elle nous présente deux acteurs, Ali et Morteza, qui doivent enchaîner les combines pour survivre. En effet, à défaut de remplir les fauteuils du petit théâtre miteux qu’ils louent (…quand ils ont de l’argent pour le loyer), ils ont décidé d’offrir leurs services à des gens riches pour des mises en scènes pendant des événements. La série s’ouvre ainsi sur une mission de ce type, dans laquelle Ali et Morteza se font passer pour de dangereux brigands afin qu’un homme fasse une demande en mariage inoubliable au moment où sa dulcinée pensera être sur le point de mourir (…rassurez-vous, les deux acteurs trouvent ça nul aussi, comme idée). Mais même comme ça, l’argent manque… surtout quand Morteza décide d’utiliser une partie de leurs recettes pour faire un cadeaux somptueux à Sarah, la jeune femme qu’il courtise.
Bref, c’est la galère, et c’est sur ça que porte le premier épisode d’Actor, alternant des séquences plutôt sympathiques sur les déboires de nos deux amis, et d’autres dans lesquelles nous pouvons les suivre dans un rôle (ou un mensonge) donné. Il y a en particulier toute une scène pendant laquelle ils répètent, ma foi, une scène, mais de la pièce qu’ils ont montée, et qui s’intitule… Actor. Tout le monde suit ? Bon, tant mieux, parce que si j’ai bien compris, les choses deviennent encore plus compliquées dans les épisodes suivants, cette introduction ne faisant qu’effleurer l’intrigue. A défaut d’avoir toutes les cartes en main pour juger de l’histoire, en tout cas je me suis bien amusée ; le tandem central qui joue Ali et Morteza est vraiment efficace, et les dialogues (même si j’ai bien conscience de n’avoir profité que d’une traduction) se tiennent vraiment bien. C’est triste de savoir que je n’en connaitrais sûrement jamais la suite, considérant le nombre de séries iraniennes achetées et diffusées en France en règle générale.
 De Grâce
De Grâce
 Drama, Thriller
Drama, Thriller
Je vous accorde que le timing de cette série pue beaucoup, et ça, au moins, n’est pas sa faute : tomber en plein pendant des grèves massives, alors qu’elle part d’un docker syndicaliste, c’est la grosse tuile. Six mois plus tôt, pas sûre que ç’aurait eu le même effet. Seulement voilà, vraiment la faute à pas de chance, je l’ai découverte pendant tout ce phénomène social. Et ça ne fait que lui porter préjudice.
C’est que voyez-vous, De Grâce n’est pas une série sur un docker syndicaliste : c’est une série dans laquelle un docker syndicaliste découvre un jour que des membres de sa famille pourraient être des trafiquants de drogue, et qui dans le même temps cache un lourd secret à cette même famille (vraisemblablement une double vie). C’est vous dire si on ne va parler ni docks, ni syndicalisme. En fait, entre la fille du protagoniste central qui est avocate, l’utilisation de belles demeures et de grosses cylindrées, et bien-sûr l’enquête sur le trafic de stups, on va parler d’à peu près tout sauf de docks et de syndicalisme. Les vœux pieux des nombreux plans (certes léchés ; très franchement je n’ai aucun reproche à adresser à la réalisation) des docks du Havre n’y changeront rien, pas plus que la voix-off qui fait mine de s’émeuvoir sur ce qui, en réalité, n’est qu’un prétexte. Pensez donc, De Grâce à même réussi à caser des Arabes qui trafiquent dans une cité du Havre ! C’était bien la peine de décentraliser la série.
Alors cette introduction veut, bien-sûr, nous émouvoir sur les temps qui changent et les docks qui ne sont plus ce qu’ils étaient, mais la réalité c’est qu’elle ne veut pas nous en parler. Et ça me hérisse le poil en général que le trafic de drogue (ET UN MEURTRE !) prennent autant l’ascendant sur ce qui était un sujet rarissime à la télévision, et une catégorie sociale extrêmement négligée par les séries, tout le contraire du trafic de drogue (…et du meurtre), sur quoi on peut difficilement espérer des propos novateurs. Après vous allez me dire : « oui, mais justement, à travers cette intrigue criminelle et ses retournements de situation incroyables et soapesques, on va en parler ! ». Je l’ai entendu pour tant d’autres séries… l’excuse ne passe plus. Moi, j’ai envie de choper les scénaristes par le col et leur dire que si elles veulent parler de quelque chose, elles n’ont qu’à en parler. PARLEZ-EN. Ne vous réfugiez pas derrière des clichés cent fois éculés, ne vous cachez pas derrière une intrigue policière (parce que le laïus au commissariat, cette complainte du pauvre flic excédé qui veut arrêter le trafic de drogue, ça va bien), si vous voulez parler de quelque chose, parlez-en. Surtout sur arte, c’est pas TFHein, non plus. Du coup c’est paresseux à tellement de niveaux. Vous voulez parler de ces choses ? Parlez de ces choses. Parlez de ces gens. Parlez de ces gens plutôt que de vos intrigues abracadabrantes et remâchées, comme s’il y avait plus de trafiquants de drogue en France que de gens exerçant des métiers pénibles, comme si c’était normal pour un syndicaliste d’avoir une villa avec piscine ou en bord de mer (c’étaient des scènes de nuit, je suis pas sûre), comme si c’était vulgaire de prendre au sérieux de ce qui touche intimement les gens. Moi j’en peux plus des intrigues à la Kin qui se racontent qu’elles font du Germinal. Allez vous faire cuire le cul.
 Festning Norge
Festning Norge
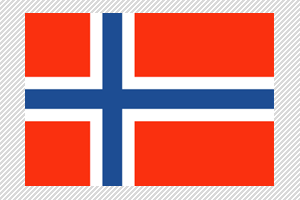 Science-fiction, Thriller
Science-fiction, Thriller
C’est sympa que la Norvège pense toujours à envoyer à Series Mania ses séries d’anticipation les plus joyeuses, ça met de l’ambiance dans le programme. Après Okkupert, dont en un sens elle est l’héritière, voilà donc Festning Norge, une série qui imagine que face aux multiples crises mondiales, le petit pays scandinave décide de basculer dans une autarcie totale. Economie, énergie, agroalimentaire… la Norvège se suffit dorénavant à elle-même, et pour s’assurer de la protection de sa population face aux risques extérieurs, ainsi que pour se prémunir de vagues d’immigration venues de pays moins bien lotis, une gigantesque muraille ferme les frontières terrestres. Tout cela fonctionne bien (…d’un point de vue norvégien) pendant neuf glorieuses années, pendant lesquelles, semblant ignorer le délabrement du monde, la Norvège devient un paradis sur terre. Sauf que naturellement, l’utopie est fragile…
Maintenant son niveau de science-fiction au strict minimum, Festning Norge (projetée sous le titre de The Fortress) a une nette préférence pour les enjeux sociaux et politiques de son intrigue, et pas tellement par la description de toutes les manifestations d’une Norvège idéale. Le premier épisode introduit d’ailleurs des personnages travaillant en cabinet ministériel, en plus d’avoir pour héroïne principale une spécialiste de la production et l’approvisionnement en nourriture de la population. Cela permet à la série d’avoir une excuse pour être un peu pédagogique voire bavarde, mais ces qualificatifs venant de moi sont à interpréter comme des qualités : j’aime ça dans une série de ce type (j’ai été servie une seconde fois pendant le festival à ce sujet, avec Apagón un peu plus bas). Plus surprenante est l’intrigue secondaire sur une famille de réfugiées britanniques, qui n’est pas sans avoir du sens mais ne se montre pas, de prime abord, connectée directement à ce qui se raconte dans l’intrigue principale. Difficile de ne pas penser, entre autres, à des séries comme Years and Years, pendant ce visionnage qui interroge à la fois le mythe d’une société tellement en avance qu’elle croit avoir les moyens de se protéger de tout (y compris des dérives)… et, j’ai l’impression, la question de la responsabilité nationale face à des instabilités mondiales. Il y a encore certains choix qui me posent question avant d’avoir une opinion définitive sur le discours de la série, mais pour l’essentiel, ça se tient. Un peu trop pour que je dorme tranquille après avoir vu le premier épisode de Festning Norge, mais en un sens, c’est une bonne chose.
Des séries qui tirent l’alerte, ce n’est pas nouveau, et d’ailleurs c’était l’une des thématiques de cette édition du festival ; mais il faut se préparer à un nombre grandissant d’entre elles. J’aimerais pouvoir dire que nous allons les regarder et en tirer des leçons, mais on ne peut pas dire que ç’ait beaucoup marché pendant les décennies télévisuelles précédentes.
 Mentiras pasajeras
Mentiras pasajeras
 Dramédie
Dramédie
Egalement connue sous son titre international de Fleeting lies, cette série permet aux frères Almodovar (Pedro et Agustín, donc) de faire équipe pour une dramédie sur les apparences. Les « mensonges passagers », ce sont les interventions cosmétiques même légères, auxquelles nous pensons n’avoir recours que temporairement, parce que jamais au grand jamais nous ne tromperions le monde durablement. Sauf qu’évidemment chaque procédure conduit à une autre, et chaque mensonge conduit à un autre, si bien qu’au final c’est la vérité qui a été passagère. En mettant en parallèle les mensonges de la beauté et les mensonges du succès, Mentiras pasajeras met en place une intrigue qui pour l’instant n’a rien d’innovant, mais qui a trouvé un angle à la fois très en prise avec les mentalités modernes, et en même temps un peu absurde (je ne suis pas une experte, loin de là, en Almodovar, mais apparemment ça fait partie de la marque de fabrique).
Dans ce premier épisode haut en couleurs et particulièrement rythmé, Lucía, une exécutive haut placée dans une compagnie spécialisée dans les produits et appareils de cosmétique, pense avoir tout réussi dans la vie ! Elle est sur le point de se marier à l’homme qu’elle aime, Basilio ; elle s’entend à merveille avec les deux fils de celui-ci, issus d’un premier mariage ; elle commence les démarches pour une fertilisation in vitro ; et puis, surtout, quand commence la série, elle s’attend à recevoir une promotion mirobolante. D’ailleurs elle a même incité Basilio à quitter son job dans une émission de télé qu’il déteste, pour qu’il puisse se consacrer à l’écriture de son roman. La vie luxueuse qu’elle mène est donc à son apogée… et le problème quand on a atteint les cimes, c’est que plus dure est la chute ! Quand ses patrons l’accusent d’espionnage industriel, Lucía se retrouve virée comme une malpropre. Comme elle a dépensé tout son budget mariage (convaincue qu’elle était d’obtenir une promotion) dans une superbe voiture de luxe, et qu’évidemment elle est grillée dans toute la profession, forcément les cordons de la bourse commencent à se serrer autour de sa gorge. La voilà qui a donc besoin d’un plan B en cachette de ses proches… Vous le voyez, ce n’est pas l’intrigue du siècle, mais quand on a du style et de l’énergie, on n’a pas besoin d’être à la pointe de l’originalité. Mentiras pasajeras s’est trouvé un sujet et un propos qui fonctionnent, en particulier de concert, et c’est franchement tout ce qu’on pouvait en espérer.
 Milky Way
Milky Way
 Teen drama
Teen drama
Née dans un petit village et n’ayant jamais rien connu d’autre, Maria rêve de stars et d’étoiles, bref, d’ailleurs. Un ailleurs qui est sûrement plus hors de portée qu’elle ne l’imagine, et ce n’est pas peu dire, alors qu’elle a misé son futur sur une hypothétique carrière dans la danse… Sauf que ça, quand on est adolescente, on ne le voit pas. On ne veut même pas l’envisager. Milky Way fait l’inventaire de la désolation qui l’entoure, et de l’espoir qui l’habite, malgré tout, de se tirer de là… jusqu’à ce qu’évidemment un paramètre nouveau, sa rencontre avec Joe, vienne tout chambouler. A moins que ce ne soient deux paramètres nouveaux ?
Il n’y a pas un ailleurs pour tout le monde, semble-t-on vouloir dire à l’adolescente… mais Maria (et Milky Way avec elle) a une précieuse énergie que l’on n’éteint pas si facilement. Ce premier épisode dessine les premiers traits d’une jolie série sur les façons dont la vie peut se transformer en impasse, surtout dans un village où la meilleure situation imaginable est d’entrer dans la police, mais refuse de se résigner. On n’y a pas inventé grand’chose, mais c’est joliment dit.
Accessoirement, c’est la première série grecque dans l’histoire du festival… et je ne suis même pas convaincue que dans l’histoire de l’Hexagone tout court, il y ait eu beaucoup d’autres séries grecques qui nous soient parvenues.
 Shamaim Adumim
Shamaim Adumim
 Drama, Historique, Guerre
Drama, Historique, Guerre
Les festivals ne manquent pas de séries revenant de près ou de loin sur le conflit israélo-palestinien (il faut dire que les diffuseurs israéliens sont toujours au taquet en matière de festivals TV). Shamaim Adumim, proposée sous son titre international de Red Skies, vient s’ajouter à la liste. Elle promet un retour en arrière de vingt ans cette fois. Mélangeant le drame à un thriller d’espionnage et de terrorisme plus générique, la série essaie de ménager la chèvre et le chou… et je ne suis pas certaine qu’elle y parvienne sur la base de ce premier épisode.
Alors oui, ces trois amies d’enfance qui ont grandi et dont la cohésion est menacée par les événements, sur le papier ça a du potentiel. Hélas, dans les faits, l’épisode est vraiment bien plus intéressé par l’action que par l’émotion. Les dilemmes qui se profilent n’en sont pour le moment pas vraiment, qui plus est, quand on n’a donné aucune place à un point de vue autre que « c’est les terroristes palestiniens qui ont commencé », alors que pourtant la série se vante de son équipe mixte israélo-palestinienne. Je sais pas, j’ai trouvé le traitement pour le moment assez paresseux, en dépit d’interprétations solides et de production value plus que décente. Peut-être que sur la longueur les choses se décantent.

En-dehors de Barzakh, série indo-pakistanaise sur laquelle j’ai entendu du bien et lu quelques choses intrigantes, que je ne perds pas espoir de voir plus tard dans l’année, la moisson aura été plutôt bonne pour ce panorama international.
 A Thin Line
A Thin Line
 Drama, Thriller
Drama, Thriller
Le dernier épisode a été mis en ligne dans son pays natal sur Paramount+ la veille de la soirée d’ouverture de Series Mania, c’est dire si c’est tout frais. Pas de chance, j’ai eu du mal à accrocher. A Thin Line voudrait nous laisser penser qu’il va être question de militantisme écologiste, et même, d’écoterrorisme. La fin justifie-t-elle les moyens ? Le premier épisode en prenait en tout cas la voie au début… sauf que voilà, ce n’est qu’une couverture.
Très vite, les sœurs jumelles Anna et Benni vont accomplir un gros coup : s’infilter dans les locaux d’un ministère pour s’infiltrer dans l’ordinateur du ministre, et en extirper les preuves de ses malversations dans le cadre de la construction d’une autoroute là où aujourd’hui se trouve une forêt. Victoire ! Victoire ? Non, la publication des preuves n’a pas vraiment d’impact, et la loi est votée, condamnant la forêt que les deux sœurs tentent désespérément de sauver. Dans les heures qui suivent, toutefois, l’actualité s’affole, si bien qu’Anna décide d’effacer toute trace de l’existence de leur site de leaks. Hélas, trop tard pour que les autorités se lancent sur leur piste… A Thin Line dresse le portrait de sœurs fusionnelles (et suggérant un peu trop une relation incestueuse à mon goût) mais très différentes. Entre Benni, la personnalité dominante mais également imprévisible, et Anna, l’introvertie dotée des vrais talents informatiques, qui va s’en tirer ? La fin du premier épisode indique qu’en effet, pour la première fois de leur vie, les jumelles vont vivre des trajectoires différentes, ce qui laisse supposer des sorts différents, à terme. Mais pourquoi ? Hors le suspense de découvrir quelle attitude est la moins passible de conséquences, que veut dire A Thin Line ? C’est dur à déterminer étant donné que d’écologie, il est finalement très peu question, et que la série s’intéresse très peu au sujet (introduisant même, sur le tard, le personnage ambigu de la mère), et qu’on est surtout ici dans un thriller somme toute assez classique qui aurait aussi bien pu porter sur n’importe quelle autre cause. A choisir, j’aurais préféré suivre Anna et Benni à partir de leurs tous premiers leaks, avec ses convictions, ses hésitations, ses erreurs de débutantes, ses premiers succès… et ENSUITE assister à ce que nous voyons dans ce premier épisode. Pas de bol, la série que je cherche n’est pas la série qu’A Thin Line semble vouloir être.
 Apagón
Apagón
 Science-fiction
Science-fiction
Pardon au reste de la planète, mais certains jours, j’ai envie de remercier Dieu pour l’existence de la télévision espagnole (continuez à lire, vous allez voir que ça va me passer…). Apagón est, en matière d’anticipation, une réussite ; ce premier épisode est simplement magistral, il n’y a pas d’autre mot. Tandis que nous suivons Ernesto, un cadre de la Protection civile dont le métier consiste à prévoir les catastrophes et planifier leur gestion, le ton monte exponentiellement. De mineur, un risque de tempête solaire devient inévitable, mais les paramètres sont tels qu’il est impossible de prévoir longtemps à l’avance. Si bien que le meilleur moment de savoir quand la tempête frappe, c’est d’assister, impuissant, au blackout qui en résulte, et Apagón fait un job épatant à décrire les mécanismes de ce stress avec humanité. Une humanité qui brille même une fois que tout s’est éteint, quand Ernesto décide de changer ses priorités parce que, voyez-vous, il a aussi des proches…
Alors après, je vous l’accorde, Apagón n’est pas à recommander aux plus anxieuses parmi nous ; je m’inclus dans le lot. La tension rend l’air autour de l’écran irrespirable, tandis que progressivement l’inéluctable se produit : comme d’habitude, le monde politique n’a pas écouté les conseils notamment scientifiques les plus sages (et Apagón est d’autant plus perspicace à ce sujet que son action se déroule consciemment post-COVID) par peur de ralentir l’activité économique. En plus de cette surdité politique, les autorités n’ont même pas pu prendre toutes les mesures qu’elles auraient voulu à cause de l’imprévisibilité du phénomène solaire. Et par conséquent, la population est livrée à elle-même.
Qu’on ne se leurre pas : ce n’est pas simplement que l’épisode de la série espagnole est stressant. C’est qu’il y a quelques semaines encore, on parlait de blackout d’énergie en France ; et que, vu l’incapacité des gouvernements à prévoir à long terme, il y a fort à parier qu’on en reparle l’hiver prochain, un peu plus sérieusement encore que cette fois-ci… Apagón frappe fort parce qu’elle frappe là où nous nous savons vulnérables, et elle nous force à l’affronter. Au moins par la fiction.
 Désobéir
Désobéir
 Drama, Historique
Drama, Historique
En 1989, l’avortement légal est encore jeune dans la société québécoise : il n’est pleinement autorisé de plein droit que depuis… un an. Inutile de dire que les mentalités (en particulier au regard de l’influence du catholicisme dans le pays) n’ont pas forcément évolué. Chantale Daigle, une jeune femme qui en 1988 a rencontré Jean-Guy Tremblay et pensait faire sa vie avec lui, en fait l’expérience quand l’année suivante, elle décide de le quitter soudainement alors qu’elle est enceinte de 17 semaines. Bien-sûr, pas question de poursuivre la grossesse. Légalement, elle a le droit de le faire, d’autant que rien dans le droit n’impose de date butoir à un avortement même avancé ; elle a en outre le soutien inconditionnel de toute sa famille. Mais Jean-Guy ne l’entend pas de cette façon, et décide de faire des démarches légales pour l’arrêter. Le premier épisode de Désobéir (dont le sous-titre est Le choix de Chantale Daigle) montre comment, aidé par des hommes partageant les mêmes idées sur le contrôle des femmes que lui, il va trouver un angle d’approche : les droits du fœtus. Le jour-même de la procédure, Chantale apprend qu’une mesure temporaire a été décrétée par un juge, l’empêchant d’aller jusqu’au bout de sa démarche d’avortement. Que faire ? Prétendre n’en avoir pas eu connaissance (après tout l’injonction a été remise à son père alors qu’elle était déjà sur la route de la clinique) et tout de même y procéder ? Ou se plier à l’injonction, au risque de perdre du temps ET d’être empêchée durablement par la suite ?
Pour le moment au moins, Désobéir n’est pas une chronique judiciaire d’un cas qui a marqué le Droit des Femmes dans son pays. C’est une histoire banale d’une jeune femme qui tombe amoureuse d’un gars qui ne la mérite pas, qui ne mérite personne, et qui ne mérite certainement pas tout le soutien qu’il reçoit dans sa démarche. L’épisode alterne les scènes en 1988 (la rencontre entre Chantale et Jean-Guy, l’évolution de leur relation…) et celles en 1989 (l’après-séparation, les démarches pour avorter…), suggérant sans s’apesantir sur elles ni même nécessairement en montrer trop les manipulations de Jean-Guy, ses mensonges, son contrôle. Désobéir sait bien que ce qui se joue dans la bataille de l’avortement, ce n’est pas le droit d’un enfant à naître, auquel Jean-Guy ne pense de toute façon pas, trop occupé qu’il est à empêcher Chantale de le quitter par tous les moyens possibles. Un peu scolaire par certains aspects, la série est parfaitement consciente de sa nécessité devant la gravité du sujet, et, je pense, ses spectatrices aussi. C’est bien tout ce qui compte dans ce type de projet : on n’est pas là pour la révolution télévisuelle, mais la révolution féministe.
 Funny Woman
Funny Woman
 Dramédie, Historique
Dramédie, Historique
J’ai beaucoup de mal à croire qu’il s’agisse d’une fiction, plutôt que d’une biographie ! Gemma Arterton donne vie à sa protagoniste comme si celle-ci avait toujours existé, ou au moins depuis les années 60, et qu’il existait des heures et des heures d’archives dont tirer de l’inspiration. Et pourtant non, Barbara Parker/Sophie Straw n’existe apparemment pas, même si le doute ne pourra plus se déloger, quoi qu’en dise google.
Funny Woman est rythmée, gaie, mais pas aveugle aux réalités de son temps ; elle embarque ses spectatrices dans une histoire somme toute classique (une jeune femme veut réussir à la capitale), mais inspirée. L’humour de son héroïne, ses influences popculturelles, et son sens de la fierté, donnent tout son sel à cette épopée. Je me suis même surprise à regretter que cela ne soit pas le biopic Bardot, tant malgré la légèreté ambiante le personnage est capable d’exister à nos yeux, de ressentir des choses, d’exprimer des émotions qui lui sont propres et nous disent qui, réellement, elle est, même si personne ne la voit (…mais on reparle de Bardot dans un instant). Dés que je mets en ligne cet article, je peux vous dire que je vais aller faire main basse sur les épisodes restants.
 Goof Shilishi
Goof Shilishi
 Drama
Drama
Résolument une de mes découvertes préférées de ce festival, Goof Shilishi (projetée sous son titre international, A Body That Works) démarre quand le parcours de fertilité d’Ellie et Ido se transforme en voie sans issue, sans vouloir faire de jeu de mots. Leur médecin est clair : à un moment, après autant de fécondations in vitro et autant de fausses couches, il faut se rendre à l’évidence. Entre une grossesse et un enfant, il va falloir choisir, mais le couple n’aura pas les deux. Pendant ce temps, Chen, une mère divorcée qui a dû retourner vivre chez son père, son propre fils sous le bras, et gagne mal sa vie dans une hotline, réalise que l’argent qui lui permettrait de prendre un nouveau départ dans la vie pourrait bien venir d’une agence de mères porteuses. En théorie les deux parties sont faites pour s’entendre, mais cela ne se fera pas sans heurts et tiraillements : c’est cela, l’objet de Goof Shilishi, qui montre avec ce premier épisode très maîtrisé qu’elle en a, si vous me passez l’expression, dans le ventre.
Son portrait le plus réussi est sans hésitation celui d’Ellie, une femme qui depuis 5 ans a paramétré chaque aspect de sa vie pour tomber enceinte, et qui est de toute façon d’une nature assez psycho-rigide (c’est aussi sa plus grande qualité, au passage, mais dans le contexte relationnel ça ne fait pas que des heureuses). La façon dont Goof Shilishi ambitionne explicitement de la forcer à lâcher un peu de son contrôle est extrêmement prometteuse, en particulier parce qu’on y évite les stéréotypes : ce n’est pas qu’elle soit incapable de doute ou même de flexibilité, c’est que c’est douloureux de lâcher du leste, surtout quand tant se joue. C’est pourtant bien ce qui s’annonce si une autre qu’elle doit porter son enfant. Dans une moindre mesure, le fort caractère de Chen et la douceur d’Ido ne sont pas désagréables (quoique je ne doute pas que toutes deux testeront leur limites à l’avenir), mais c’est vraiment Ellie qui est la plus frappante dans ce premier épisode mené avec vulnérabilité et authenticité.
Entre nous soit dit, ça faisait quelques temps que je n’avais pas vu une série israélienne qui m’emballe autant. Il faudra qu’un diffuseur français se dévoue et achète la suite sans trop tarder, parce que même si les épisodes ne sont pas introuvables vu que la série a démarré le mois dernier, un human drama (ce n’est pas sale) est quand même largement plus agréable à suivre avec des sous-titres.
 Händelser Vid Vatten
Händelser Vid Vatten
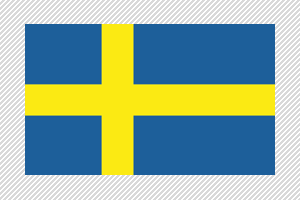 Drama, Thriller
Drama, Thriller
Une histoire qui se déroule à deux époques différentes : 1973, lorsqu’une institutrice du nom d’Annie arrive dans la communauté rurale de Svartvattnet (« blackwater » en anglais, qui est aussi son titre international) avec sa fille Mia ; et 1991, quand les souvenirs remontent à la surface pour Annie. Pour ajouter à la fracture entre les deux mondes, l’intrigue démarre alors qu’en 1973, c’est le jour du solstice d’été (une journée d’une longueur exceptionnelle, donc, et baignée d’une chaleur plombante) alors que la partie de l’intrigue en 1991 se passe en grande partie la nuit et/ou en intérieur au beau milieu de l’automne. Au stade du premier épisode, toutefois, il faut admettre que l’on assiste beaucoup plus à la mise en place des faits dans les années 70, la partie se déroulant deux décennies plus tard servant surtout de cadre narratif. Cependant je ne doute pas vraiment que les conséquences de ce à quoi nous assistons soient détaillées un peu plus par la suite.
Händelser Vid Vatten parle de meurtre et se déroule en Suède, et effectivement il y a un personnage de flic dans ce que nous voyons de 1973, mais les comparaisons avec la plupart des polars nordiques s’arrêtent là. Pour l’essentiel la série semble avoir opté pour une approche plus dramatique que policière, suivant quasi-exclusivement le point de vue d’Annie (et donc indirectement de sa fille, encore jeune à ce moment-là) ainsi que de Johan, un adolescent qui a grandi dans une ferme sous l’autorité d’un père et de demi-frères qui le méprisent et n’hésitent pas à le maltraiter. Le portrait moite et rude de Svartvattnet est réussi, bien que dans le même temps plus j’en vois sur cette bourgade moins j’ai envie d’y poser les pieds, et on partage progressivement le choc d’Annie, qui s’est transformé au fil des décennies en véritable traumatisme. Cette seule exploration a du sens, mais évidemment se met en place la question de déterminer si ce qu’a vu Annie suffit à établir la vérité quant à ce qui s’est produit, or rien n’est moins certain. Ce n’est pas forcément ce qui me captive le plus, mais au moins l’angle d’approche de ce mystère, et surtout le ton de la série, tranchent avec ce que des chaînes comme SVT envoient si souvent aux festivals.
 Innermost
Innermost
 Drama
Drama
Personnellement, je n’ai pas tout compris. Alors, pas à l’histoire, dont la lisibilité ne pose aucun problème : il s’agit d’une galerie de portraits de personnes vivant à Tel Aviv, avec ce qu’elles traversent. Le premier épisode se focalise sur deux protagonistes en particulier (mais les suivants apparemment en incluent d’autres), un flic en uniforme du nom de Rashi, qui intervient régulièrement sur des urgences violentes, et se retrouve en particulier à s’interroger sur la violence vis-à-vis d’enfants alors qui lui-même et sa femme n’arrivent pas à procréer (deuxième série sur les problèmes de fertilité, au passage, après Goof Shilishi et avant Romantic Getaway) ; et puis Alice, une autrice dont le premier roman, une histoire d’amour dans lequel il y a pas mal de sexe, trouve le succès juste au moment où elle est violée chez elle par un agresseur en série. Certes, les thèmes sont durs, mais dans l’ensemble c’est facile à appréhender.
Non, ce sur quoi je bloque un peu, c’est quand je fouille au sujet de la série (faute d’avoir pu assister aux séances à Lille où c’était probablement mieux expliqué), et que j’apprends que l’idée derrière Innermost est de travailler avec des actrices non-professionnelles, afin d’obtenir de l’authenticité ; apparemment il ne leur a été donné aucun script. Donc on est dans une sorte d’improvisation, supposée être ancrée dans le réel ; une sorte de JDR filmé, en gros (dans ce cas, pourquoi le créateur et réalisateur de la série Yaron Shani est-il aussi crédité à l’écriture ?). Bon, je ne suis pas certaine de voir la plus-value dramatique, mais admettons. Parce que la série ne fait pas vraiment état de cela, hors un avertissement en début d’épisode dont la vocation est d’expliquer pourquoi certains plans sont partiellement floutés ; mais la démarche n’est en fait ni expliquée, ni vraiment exploitée. Du coup, sans en connaître la méthode, je n’ai pas vraiment l’impression que ça change grand’chose à la réception de la série : si l’on ne sait pas qu’on regarde des non-professionnelles sans script, on assiste quand même à un produit fini qui ressemble à un drama scripté. Certes intimiste, mais pas révolutionnaire vu de l’extérieur. Donc pourquoi mettre en place tout cela ?
Une autre chose qui m’interpelle ? La présence d’Innermost à Series Mania, tout bonnement ! Le festival s’enorgueillit à raison d’accueillir en compétition des séries futures, ou au moins très récentes. Parce que, voyez-vous, l’article de Variety que je viens de lier n’en fait pas mention, mais Innermost a l’air d’être un reconditionnement de la « Love Trilogy » cinématographique de Yaron Shani, sortie entre 2018 et 2019… et d’ailleurs déjà récompensée lors de plusieurs festivals à l’époque. Dans ce trailer datant d’une projection à Odessa en 2020, je trouve par exemple plein de scènes du premier épisode, donc quid ? Vraiment, mon plus gros regret sur cette série sera de ne pas avoir assisté à la séance, pour avoir les explications sur le contexte de tous ces facteurs.
 La Ruta
La Ruta
 Drama, Historique
Drama, Historique
« Une révolution partie de rien. Contre rien. Qui n’a conduit à rien ». C’est toujours pratique quand une série fournit les éléments de sa propre critique… Dédiée à raconter l’évolution d’un mouvement de la vie nocturne à Valencia dans les années 80 et 90, La Ruta s’est choisi un sujet original… en revanche il n’est pas certain qu’elle ait trouvé une bonne façon de le traiter. Si c’est l’équivalent ibérique du Monde de Demain, c’est un peu triste pour les Espagnoles.
Est potentiellement en cause son choix de raconter cette histoire à rebours, donc en commençant par son déclin alors qu’au milieu des années 90, la fête touche à sa fin… ou bien son choix de personnages, qui ne se distinguent pas par grand’chose pour le moment (en particulier les rôles féminins, presque totalement réduits à l’état de groupies). Il est également possible que cet effet de rebours ne fonctionne que sur la durée, c’est-à-dire qu’à la fin de la saison, en revenant en arrière dans leur jeunesse et leur innocence tout en les sachant perdues, on se sera peut-être attachées aux protagonistes. Ou encore pourrait-on accabler le fait que dans ce premier épisode, pourtant celui d’une série nommée après un courant musical autant qu’une sous-culture, il soit si peu question de musique. Difficile à dire, mais reste qu’il est un peu difficile d’accrocher à La Ruta.
 Little Bird
Little Bird
 Drama, Historique
Drama, Historique
Lentement mais sûrement, des séries abordant la dimension souvent raciste de l’adoption transraciale commencent à émerger (Colin in Black & White en était une autre). Mais c’est sur un pan historique bien précis que Little Bird apparaît non pas pour raconter la success story d’une enfant autochtone devenue une riche étudiante en droit fiancée à un futur médecin, mais plutôt pour dire combien celle qui traverse le monde désormais sous le nom d’Esther reste, pour les autres et, lentement, pour elle-même à nouveau, Bezhig, née dans une réserve First Nation. Little Bird ouvre plus grand encore les plaies déjà béantes mais souvent ignorées, incapables de se refermer dans des circonstances encore brutales de nos jours, et expose la douleur avec une délicatesse infinie. Je ne pense pas qu’une autre série avant elle ait fait de son objet principal le vol d’enfants autochtones, car c’est un vol, aussi institutionnalisé soit-il ; et elle le fait avec un terrible brio.
Difficile ici de résister à la nostalgie fragile des souvenirs d’une vie familiale heureuse, déchirée par la police et les service sociaux. Il se prépare sûrement des flashbacks bien plus amers voire violents sur la phase suivante de l’existence de l’héroïne et ses adelphes, qui devraient rendre le visionnage de Little Bird difficile à regarder. Mais si des enfants ont dû passer par là, ce n’est pas trop demander que des adultes supportent le visionnage d’une fiction à ce sujet ! Le reste de la saison n’arrivera jamais assez vite, et, n’en doutons pas, continuera d’appuyer sur les mécanismes sociaux mais aussi individuels qui génèrent ce genre de traumatisme.
 Nordland ’99
Nordland ’99
 Thriller, Drama
Thriller, Drama
Un festival, c’est l’occasion de découvrir des séries qu’on n’aurait jamais vues autrement… ou, dans le cas de Nordland ’99, qu’on n’aurait jamais regardées. Mais bon, elle est là, je suis là, l’instinct complétiste est là, alors voilà. Honnêtement, au bout du 712e polar sur une disparition (même si certes ça nous change des meurtres), je vous avoue que ma capacité à trouver des choses à dire est plus qu’amenuisée. Mais je vais quand même faire un effort pour trouver deux-trois caractéristiques à vous rapporter.
Là du coup ça se passe en 1999. On sait pas trop ce que ça apporte à l’affaire pour le moment. Ya une solide ambiance, c’est vrai. Quoi d’autre ? C’est… très jaune. C’est noir. C’est très jaune et noir ; après faut dire que la totalité du premier épisode se déroule de nuit. La vie dans ce petit patelin paumé est chiante, et on va dire que c’est bien retranscrit. Voilà, disons ça comme ça. Je, euh… ya des protagonistes… et puis au bout d’un moment, yen a un de moins. Ça s’inquiète, on sait pas de quoi, c’est assez diffus, à peine suggéré, Nordland ’99 ne veut rien lâcher ; et puis au bout d’un moment on sait. Mais sûrement qu’il y a plus d’une raison de s’inquiéter, en vrai, c’est juste qu’on le ressent pas. Il se dit des trucs, mais comme personne ne se parle vraiment en fait il se dit rien. Tout le monde est crevé et blasé. Surtout moi. Ah oui et puis évidemment, ya un flic.
A ce stade je sais vraiment pas quoi vous dire de plus. La plus grande originalité de ce premier volet de Nordland ’99 c’est que ses épisodes font une demi-heure. Mais de toute façon on s’en fout parce que si une chaîne française se décide à acheter la série, ça finira en soirée de 4 heures tout pareil.
 Tengo que morir todas las noches
Tengo que morir todas las noches
 Drama, Historique
Drama, Historique
De nombreux pays de la planète ont eu « leur » série sur la communauté LGBT dans les années 80 (on se souviendra d’ailleurs que Torka Aldrig Tårar Utan Handskar avait également figuré au programme de Series Mania il y a quelques années), c’est au tour du Mexique. La série est l’adaptation d’un roman apparemment emblématique, mais comme ni vous ni moi ne lisons beaucoup de littérature mexicaine, bon. L’intrigue suit Guillermo, un jeune homme qui a grandi dans une petite ville mais décroche l’opportunité de vivre à la capitale (certes en colocation avec son frère aîné, un flic) pour y poursuivre ses études ; se destinant en effet au journalisme, et plus particulièrement au photojournalisme, Guillermo dit « Memo » sent qu’il est à l’aube de découvertes à la fois sur lui-même et sur le monde.
Et justement j’ai aimé la façon dont Tengo que morir todas las noches présente son protagoniste comme jeune, inexpérimenté, mais pas caricaturalement naïf et ignorant. Il sait déjà, notamment, qu’il est gay, ce qui nous épargne en grande partie les soupirs et tremblements communs dans d’autres séries (et notamment dans En af drengene, discutée plus bas, où pourtant les héros ont environ le même âge). Arrivé dans la « grande ville », donc, Memo sent qu’il a des choses à découvrir, mais il est aussi suffisamment conscient de qui il est et de ce qu’il aime pour savoir refuser les expériences qui ne sont, tout simplement, pas faites pour lui. Après avoir jeté un oeil à la scène gay de la ville qui se déroule dans des lieux publics (dans les parcs, toilettes et autres cinémas où les hommes se rencontrent fugacement), il est par le plus grand des hasards introduit au club El 9. Il y tombe amoureux de l’endroit, de son univers joyeux et glam, et… du DJ, ce qui ne gâche rien.
Tengo que morir todas las noches signe ici une mise en place maligne et touchante à la fois, avec un personnage central vraiment bien écrit et interprété, mais qui cède aussi progressivement un peu de place à toute une galerie de personnages LGBT dont on ne peut qu’espérer qu’on en appréciera autant de nuances au fil des épisodes à venir. Il ne fait pas vraiment doute que la série n’est pas juste là pour jouer des contes de fées, et en toile de fond de cet épisode d’exposition, certaines pistes sont lancées pour la suite de la série : répression policière, placard, SIDA, etc. Franchement, si ces aspects sont aussi bien menés que l’introduction de la série (et je n’ai à ce stade aucune raison d’en douter), on tient peut-être l’une des meilleures séries de l’année. Niveau séries internationales, Paramount+ a vraiment un goût sûr !

Dans cette catégorie, c’est la série Les Randonneuses qui n’a apparemment pas été mise en ligne. C’est toujours un peu moins grave pour les séries françaises, de toute façon.
 Aspergirl
Aspergirl
 Dramédie
Dramédie
Tout n’est pas parfait dans ce premier épisode, mais on y trouve beaucoup de plus de bien que de mal, et ça me donne bon espoir pour la suite. Aspergirl est une des séries que j’aurais voulu poursuivre si j’avais eu le temps (4 épisodes au total étaient mis à disposition sur la plateforme Series Mania+, probablement à cause du format d’une demi-heure), pour lui donner l’occasion de sortir des quelques clichés dont, de toute évidence, elle est consciente. Je soupçonne que l’exposition ne soit pas son point fort (ni ce qui l’intéresse), mais que ce soit un passage obligé.
Aspergirl s’inscrit parfaitement dans la lignée (relativement récente, depuis environ une décennie) de séries de toute la planète s’intéressant à des protagonistes dont la santé mentale et/ou le schéma cognitif sortent de la « norme », et qui pendant longtemps étaient soit négligées soit dépeintes de façon grossière à la télévision. Cette fois il s’agit de Louison, une femme divorcée qui découvre que son fils Guilhem est probablement sur le spectre autistique… et que d’ailleurs, elle aussi. La série a un joli sens du détail (notamment par son emploi intéressant de la couleur), un bon rythme, et un côté décalé mais tendre. La scène chez la psy qui formule le diagnostic initial est très jolie parce qu’elle semble déverrouiller quelque chose… c’est juste qu’on n’avait pas réellement le sentiment qu’il y avait quelque chose à déverrouiller. Quelque chose qu’Aspergirl doit encore nous dire, c’est en quoi ce diagnostic est une révélation, pour la mère ou pour le fils, qui éclaire les choses de façon positive dans la perception que Louison et/ou Guilhem ont d’elles-mêmes ; car pour le moment, entre le regard des inconnues, de sa famille, de son ex-mari, et très probablement du travailleur social introduit en fin d’épisode (et qui augure d’une intrigue rare sur le rôle des institutions dans la vie des personnes psychiatrisées), on a surtout l’impression d’en voir le négatif. Ou au moins l’intrigant, le bizarre, l’anormal ; ce qui revient un peu au même. La série n’aura pas trop du reste de sa saison pour essayer de nous faire ressentir les choses que ressent Louison plutôt que celles qu’elle fait ou comment elle est perçue. Vu son message d’ensemble, Aspergirl semble pourtant parfaitement saisir qu’il y a bien plus à dire que cela sur l’autisme, et il faudra donc se donner rendez-vous sur OCS pour découvrir comment elle le dit.
 Bardot
Bardot
 Drama, Historique
Drama, Historique
Ah, ça ! On n’accusera pas Bardot de chercher la sophistication ; au contraire, ce premier épisode m’évoque la démarche du biopic italien Moana (certes les deux actrices ont eu des carrières différentes…). On a donc ici une biographie qui commence à l’adolescence mais qui se refuse à parler de Brigitte Bardot comme d’une personne, ou même une personne en devenir, juste un sex symbol en devenir. Pour faire un bon biopic de sex symbol, il faut : des figures parentales autoritaires, une large dose de beauté niée voire réprimée (si possible par les parents), et un éveil à la sexualité sur lequel on se contentera de dire des banalités. On a précisément ces ingrédients réunis ici. Ni plus, ni moins.
Le premier épisode, qui pourtant suit les débuts dans le cinéma de Brigitte Bardot, ne nous dit absolument pas pourquoi elle se lance dans ce milieu alors qu’elle prétend ne pas s’y destiner ; ou plutôt l’épisode nous donne le déroulement des faits, juste pas franchement le déroulement de sa pensée, les éventuelles contradictions soulevées étant aussi vite balayées. Bref, peu importe ce qu’elle pense ou ressent, on n’est pas là pour ça. De toute façon, le plus gros de l’épisode est intéressé par la relation entre elle et Roger Vadim (sans interroger la différence d’âge autrement que par le prisme de la légalité ou la réaction de ses parents, et même là ce n’est vraiment qu’une formalité). Toute forme d’intériorité est refusée à l’héroïne dont pourtant la série porte le nom, pourvu qu’elle soit amoureuse et passionnée, et qu’elle devienne la femme qui incarne tous les fantasmes. La sensualité toujours comme une nature, jamais comme un choix conscient…
Bardot est typiquement le genre de série qui a décidé de vendre du rêve, et si on la regarde dans cette optique, tout se passe bien. Sauf que c’est un rêve recyclé, et dés qu’on cherche un peu plus loin, on n’y trouve qu’une photographie sublimée d’une jeune femme qui a fait bander une ou deux générations d’hommes (et qui ne sont probablement plus en mesure de le faire de nos jours, les pauvres). Son féminisme se limite à dire que la sensualité de la future actrice ne demandait qu’à s’exprimer ; progressivement le monde va y être exposé, et, évidemment, en être changé… Hélas c’est un peu limité pour une série qui effectivement porte sur les années 50-60, mais est écrite six à sept décennies plus tard. Un peu de recul aurait été bienvenu, mais rien à faire, on est là pour le mythe.
 Polar Park
Polar Park
 Policier
Policier
Lorsque Polar Park a commencé (peut-être influencée par l’utilisation du mot « comédie » dans la description de la série sur Series Mania+), je me suis demandé s’il s’agissait une parodie des polars scandinaves, et de leurs clichés cent fois répétés (surtout à l’export… et en festivals) ces dernières années. Au fil du visionnage, beaucoup d’ingrédients s’y prêtaient, mais l’épisode ne semblait jamais vraiment opter pour le second degré, et moins encore pour l’aspect critique de la parodie, laissant pour l’essentiel place à une série policière plus classique.
Suis-je en train de vous dire que Polar Park m’a autant déçue que Des gens bien l’an dernier ? Eh bien heureusement non, pas tout-à-fait. Alors certes, de moi-même je n’aurais jamais fait le choix de me mettre devant cette série sans sa projection au festival, parce que j’ai arrêté de regarder les séries en son genre. Cependant son visionnage n’est pas désagréable, en particulier parce que l’épisode introduit avec agilité un duo qui fonctionne bien, dans un univers plus bizarre qu’hilarant. L’écrivain de romans policiers sur le retour, incapable de finir (depuis 10 ans !) le roman dont il espère tirer la légitimité dont son ego est assoiffé, se retrouve dans un village étrange pile au moment où se produit une affaire sordide. Convaincu d’avoir de l’expertise criminelle parce qu’il a écrit des bouquins (et l’épisode confirme à plusieurs reprises que rien n’est moins sûr !), il s’immisce dans l’enquête d’un flic un peu dépassé par les événements (rares dans ce type d’endroit reculé) et surtout pas très affirmé, mais intelligent. Les scènes de crime du premier épisode sont un peu folles et dérangeantes à la fois, il y a des personnages hauts en couleur, et des gags pas trop lourds, ce qui fait qu’au final, c’est loin d’être la pire fiction du genre. C’est pas mon genre, mais ça se tient pour le moment.
 Sous Contrôle
Sous Contrôle
 Politique
Politique
C’est intéressant le ton que s’est choisi Sous Contrôle, parce que si on n’y regarde pas la politique (et notamment l’action gouvernementale) avec des lunettes roses, on n’est pas non plus complètement dans le cynisme. Les mécanismes sont pourtant classiques : on plonge une personne extérieure à la politique politicienne (ici une femme engagée dans l’humanitaire) dans le grand bain ministériel du jour au lendemain, on la voit se confronter aux réalités du milieu, puis on espère qu’elle va à la fois s’adapter, histoire de pouvoir accomplir quelque chose, et ne pas transiger sur ses principes. Plus facile à dire qu’à faire, évidemment. Rien d’original ici mais la protagoniste est bien écrite, bien interprétée, et malgré l’humour, prise au sérieux par un scénario qui n’a pas décidé par avance que tout était foutu, même si les choses sont très mal embarquées.
Il est également fascinant de voir une série s’intéresser aux coulisses du monde politique national, mais d’y intégrer des éléments de géopolitique. Sous Contrôle a en effet décidé de suivre une ministre des Affaires étrangères (rarement sujet d’étude de beaucoup de séries politiques). Au stade du premier épisode, ce n’est pour l’instant pas la série de l’année, mais c’est une proposition qui ne manque pas d’intérêt.
 Split
Split
 Drama, Romance
Drama, Romance
A la lecture du mot « romance », vous savez immédiatement ce que vaudra mon avis, mais tant pis, risquons-nous. De façon assez prévisible, en effet, cet aspect m’a assez peu fascinée. La manière dont Anna, la cascadeuse, se fascine pour Eve, l’actrice, m’a paru un peu précipitée (comme si Anna avait déjà fait la paix avec ce « split » que semble pourtant promettre la série, à moins que j’ai mal compris), mais comme de toute façon la romance c’est pas ce qui m’intéresse le plus, ça me va très bien. Le gros du dilemme semble, dans la manière dont ce premier épisode est amené, plutôt porter sur la tromperie (Anna est en couple avec un homme) que sur l’attraction en elle-même ; en tout cas c’est comme ça que je le perçois tant cet épisode introductif passe de temps à montrer Anna dévorant des yeux l’objet de son affection.
En revanche j’ai trouvé plutôt fin de choisir, de tous les contextes professionnels possibles, celui du cinéma, qui donne une opportunité à Split de parler de sujets à la fois brûlants et assez souvent tus par la fiction, en particulier française… sur son propre fonctionnement. Anna est en effet doublure, ce qui inclut des cascades mais aussi, par contrat, toute scène dans laquelle l’actrice qu’elle double ne se sentirait pas en sécurité, comme par exemple une scène d’agression sexuelle. Split aborde donc par petites touches comment on peut être actrice en 2023 (fameuse ère post-#MeToo), soit avoir plus conscience que jamais de certaines choses, exercer une profession qui elle-même peut toucher à l’intime à de multiples égards… et en même temps, évoluer dans un milieu où les mentalités n’ont pas encore complètement pris en compte certaines problématiques, notamment sur le consentement. Ces moments-là, dans le premier épisode de Split, me semblent plus originaux et intéressants que le reste, quand bien même ils sont au second plan.

Personne ne manque à l’appel dans cette catégorie… même si c’est rarement parmi les comédies que je trouve mes plus gros coups de coeur de festival. Cette édition ne fait pas exception.
 Besoin d’Amour
Besoin d’Amour
 Comédie
Comédie
Au secours. Si je pense voir ce vers quoi se dirige la série (qui d’ailleurs n’en fait pas un absolu mystère), en revanche j’ai eu beaucoup de difficultés avec… eh bien, à peu près tout le reste. Je n’ai pas trouvé ça drôle, pour commencer, ce qui est toujours un peu gênant pour une « comédie » (je la soupçonne personnellement d’être plutôt une dramédie, mais on va pas encore relancer le débat), quoique pas obligatoire pourvu d’y trouver autre chose.
Or, là, je n’ai pas vraiment accroché aux autres choses. Ni à l’univers du porno, qui pour le moment ressemble plus à prétexte, au mieux un élément de background, qu’à une véritable volonté d’utiliser ce milieu à dessein ; ni du côté du personnage principal, décrédibilisé (dés la première scène) pour être un idiot qui n’est pas attaché à grand’chose, mais qui semble être conçu pour être attachant ; ni en ce qui concerne le défilé de guests, qui disent surtout quelque chose du public visé ; ni du léger côté fake med de certains propos, peut-être accidentel. Et c’est dommage parce que cette idée du manque d’amour aurait pu être drôle et poétique… mais rien à faire, ça ne prend pas. Ce premier épisode reste à la surface des choses, y compris des émotions (la scène avec le père en est dénuée, celle qui suit légèrement meilleure), et certes, un épisode introductif a beaucoup de boulot en-dehors de ça, mais là c’est un peu vide. Donc ouais, vous pouvez le voir, j’ai eu du mal, et pas qu’un peu.
 Everyone Else Burns
Everyone Else Burns
 Comédie, Religion
Comédie, Religion
Les Lewis forment une famille chrétienne fondamentaliste, qui n’attend que la fin du monde pour obtenir son dû : l’éternité comme preuve de sa supériorité sur le reste de l’Humanité. En attendant il faut bien continuer à vivre parmi le commun des mortels, dans un quartier pavillonnaire, et à aller à l’église 712 fois par semaine. Du moins, quand on ne fait pas du porte à porte pour évangéliser le reste de la ville… Si Everyone Else Burns démarre comme une simple comédie s’étant choisi une cible très spécifique (et un peu facile), le premier épisode révèle bientôt quelques aspérités bienvenues, qui prouvent qu’elle prend au sérieux ses protagonistes.
Dans ce domaine, les personnages masculins sont moins bien lotis : plus caricaturaux, ils représentent une certaine forme d’hypocrisie. Le père est par exemple assoiffé de promotion sociale au sein des rangs de son église, et le fils est tellement convaincu d’être un excellent serviteur de Dieu qu’il est odieux avec absolument tout le monde. C’est du côté des deux héroïnes principales que c’est plus intéressant : la mère inflige la religion autant qu’elle la subit (et qu’en particulier, elle subit son mari), et la fille, surtout, voudrait respecter l’éducation qu’on lui donne tout en trouvant un moyen de ne pas gâcher son propre potentiel, ce qui hélas n’est pas gagné d’avance. J’aime vraiment ce qu’Everyone Else Burns dit de la difficulté à se construire dans un milieu aussi restrictif, et c’est typiquement le genre de choses qui fait écho à certaines de mes expériences personnelles (certes non-religieuses). J’avais pas mal entendu parler de la série ces dernières semaines, c’est clairement mérité ; je remercie Series Mania de m’avoir donné l’impulsion nécessaire à la faire remonter dans ma to-watch list.
 Kald Mig Far
Kald Mig Far
 Comédie
Comédie
Emil vit sa vie en essayant de toujours faire le choix le plus juste et éthique, dans le respect de l’autre et de la planète ; sauf que le sort a décidé de tester ses limites, et un beau jour il apprend que sa mère et son meilleur pote couchent ensemble. La question qui se pose est : jusqu’à quand Emil va-t-il se démener pour prendre en compte le reste du monde, et commencer à s’écouter un peu ? En tout cas, pas avant la fin du premier épisode, même si son propre corps semble lui envoyer un avertissement très clair que l’ouverture d’esprit a des limites.
Au juste, je ne sais pas trop ce qu’essaie de nous dire Kald Mig Far. Ou alors mon fonctionnement est un peu trop similaire à celui d’Emil pour être capable de l’entendre. Parce que si la blague c’est : « vous voyez, à force d’être tolérant pour tout, vous allez vous auto-détruire », mouaif. Mais bon, ce premier épisode, qui passe le plus clair de son temps à faire de l’exposition et réserve son événement déclencheur pour la toute fin, n’a pas forcément abattu toutes les cartes de la série. Ou peut-être aussi que je n’ai pas compris son angle. Vous le savez, les règles du jeu dans ce type d’exercice (qui consistent à ne regarder que le premier épisode de chaque série proposée au visionnage, sous peine de devoir faire des sacrifices) peuvent parfois conduire à des malentendus.
 Rictus
Rictus
 Comédie, Science-fiction
Comédie, Science-fiction
Une comédie très attentive à ce que personne ne rie… Dans un futur pas si lointain mais dystopique, la bienveillance a permis à tout le monde d’accéder à une vie idéale. Dans cette société, pourtant, quelque chose a disparu : le rire. Il est remplacé, au mieux, par un rictus absurde, presque cauchemardesque.
Bah oui parce que le rire est forcément oppressif quand on est nul en humour, et c’est donc la bataille qu’a décidé de mener Rictus : nous dire qu’à force de vouloir respecter les gens, le rire est devenu totalement interdit, sous peine de raid des forces d’intervention et de camps de rééducation. Pour obtenir cet effet, la video-surveillance s’est généralisée, la population est sur écoute en permanence par des drones qui quadrillent chaque rue, ce qui n’a l’air de gêner aucune personne « bienveillante » évidemment. On n’hésite pas non plus à torturer les enfants avec des casques infâmes (que même des orthodontistes des années 80 trouveraient choquants), si jamais ils commettent l’odieux faux-pas de rire dans une cour de récré. Voilà, Rictus a tout compris, this is the future liberals want.
Outre son idée de départ pourrie (on sait à qui elle plaira), ses dialogues sont pénibles (mais on n’a pas besoin d’être drôle quand il suffit de blâmer quiconque ne rit pas pour sa fermeture d’esprit !), débités sans énergie (et pas juste parce que ce monde est supposément fade et vidé de toute humanité), et ses perspectives de développement peu réjouissantes. Car forcément, son héros (un surveillant qui écoute la population en quête de tout rire illégal) va se confronter au rire et, comme l’indique sa scène introductive, finir par s’esclaffer à gorge déployée à son tour. Preuve que finalement ça a du bon, et que parfois il faut se lâcher quelles que soient les conséquences. C’est une révolution à la Ricky Gervais, ça.
Je voudrais vous dire que j’ai l’énergie de donner le bénéfice du doute à la série pour aller au-delà de ce pitch (parce que pour écrire toute une comédie traitant de l’importance de l’humour sur la base d’une seule blague, faut vraiment pas trembler des genoux), mais à quoi bon vous mentir ?
 Romantic Getaway
Romantic Getaway
 Comédie
Comédie
Allison et Deacon sont le 4e couple de cette compétition à faire l’expérience de problèmes de fertilité. Employées dans la même banque d’investissement, elles ont décidé avant même que ne commence la série qu’elles allaient voler 50 000 bitcoins à leur patron, Alfie, un connard insupportable. Et à vrai dire, le plan se déroule plutôt bien ! C’est si facile que, sur un coup de tête, Deacon décide même de voler 500 000 bitcoins ! Et encore, il en a laissé sur le compte. Tout est bien qui finit bien, sauf qu’évidemment ce n’est pas la fin, mais plutôt le début des ennuis. Entre le sentiment de culpabilité (Deacon ne se distingue pas par son amour de la prise de risque), Alfie qui continue d’être un absolu connard, et Allison qui ne dit pas toute la vérité sur le pronostic de l’expert en fertilité qu’elle consulte dans une clinique hors de prix, rien n’est simple.
…A part, peut-être, le scénario, qui ne brille pas franchement par son originalité. Ce premier épisode coche absolument toutes les cases, et ne se rend que là où il est parfaitement attendu. Les dialogues entre Deacon et Allison sont enlevés, mais ça s’arrête là : personne n’exprime ni ne fait quoi que ce soit d’imprévisible ici. C’est, au moins en partie, une question de travail d’exposition, qui par définition n’est pas le moment d’une série où les retournements de situation les plus fous se produisent, mais c’est quand même assez peu enthousiasmant en ce qui me concerne.
 The Lovers
The Lovers

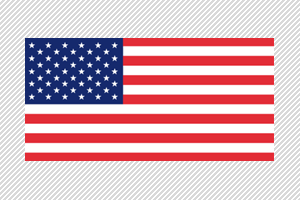 Dramédie, Romance
Dramédie, Romance
Janet et Seamus vivent une mauvaise journée. Lui est forcé de passer deux jours par semaine en Irlande du Nord pour le tournage de sa nouvelle émission, et vraisemblablement il n’avait aucune envie de retourner dans sa ville natale de Belfast, surtout pour se faire attaquer par des voyous. Elle est passée à deux doigts de se faire virer de son boulot de merde dans une grande surface, et a décidé de se foutre en l’air. Bon clairement il n’y a pas d’équivalence entre les deux journées, mais il n’empêche que ces deux inconnues se rencontrent exactement au moment où elles en ont le plus besoin. Dans le chaos des circonstances, Janet fait (malgré elle) de la place à Seamus, et Seamus tente quant à lui de mettre son (volumineux) ego de côté en réalisant ce qu’elle a failli faire. C’est suffisant pour que quelque chose se scelle entre elles…
Si l’on met de côté l’aspect profondément asymétrique de l’introduction des personnages (soyons honnêtes, la pire des journées pour Seamus a l’air d’un paradis sur Terre pour Janet !), mais que rien n’empêche d’être rééquilibrée par les épisodes ultérieurs en approfondissant les personnages, l’introduction de The Lovers fonctionne diablement bien. C’est doux-amer à souhait, tout en ayant ce petit côté Starstruck qui plaira sans doute pas à mal d’amatrices du genre. Je ne me compte pas parmi elles, ayant établi que je n’ai pas la moindre affinité avec la romance, mais le potentiel est difficile à ignorer.

Absolument toutes les séries de cette catégorie ont été mises à disposition, ce qui est un soulagement quand on sait combien ne trouveront probablement jamais une diffusion complète sous nos latitudes.
 Autodefensa
Autodefensa
 Dramédie
Dramédie
Berta et Belén sont jeunes et bourrées d’assurance, et à leur âge c’est le genre de chose qui peut suffire à mener la grande vie. Les deux jeunes vingtenaires partagent un appartement de Barcelone qui est le théâtre de leurs extravagances, les deux jeunes femmes ne s’interdisant rien…
Autodefensa est pleine d’une énergie difficile à ignorer ; le premier épisode tourne autour d’un lendemain de fête quand les deux amies, encore sous le coup d’une gueule de bois brutale, discutent de tout et rien. Mais, en particulier, la conversation s’oriente sur Samuel, qui est venu voir Berta tout penaud pendant que Belén était sortie. Les tours et détours de la mésaventure qui va suivre nous sont relatés depuis le confort du salon bordélique des héroïnes, agrémentés de flashbacks non seulement de la conversation avec Samuel, mais aussi de la raison de sa venue, qui remonte à la fête de la veille. Penaud, le jeune homme devient alors le sujet de moqueries, quand bien même, dans le fond, les deux amies comprennent que les enjeux dépassent son ridicule.
Le premier épisode d’Autodefensa, bien que n’étant pas ma tasse de thé (déjà que j’accrochais pas à Girls il y a 10 ans, alors c’est pas à mon grand âge que je vais me sentir concernée…), trouve un moyen de mettre en scène un « dilemme » moderne qui coche pas mal de cases en matière de représentation des problématiques du moment. Ce n’est pas franchement révolutionnaire, mais la série a au moins le mérite d’être amusante, bien menée, et saupoudrée d’un peu de nudité décomplexée histoire de bien enfoncer le clou.
 Canis Familiaris
Canis Familiaris
 Comédie
Comédie
Je ne vais pas vous mentir, j’avais bien envie de découvrir cette série (que Series Mania avait gardé pour la fin). De la nostalgie pour Wilfred, peut-être. L’espoir d’un Kyou no Nekomura-san à la française, éventuellement (…enfin, raisonné, l’espoir). Canis Familiaris est un drôle d’animal, pour le moment. Son premier épisode semble tracer les contours d’une série un peu ambiguë, avec une dynamique à la Kaamelott dans laquelle le chef (ou « mâle alpha », ici) est désœuvré, à la fois par ses troupes et par sa vie qui manque de sens… mais aussi une série en quête de poésie.
La dépression de Max est palpable et en même temps diffuse, plutôt intéressante surtout dans le contexte du quotidien d’un chien qui n’a pas les outils intellectuels pour s’interroger sur son propre ennui. Alors pour y trouver un remède, vous pensez bien… Là où je suis un peu plus dubitative, c’est sur les dynamiques de groupe. Elles sont un peu usées, dans le fond. Les autres canidées de la bande sont, pour la plupart, à peine plus intelligentes que Max (…et parfois beaucoup, beaucoup moins). Il y a un peu de rivalité avec Rocky, le caniche que personne n’aime, mais très franchement on ne le ressent pas comme une menace. On a l’impression que Canis Familiaris a une super idée centrale, parce que la série va clairement au-delà du gag « c’est des humaines dans des costumes », mais pour le moment ce premier épisode ne l’exploite pas assez.
 El Universo Conspira
El Universo Conspira
 Drama, Romance
Drama, Romance
L’univers conspire. L’univers conspire ! Que c’est joli.
Tout est joli, de toute façon, dans ce premier épisode : une tranche de vie dans l’existence de Bruno. Le jour de Pride est arrivé et il n’a pas vraiment l’intention d’y aller, mais plutôt de partir allumer un feu sous les fesses de son pote Rodo, qui a passé la matinée à dormir et va finir par se faire virer. A partir de ce simple point de départ, El Universo Conspira décide de suivre les minutes qui suivent avec douceur, ne voulant rien bousculer. Bruno prend le bus pour aller chez Rodo, où monte bientôt une drag queen à la jolie voix, et où il va tomber par hasard sur une vieille connaissance. C’est une journée comme une autre, et spéciale à la fois ; même si à la base Bruno n’a pas l’intention d’aller à la Pride, il ne peut ignorer qu’elle se tient aujourd’hui et que ça a un sens. Et ça donne d’autant plus de sens à sa rencontre avec Nicolas, également dans le bus. Ils échangent quelques mots, d’abord polis, puis amicaux. Des impressions sur le jour qu’il fait, des réactions à la façon dont le chauffeur du bus parle à la drag queen, ce genre de choses. C’est anodin et pourtant le contact passe… si bien qu’en descendant du bus au même arrêt que Nicolas, Bruno a beaucoup moins envie d’aller voir Rodo dans l’immédiat.
Ecoutez, c’est un épisode de 15 minutes, il ne faut pas s’attendre à une intrigue de folie. Et, c’est juste une théorie (je n’ai pas eu le temps de regarder d’autre épisode), mais je crois que d’El Universo Conspira il ne faut de toute façon pas attendre une intrigue de folie, plus largement. C’est plutôt une photographie qui donne dans le human drama (ce n’est pas sale). Et c’est peut-être la seule romance de ce festival à laquelle j’ai accroché.
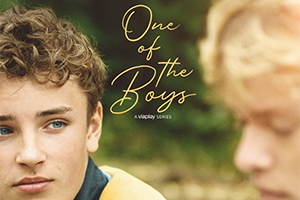 En af drengene
En af drengene
 Teen drama
Teen drama
C’est une série qui démarre comme un questionnement de la virilité : dans un village, il est de tradition pour les adolescents (masculin volontaire) qui viennent de passer leur diplôme de faire une expédition ensemble, jalonnée de challenges qui permettent de désigner lequel d’entre eux est un homme, un vrai. Ces tests, le jeune Lau va découvrir qu’ils tournent autour d’une certaine idée de la virilité : s’orienter en forêt, gagner une épreuve de force, etc. Sauf que Lau n’est pas très grand, n’est pas très musclé, n’est même pas vraiment très sociable. Il ne se sent pas d’atomes crochus avec les autres petits mecs de son âge, comme s’il avait le sentiment de n’avoir pas compris la private joke qui les unit. Tout change, cependant, lorsqu’un inconnu faisant partie de la virile virée, Aksel, l’approche. Aksel est grand, musclé, blond, extraverti ; il est aussi nouveau dans le village, ce qui instantanément attise la curiosité. Malgré leurs différences, Aksel l’a choisi comme compagnon de voyage, et tente de se lier avec Lau.
Mais c’est une série qui s’oriente vers une exploration de l’homosexualité, aussi. Lau est troublé par Aksel. Il est pris de sentiments mêlés lorsqu’il aperçoit par hasard, sur le portable du jeune homme, que celui-ci semble avoir (ou avoir eu ?) un petit ami… En af drengene mélange pas mal de choses et pour le moment ça se tient relativement bien. J’avoue trouver l’angle viriliste plus intéressant que la romance (mais je trouve que regarder de la peinture qui sèche est plus intéressant que de la romance, donc bon, je ne suis pas une référence), d’autant que le meilleur ami du père de Lau est là pour insister, comme incapable de voir que ça n’enchante pas le garçon, pour que Lau prenne l’initiative voire même se donne du mal pour gagner. Peut-être que Lau pressent que cette course à la virilité, il l’a déjà perdue ; peut-être qu’il s’apprête à réaliser que la virilité stéréotypique, il préfère la trouver chez d’autres plutôt qu’en lui-même ; peut-être qu’il ne comprend même pas vraiment ce que c’est que d’être un homme, tout simplement. Il y a plein de possibilités pour la suite de cette série qui peuvent être plutôt originales.
 Latecomers
Latecomers
 Comédie
Comédie
L’Australie n’aura pas eu beaucoup de séries au programme cette année, mais ce qu’elle n’aura pas eu en quantité, elle l’aura eu et largement en qualité. J’espère secrètement que des responsables de chez TFHein ont pris la peine de venir à Series Mania, en particulier pour assister à la projection de Latecomers… see how it’s done. Ah c’est sûr, c’est autre chose que le mou Lycée Toulouse-Lautrec, hein ? De l’humour vraiment drôle, une bonne dose de questionnements sur le sexe, et aucune infantilisation des protagonistes handicapées. Ça a du leur faire tout drôle, c’est le moins qu’on puisse dire. Et si jamais personne de chez TFHein n’a vu la série, pas même dans l’espace professionnel, je me porte volontaire pour leur envoyer les épisodes.
Tout ça dans un épisode efficace en diable, une exposition qui ne perd pas de temps mais ne bazarde pas les détails, et une héroïne principale franchement attachante dans son sarcasme teinté de fatalisme, qui bien-sûr va être rudement mis à l’épreuve. Tant mieux ! On a instantanément envie que tout ce petit monde s’envoie en l’air autant qu’il lui plaira, même en ayant conscience de la complexité de l’affaire à certains égards. Latecomers a son franc-parler, mais elle inclut tout le monde dans la conversation, si bien que même si les questions posées ne vous concernent pas directement, il est impossible de s’en sentir exclus. VOILA, c’est ça qu’on veut.
 Nichole
Nichole
 Comédie
Comédie
C’est avec des séries comme Nichole qu’on explore les limites de l’exercice consistant à ne regarder qu’un épisode de chaque série proposée. Il y a des séries, y compris des comédies, qui en moins de 10 minutes arrivent à faire des choses denses (…Latecomers y arrive bien, elle). Nichole, elle, est un peu plus longue à la détente, et ça signifie qu’il y a assez peu d’éléments, au terme de ce visionnage, pour avoir une opinion tranchée.
La série suit donc Nichole, une jeune femme qui se voit en future star de la chanson ; mais dans le premier épisode, on ne fera pas vraiment connaissance longuement avec le personnage, car l’exposition se fait en grande partie du point de vue de Manu, son meilleur pote, et son plus grand fan. Peut-être aussi le seul.
Nichole a clairement des rêves plein la tête, et il ne fait aucun doute que lui donner de l’attention est le genre de chose qui ne fait que valider ses ambitions… alors qu’il est difficile d’être aussi enthousiaste que Manu. La performance de la jeune femme à laquelle nous assistons dans ce premier épisode se déroule après tout sur la scène d’un petit bar (et encore, certains clients sont plus intéressés par les machines à sous dans le fond de la salle…), pendant une soirée open mic. Pas franchement le début de la célébrité, que pourtant Nichole et Manu semblent considérer comme une évidence. Il apparaît que c’est sûrement de ça dont la série veut parler, et le genre du mockumentary, dont l’essentiel de l’humour repose sur l’hypocrisie et/ou le mensonge à soi-même, semble parfait pour cela. Pour autant… il est un peu tôt pour saisir où la série veut en venir. Dans quelle mesure ce mockumentary va être un exercice plutôt d’humiliation ou plutôt d’introspection, et quel est le propos véritable derrière l’enthousiasme débordant de ses deux protagonistes centrales ? Il faudrait en voir plus. Peut-être dans une réalité où les journées font plus de 24 heures ç’aurait été possible.
 Outo kesä
Outo kesä
 Teen drama
Teen drama
Est-ce l’ennui ? Ou juste le fait d’être jeunes et pas vraiment sensées ? Probablement un peu des deux. Minna et Aino, qui se retrouvent après que la seconde ait passé les deux dernières années à traverser le monde en sac à dos, partagent le temps d’un été le petit appartement de la première, et cumulent les heures dans un job temporaire mais peu excitant. Toujours est-il que les deux jeunes femmes n’ont pas grand’chose d’intéressant à faire, et que, dans l’excitation d’une soirée, décident de s’introduire dans la maison d’inconnues. Outo kesä (proposée l’été dernier sur Yle Areena, j’espère que ça n’a donné d’idées à personne) est une série qui commence comme un thriller, mais qu’on ne s’y trompe pas, c’est un teen drama.
En un quart d’heure environ, on pourrait croire qu’il n’y a pas beaucoup de temps pour autre chose que l’exposition… sauf que Outo kesä est quand même plutôt futée, et arrive à faire passer plein de petits détails assez subtils. Sur son univers, ses personnages, ce qui les tarabuste… Les grands yeux admiratifs de Minna ne cachent par exemple pas vraiment son émerveillement à voir Aino se tenir à nouveau devant elle, en chair et en os. C’est ainsi qu’elle va se trouver emportée dans son sillage, alors qu’Aino, fortifiée par des aventures internationales (réelles ou embellies), se sent intouchable. Est-ce le cas ? Rien n’est moins sûr. Toutefois le premier épisode ne nous dévoilera pas vraiment à quel point les choses peuvent dégénérer à partir de son postulat de départ, d’autant que je n’ai pas vu le court métrage sur laquelle la série est basée.
 Pět let
Pět let
 Drama
Drama
C’est un rendez-vous comme toute future autrice rêve d’avoir : une éditrice passionnée, intéressante, et patiente. Mais alors que cet entretien prometteur devrait la réjouir, quand bien même son travail sur la cancel culture est passé au crible (et ne convainc pas tout-à-fait), Tereza n’arrive pas à s’ôter de la tête que quelques minutes plus tôt, dans la rue, elle a croisé David. Or, David n’est pas n’importe qui : le soir de sa remise de diplômes, cinq ans plus tôt, il a violé Tereza. Troublée, la jeune femme s’en ouvre à l’éditrice féministe, qui lui propose, si elle s’en sent la force, d’écrire plutôt sur ce sujet.
C’est la règle dans la catégorie « Formats courts » (et c’est écrit dessus), les épisodes ne sont pas très longs. Faute de vraiment avoir beaucoup de substance, ou le temps de regarder les deux épisodes suivants proposés par Series Mania, j’ai trouvé un peu difficile de me forger une opinion sur Pět let (ou Five Years à l’exportation). On n’est pas vraiment aidées par l’incarnation volontairement un peu froide de son interprète principale, qui nous tient à une distance que la série semble juger nécessaire… Peut-être parce qu’elle veut jouer à « toute histoire a deux versions » par la suite, et que cette distance autorise à ne pas immédiatement prendre fait et cause pour elle ? C’est toujours un procédé qui me chagrine, et que beaucoup de fictions adoptent comme si notre société avait trop d’empathie pour les victimes de viol. Ici, en tout cas, on n’en court pas trop le risque, reste à voir comment le reste de la série développerait les choses à partir de là.
Bilan : ma foi, on a vu pire. Certes, il y a des séries qui se sont montrées très décevantes (et d’autres qui ne pouvaient pas décevoir parce que je n’en attendais rien), mais je reconnais avoir moins de patience que dans mes jeunes années avec certaines choses. Toutefois il y a eu aussi, comme chaque année, de puissants coups de cœur, que j’espère pouvoir faire durer en voyant les épisodes suivants un jour ou l’autre. Du coup, on en reparlera en temps voulu ; dans l’intervalle je vous libère, et m’en vais chercher mes épisodes de Funny Woman.

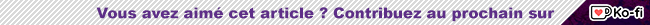
Lire la suite »


























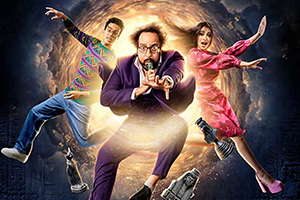


 Marba Al Ezz
Marba Al Ezz






























 Sous Contrôle
Sous Contrôle