En commençant une série historique située dans un pays lointain, il n’est pas rare que je me pose plein de questions. Et c’est bien normal, quand rien ne nous a préparées à des pans entiers de l’Histoire mondiale. Dans le cas de TAJ, lancée la semaine dernière sur la plateforme indienne Zee5, la question dominante à mes yeux était toutefois un peu atypique.
C’est un peu compliqué mais, disons pour résumer qu’on pourrait la formuler ainsi : « …qu’est-ce que le fuck ?! ».
Parce que, oui, figurez-vous que TAJ est la deuxième série indienne en l’espace de deux ans seulement à s’attaquer à un aspect très précis de l’Histoire du sous-continent, en se penchant sur l’empire mughal. La première série à s’être emparée du sujet était nulle autre que The Empire, l’une des séries indiennes que j’ai le plus aimées ces dernières années. Ce qui n’est pas peu dire. Proposée par Disney+ Hotstar pendant l’été 2021, elle voulait vraisemblablement dresser le portrait de plusieurs têtes couronnées de la dynastie issue de l’empereur Babur… mais on ne saura jamais lesquelles précisément, parce qu’après avoir été tout feu tout flamme au sujet d’une saison 2 (certains des acteurs en parlaient comme si c’était signé !), on n’a plus eu de nouvelles. Et croyez-moi, je lance des recherches régulièrement.
En cause ? Eh bien, le fait que l’empire mughal, pour autant qu’il fasse partie de l’Histoire de la région (et notamment, on lui doit la construction du Taj Mahal… je vois que vous suivez), a quand même été un envahisseur musulman, avec ce que cela inclut de massacres des populations hindoue et sikh pendant la conquête de l’Hindustan. Dans l’ambiance actuelle, en Inde, ça en fait un sujet sensible. Et effectivement, The Empire s’en est pris plein la gueule au moment de sa sortie, accusée que la série était de faire l’éloge de Babur. Des voix nationalistes et/ou anti-musulmanes se sont emparées de la polémique… et je n’ai aucun mal à imaginer Disney comme la production à préférer éviter que les choses ne s’enveniment. On n’en aura probablement jamais la confirmation officielle, toutefois.
Vous comprenez bien que je sois surprise qu’une autre plateforme de streaming, Zee5, se soit dit « eh bah vous savez quoi, ça semble être un excellent sujet de série ! » dans ce contexte.
L’existence de TAJ suggère à partir de là deux possibilités : soit Zee5 a plus de courage que Disney+ Hotstar… soit elle en a encore moins, et a décidé de s’aplatir devant les critiques (rarement adressées à la série elle-même) affrontées par The Empire.
Le suspense est insoutenable.

TAJ fait plusieurs choix qui, dés son premier épisode, démontrent assez bien quelle démarche a été choisie.
Le premier de ces choix est de tout simplement ne pas parler de la naissance de l’empire mughal, et de se défausser de la figure de Babur : la série commence directement sur une campagne menée en 1568 par son petit-fils, Akbar, troisième empereur de la dynastie. Pendant le siège de Chittor, qui a piétiné pendant plusieurs mois mais a finalement débouché sur un massacre, celui-ci est en effet pris par la soudaine réalisation qu’il n’a pas d’héritier, et vient chercher le conseil de quelque sage. Le vieil homme en question ne manque pas de lui rappeler qu’il a tué le fils de nombreuses mères pendant ses campagnes, et que vouloir un fils à son tour semble hypocrite ; en outre, s’il était un meilleur empereur, il considèrerait son peuple comme ses enfants… Mais qu’il ne se trouble pas, dans son futur il y a bien non pas un, mais trois fils. Toutefois, ce présage s’accompagne d’un autre moins réjouissant, quoique vague, qui annonce qu’Akbar assistera à un bain de sang au sein de sa propre famille.
La tagline de TAJ, après tout, est « Divided by Blood » (c’était un thème que préparait la fin de la première saison de The Empire aussi).
Après quoi TAJ opère un bond de plusieurs décennies en avant, pour nous montrer les trois fils d’Akbar qui ont effectivement vu le jour : Salim, l’aîné et donc héritier traditionnel du trône, un homme à femmes qui aime faire la fête ; Murad, un guerrier accompli mais détestable et vindicatif ; et puis Daniyal, encore adolescent, pieux mais couard. Bref, aucun fils vraiment digne de reprendre le flambeau, et ça n’a pas échappé à Akbar.
Comme si ce dernier manquait de problèmes, il lui faut également prendre en considération son propre demi-frère Mirza Hakim, plus jeune que l’empereur vieillissant, et qui considère avec mépris le règne d’Akbar. Celui-ci a en effet cessé ses conquêtes sanglantes et offert sa protection aux populations hindoues se pliant à son règne. L’une de ses femmes est également Jodha, une Hindoue, la seule dont il écoute le conseil d’ailleurs. Mirza Hakim ambitionne de reprendre l’invasion au nom d’Allah, de se débarrasser de tout ce qui n’est pas musulman, et tant qu’à faire, de monter sur le trône mughal dans la capitale d’Agra, pourquoi se gêner.
 Le propos moral de TAJ n’est pas exactement subtil : il y a les bonnes musulmanes (qui sont pas trop musulmanes) et les mauvaises musulmanes (qui sont très musulmanes). Ce n’est pas un hasard si l’essentiel de l’intrigue se focalise sur l’opposition des protagonistes musulmanes entre elles ! La série met un point d’honneur à commencer par un massacre hindou, pour le punir moralement (via une prophétie sanglante), puis forcer les membres de la famille d’Akbar à se déchirer, se jalouser, et même lancer des guerres les unes contre les autres.
Le propos moral de TAJ n’est pas exactement subtil : il y a les bonnes musulmanes (qui sont pas trop musulmanes) et les mauvaises musulmanes (qui sont très musulmanes). Ce n’est pas un hasard si l’essentiel de l’intrigue se focalise sur l’opposition des protagonistes musulmanes entre elles ! La série met un point d’honneur à commencer par un massacre hindou, pour le punir moralement (via une prophétie sanglante), puis forcer les membres de la famille d’Akbar à se déchirer, se jalouser, et même lancer des guerres les unes contre les autres.
Le sujet de TAJ, c’est l’auto-destruction de la dynastie mughal, sans ambiguïté.
Dans ce cadre, il n’y a pas vraiment de façon d’être musulmane qui fonctionne, en fait. Par exemple, prenez Daniyal, le frêle avorton de la famille qui n’a aucun courage, et qui même quand il se plie simplement aux principes de sa religion sans faire de mal à qui que ce soit est présenté comme médiocre (ça empire au fur et à mesure de la saison, d’ailleurs)… La série va même nous révéler que ce n’est pas par ferveur religieuse qu’il ne touche pas de femme : il est gay ! Un comportement présenté comme honteux, en plus d’être réprouvé par quiconque en prendrait connaissance. Les choix que Daniyal fait sont ainsi, en surface, motivés par la religion, mais au final ne conduisent quand même à rien qui soit considéré comme noble. On peut également mentionner la haute figure religieuse du palais, Badayuni, qui est le premier à s’assurer d’une place auprès du pouvoir en cas de changement d’empereur, et n’hésite pas à employer l’Islam le plus conservateur possible comme argument d’autorité quand il veut faire taire les opinions divergentes… Et puis, que dire de Mirza Hakim qui parle de Jihad et d’infidèles à éradiquer (…mais qui bien-sûr n’est pas uniquement motivé par la religion), et dont les méthodes dépeintes comme arrogantes, cruelles et même barbares ne laissent aucun doute quant à son rôle de « méchant ». A noter qu’en réalité, Murad a été en partie élevé par un Jésuite, Antonio Montserrate, sporadiquement présent dans la série mais pas spécialement montré comme une influence importante pour Murad.
Le cas Akbar peut sembler plus ambigu de prime abord. Quand il était jeune, on lui a promis un bain de sang familial comme punition pour ses actions à lui (il pense que cette prophétie concerne son frère Mirza Hakim…). Actions qui, vous l’aurez compris, sont surtout jugées à l’aune des massacres hindous, et qui servent aussi de prétexte pour également punir ce que ses ancêtres mughal symbolisent. Sauf que quels que soient ses efforts, aucune action ne vient effacer cette dette de sang initiale qu’il a contractée en massacrant des populations hindoues pendant ses campagnes plusieurs décennies plus tôt. Peu importe qu’Akbar semble être juste, ou qu’il soit plus libéral et ouvert à la pluralité. Surtout quand son ego s’en mêle… d’autant que son interprétation d’une société multi-confessionnelle est quand même de s’auto-proclamer figure centrale d’une nouvelle religion, Din-i-llahi, suite à un, euh, rêve. Bon.
Bref, dans TAJ, être de confession musulmane, c’est être soit violent, soit arrogant, soit hypocrite. Et souvent une combinaison des trois.
 Alors, quel personnage s’en tire réellement la tête haute dans cette galerie de personnages ? Vous ne devinerez jamais : c’est Jodha, l’épouse hindoue de l’empereur, tentant d’orienter son époux vers la raison (rarement avec succès). Enfin… non, il n’y a pas qu’elle. On peut aussi citer une mystérieuse jeune femme hindoue qu’Akbar cache à absolument tout le monde, Anarkali, enfermée dans une pièce secrète du harem depuis ses 14 ans. Anarkali est une figure tragique, qui n’existe que pour jouer la victime, et l’intrigue ne va pas se gêner. Mention honorable mais très passagère pour Bakht-Un-Nissa, sœur et conseillère de Mirza Hakim, qui n’hésite pas à lui faire savoir ce qu’elle pense de ses massacres hindous (encore) bien que sa priorité soit la sécurité de Kabul. Toutefois, même si leur tempérament est montré comme noble, on ne s’intéressera que modérément à leur sort : TAJ est une affaire d’hommes. Justement, du côté de ceux-ci, on pourrait mentionner les deux conseillers les plus fidèles d’Akbar, Man Singh, un Rajput hindou qui est également son général, et Birbal, un Hindou plutôt calé sur la diplomatie (la série évite soigneusement de mentionner qu’il s’est converti après la fondation de Din-i-llahi…). Ils se présentent systématiquement comme la voix de la raison, s’exprimant hélas dans une oreille d’Akbar avant que ça ne ressorte par l’autre.
Alors, quel personnage s’en tire réellement la tête haute dans cette galerie de personnages ? Vous ne devinerez jamais : c’est Jodha, l’épouse hindoue de l’empereur, tentant d’orienter son époux vers la raison (rarement avec succès). Enfin… non, il n’y a pas qu’elle. On peut aussi citer une mystérieuse jeune femme hindoue qu’Akbar cache à absolument tout le monde, Anarkali, enfermée dans une pièce secrète du harem depuis ses 14 ans. Anarkali est une figure tragique, qui n’existe que pour jouer la victime, et l’intrigue ne va pas se gêner. Mention honorable mais très passagère pour Bakht-Un-Nissa, sœur et conseillère de Mirza Hakim, qui n’hésite pas à lui faire savoir ce qu’elle pense de ses massacres hindous (encore) bien que sa priorité soit la sécurité de Kabul. Toutefois, même si leur tempérament est montré comme noble, on ne s’intéressera que modérément à leur sort : TAJ est une affaire d’hommes. Justement, du côté de ceux-ci, on pourrait mentionner les deux conseillers les plus fidèles d’Akbar, Man Singh, un Rajput hindou qui est également son général, et Birbal, un Hindou plutôt calé sur la diplomatie (la série évite soigneusement de mentionner qu’il s’est converti après la fondation de Din-i-llahi…). Ils se présentent systématiquement comme la voix de la raison, s’exprimant hélas dans une oreille d’Akbar avant que ça ne ressorte par l’autre.
A ce stade vous aurez sûrement compris comment se jouent les dynamiques : les protagonistes hindoues ont la tête sur les épaules, mais ne sont jamais écoutées, et ont tout à perdre de leur proximité avec l’empereur. Rien ne leur sera épargné parce que, dans le fond, bien qu’appartenant à la cour impériale mughal, elles restent hindoues, et donc des victimes des passions de l’empereur.
Dans une certaine mesure, Salim est aussi un protagoniste relativement positif. Cela se communique essentiellement par contact avec sa mère, qui essaie de l’influencer pour qu’il prenne sérieusement sa position d’héritier du trône, et par sa romance impossible avec Anarkali (…deux protagonistes hindoues, donc). TAJ le traite comme ce qu’il y a de plus proche d’un héros romantique, et ce n’est pas un hasard que son comportement, eut égard aux femmes (d’ailleurs pas nécessairement de sa propre ethnie) et à diverses substances (dans certains des épisodes, il consomme de l’opium… d’ailleurs explicitement présenté comme « la seule richesse que Kabul ait à offrir »), soit si peu présenté comme adéquat pour un musulman. Moins encore un futur empereur musulman.
Sa vocation, de toute manière, est d’être l’enjeu amoureux d’une tragédie intéressant bien plus TAJ que toute autre partie de son intrigue, plutôt que de se focaliser sur son rôle d’héritier.
…Et puis, c’est une position bien précaire, car Akbar, convaincu que Mirza Hakim remet son règne en question parce que c’est l’aîné qui a hérité de l’empire mughal, décide que ce sera lui qui choisira son propre héritier. Au mérite. Donc Salim n’est plus nécessairement le futur empereur, et ses frères Murad et Daniyal, s’ils se montrent compétents, ont leur chance de monter sur le trône à Agra.
Enfin, en théorie en tout cas, car TAJ ayant décidé qu’ils ne sont pas de bons personnages, a en réalité déguisé derrière cette intrigue un parcours initiatique pour Salim. Akbar est déjà convaincu de qui doit lui succéder, il veut juste que chaque frère pense que c’est mérité. Cette histoire de mérite, c’est avant tout un argument moral : ce ne sont pas les actions qui intéressent Akbar ou la série elle-même, mais plutôt l’âme de ses fils. Quoiqu’ils fassent, leur intention est ce qui est examiné.
Tout dans TAJ est vu par le prisme religieux et moral, et en particulier à travers les yeux des intérêts hindous. L’Histoire du pays (quand bien même elle remonte à 5 siècles en arrière) ne peut se lire que de cette façon pour être acceptable.
Toute protagoniste qui veut causer du tort à une autre qui serait de religion hindoue est, immédiatement, disqualifiée. C’est sans appel. Aucune action ultérieure ne peut réellement changer cela. Tout personnage qui parle ou même pense un peu trop à Allah est également d’emblée déconsidéré ; généralement ces personnages ont même tendance à employer la religion comme couverture pour leurs ambitions personnelles (en gros, il n’y a pas de véritable foi possible pour un personnage musulman dans TAJ). Et de toute façon, quoi que fasse tout ce petit monde, c’est toujours présenté avec comme inéluctable conclusion que l’empire mughal va un jour tomber, et que franchement ce sera mérité. Et si vous vous posez la question : oui, l’empire mughal va effectivement chuter… deux siècles après les événements de cette saison.
Toute l’intrigue va se dérouler selon ces principes.
Vous serez donc surprise d’apprendre que la diffusion de TAJ n’a pas mené à une levée de boucliers, pas même parmi les voix nationalistes et/ou anti-musulmanes qui s’étaient élevées il y a à peine deux ans pour The Empire.
 Alors je l’admets volontiers : ça fait deux ans que j’ai des étoiles dans les yeux en pensant à The Empire. Je l’ai sincèrement aimée, cette série ; j’ai aimé à la fois son esthétisme et son interrogation du pouvoir. Je ne vais pas répéter ici ce que j’ai dit dans la review d’alors, mais il y avait un propos autour des choix que l’on fait (et ceux que Babur, en particulier, faisait) quand on peut tout ; de la façon dont on prend, garde et utilise le pouvoir ; et une interrogation sur, peut-être, la façon dont on pourrait envisager de le partager. La promesse d’une saison 2 résidait précisément dans la difficulté à le faire, car il n’est pas dans la nature du pouvoir d’être équitablement partagé.
Alors je l’admets volontiers : ça fait deux ans que j’ai des étoiles dans les yeux en pensant à The Empire. Je l’ai sincèrement aimée, cette série ; j’ai aimé à la fois son esthétisme et son interrogation du pouvoir. Je ne vais pas répéter ici ce que j’ai dit dans la review d’alors, mais il y avait un propos autour des choix que l’on fait (et ceux que Babur, en particulier, faisait) quand on peut tout ; de la façon dont on prend, garde et utilise le pouvoir ; et une interrogation sur, peut-être, la façon dont on pourrait envisager de le partager. La promesse d’une saison 2 résidait précisément dans la difficulté à le faire, car il n’est pas dans la nature du pouvoir d’être équitablement partagé.
Dans TAJ, la démarche est à mille lieues de tout cela. Je ne sais pas si les historiennes ont jugé la dynastie mughal, mais les scénaristes ont rendu leur verdict, sans doute possible. Peu importent les choix des personnages : c’est leur nature qui compte. Et cette nature se définit par un critère et un seul : leur comportement vis-à-vis des Hindoues. Aucun autre choix n’existe, et du coup il n’y a pas d’interrogation, pas de dilemme, pas de conflit interne. Leurs émotions ne comptent même pas vraiment : tout tiraillement est résolu par ce simple théorème. Les protagonistes n’existent pas : elles font juste partie de la démonstration qu’il est justifié de haïr les mughal, ou au moins s’en méfier.
C’est une logique différente des séries historiques dans lesquelles les personnages n’existent que par leur fonction, leur rôle dans les événements connus, leur ligne factuelle dans les livres d’Histoire ; mais le résultat est le même : ce n’est pas de la bonne fiction.
Dramatiquement, TAJ n’a pas vraiment grand’chose à offrir au-delà de ça. Plusieurs de ses intrigues secondaires prouvent qu’il y avait du matériel pour créer d’autres enjeux, mais rien n’en est vraiment fait.
Un exemple parfait de cela est l’épisode, environ à mi-saison, pendant lequel Akbar est victime d’une tentative d’empoisonnement dont il réchappe, mais qui le pousse à faire croire à tout le palais qu’il est sur son lit de mort. L’occasion parfaite d’interroger et torturer tout le palais… une occasion dont la série ne se saisit pas vraiment, peu de choses avançant pendant cet épisode qui aurait pu être le pivot de la saison. Je repensais à un épisode similaire de la saison 1 de The Great (pourtant largement moins sérieuse par plusieurs aspects !), et la façon dont cet épisode sert à la fois à du torture porn et à faire progresser le statut de Catherine à la cour. TAJ n’est même pas capable de ça, se contentant de faire confirmer certaines choses déjà sues depuis plusieurs épisodes par les spectatrices… et d’abondamment montrer la violence des mughal, bien-sûr (tout en faisant mine de mettre vaguement Salim en danger). Tant d’opportunités ratées dans cette série.
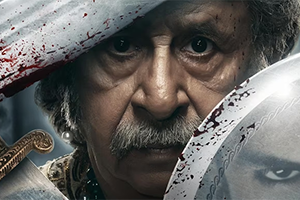 C’est d’autant plus dommage que, en choisissant Akbar pour ancre de sa série sur la dynastie mughal (par opposition à Babur, notamment), TAJ avait l’opportunité de raconter bien d’autres histoires. Ce que l’on sait de la réalité historique suggère que le rapport d’Akbar à la curiosité et tolérance des autres religions était profond et complexe. Il était illettré mais que malgré voire grâce à cela, il a été désireux d’apprendre de nombreuses religions, organisant de nombreux débats religieux. Savez-vous qu’en réalité, il s’est arrangé pour que Murad soit le premier de ses fils à être éduqué selon différentes religions, au lieu d’une seule ? Le peu que j’ai appris pendant mes recherches à l’occasion de cette review était fascinant ; je n’imagine même pas ce que ç’aurait été en allant plus loin, avec les moyens de faire des recherches pour un scénario comme celui de TAJ. Son progressisme aurait pu faire l’objet de la série toute entière (y compris avec ses aspects moins reluisants, lorsqu’il se place au centre de Din-i-llahi), et questionner l’Histoire multi-éthnique et multi-religieuse de l’Inde à travers lui. Mais TAJ n’a aucune envie d’étudier l’intériorité d’un roi mughal… et clairement n’a aucun intérêt pour une société pluraliste non plus. Du moment où Akbar décrète vouloir faire une place égale à toute les religions, c’est là que la série s’intéresse aux mouvements dissidents menaçant de fracturer son royaume depuis l’extérieur ! Honnêtement si quelqu’un d’autre veut adapter la vie d’Akbar en série, on n’en est plus à une série sur un roi mughal près et personne ne pourrait faire pire que TAJ.
C’est d’autant plus dommage que, en choisissant Akbar pour ancre de sa série sur la dynastie mughal (par opposition à Babur, notamment), TAJ avait l’opportunité de raconter bien d’autres histoires. Ce que l’on sait de la réalité historique suggère que le rapport d’Akbar à la curiosité et tolérance des autres religions était profond et complexe. Il était illettré mais que malgré voire grâce à cela, il a été désireux d’apprendre de nombreuses religions, organisant de nombreux débats religieux. Savez-vous qu’en réalité, il s’est arrangé pour que Murad soit le premier de ses fils à être éduqué selon différentes religions, au lieu d’une seule ? Le peu que j’ai appris pendant mes recherches à l’occasion de cette review était fascinant ; je n’imagine même pas ce que ç’aurait été en allant plus loin, avec les moyens de faire des recherches pour un scénario comme celui de TAJ. Son progressisme aurait pu faire l’objet de la série toute entière (y compris avec ses aspects moins reluisants, lorsqu’il se place au centre de Din-i-llahi), et questionner l’Histoire multi-éthnique et multi-religieuse de l’Inde à travers lui. Mais TAJ n’a aucune envie d’étudier l’intériorité d’un roi mughal… et clairement n’a aucun intérêt pour une société pluraliste non plus. Du moment où Akbar décrète vouloir faire une place égale à toute les religions, c’est là que la série s’intéresse aux mouvements dissidents menaçant de fracturer son royaume depuis l’extérieur ! Honnêtement si quelqu’un d’autre veut adapter la vie d’Akbar en série, on n’en est plus à une série sur un roi mughal près et personne ne pourrait faire pire que TAJ.
Au passage je veux bien qu’on m’explique pourquoi cette série a, à son générique, autant de scénaristes, réalisateurs et producteurs exécutifs (masculin volontaire) qui ne sont PAS Indiens, et n’ont souvent même jamais travaillé pour l’industrie audiovisuelle indienne avant. Ce, alors que la distribution et l’équipe technique, ainsi que l’équipe exécutive de Zee5, sont dans leur immense majorité indiennes. Ron Scalpello, William Borthwick, Christopher Butera, Simon Fantauzzo, Jason Newmark… voilà, de cette série-là je veux une oral history, ça ça m’intéresse.
Cette review est un peu longue, même d’après mes propres standards. De toute évidence, j’aurais pu vous épargner cette lecture en vous disant simplement que TAJ n’est juste pas une bonne série. Qu’elle n’est même pas spécialement belle (ah oui parce que, ça aussi). Qu’il m’est arrivé de m’endormir devant ses épisodes ou de les mettre en pause pendant plus d’une heure par ennui. Que franchement, sur le fond comme sur la forme, c’est dispensable. Et vous savez quoi, je viens aussi de le dire.
Cependant, je crois qu’on s’accordera toutes à dire qu’il y a un arrière-goût dégueulasse dans ses choix, qui méritait d’être mentionné et expliqué. Par les temps qui courent, il faut prendre ce temps.




















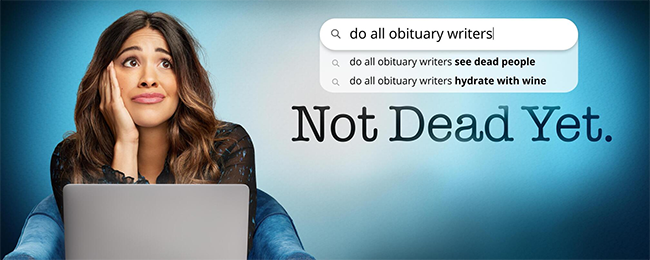

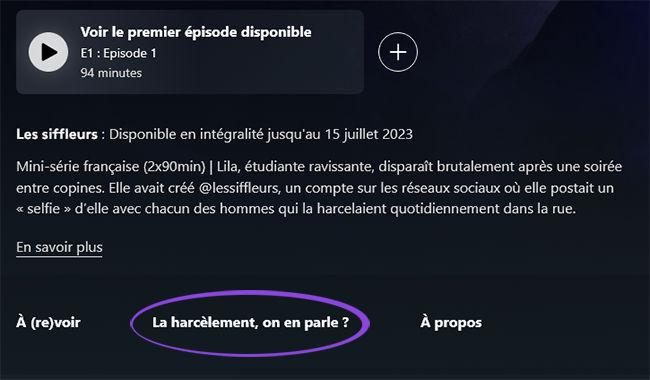 Ou, pardon : LA harcèlement. Oui, bon. C’est à la mesure du traitement, on va dire.
Ou, pardon : LA harcèlement. Oui, bon. C’est à la mesure du traitement, on va dire.














 Les nuances apportées par l’aspect romance sont ainsi bien plus significatives sur le fond.
Les nuances apportées par l’aspect romance sont ainsi bien plus significatives sur le fond. En fait, ce choix témoigne d’une vision à long terme plutôt futée. Dans Gungmin Yeoreobun!, il y a tout un aspect politique que le premier épisode effleure à peine (et le deuxième pas vraiment plus), mais qui repose en partie sur l’influence de la famille de Mi Young. Ici, Emma a une famille influente de façon relativement similaire, et on la verra d’ailleurs interagir avec sa mère, son père et son frère, toutes les trois riches et importantes dans la vie politique locale, ainsi que dans la vie d’Emma qui subit beaucoup de pression de leur part (d’autant qu’elles ignorent qu’elle travaille à la CIA). L’invention de la famiglia Nicoletti introduit donc un effet de balance : il y a désormais des forces équivalentes pour peser sur les enjeux du couple Charlie/Emma, ainsi que sur les intrigues politiques à venir. The Company You Keep semble avoir complètement repensé les dynamiques qui sous-tendent ses intrigues sur le long terme, et j’avoue que je vois très, très peu de remakes fournir une réflexion aussi poussée quand rien ne les y force.
En fait, ce choix témoigne d’une vision à long terme plutôt futée. Dans Gungmin Yeoreobun!, il y a tout un aspect politique que le premier épisode effleure à peine (et le deuxième pas vraiment plus), mais qui repose en partie sur l’influence de la famille de Mi Young. Ici, Emma a une famille influente de façon relativement similaire, et on la verra d’ailleurs interagir avec sa mère, son père et son frère, toutes les trois riches et importantes dans la vie politique locale, ainsi que dans la vie d’Emma qui subit beaucoup de pression de leur part (d’autant qu’elles ignorent qu’elle travaille à la CIA). L’invention de la famiglia Nicoletti introduit donc un effet de balance : il y a désormais des forces équivalentes pour peser sur les enjeux du couple Charlie/Emma, ainsi que sur les intrigues politiques à venir. The Company You Keep semble avoir complètement repensé les dynamiques qui sous-tendent ses intrigues sur le long terme, et j’avoue que je vois très, très peu de remakes fournir une réflexion aussi poussée quand rien ne les y force.







