Régulièrement, je me plains qu’il est beaucoup plus facile d’accéder au patrimoine télévisuel étasunien que n’importe quel autre de la planète (les séries françaises et britanniques étant ponctuellement des exceptions). Où sont les séries australiennes ou canadiennes des années 50 ou 70, ou même 90 ? Je ne demande pas un accès miraculeux à des séries sud-africaines ou égyptiennes des décennies passées : c’est déjà pas facile d’accéder à celles qui sortent maintenant, surtout si on commence à vouloir des sous-titres, alors ne demandons pas la lune (…en tout cas pas tout de suite). Mais pour certains pays, ça ne devrait pas être si difficile. Et puis, j’ai souvent l’impression de passer beaucoup de temps à réagir à l’actualité, plutôt que simplement prendre le plaisir de regarder des séries, comme ça, just because.
Il y a plusieurs mois, je suis tombée sur le premier épisode de Scoop, série québécoise lancée en 1992, et je me suis dit : bingo ! A l’origine j’avais prévu de parler de la série à l’occasion de son anniversaire, en janvier dernier, hélas, ce mois-là, je publiais 7 reviews par semaine, et il a fallu faire des choix dans mon organisation. Ensuite j’ai voulu le faire pendant l’été, mais ma capacité à former des phrases cohérentes était plus que diminuée, et vous n’avez pas eu droit à la review non plus.
On va donc corriger ça avant que l’année ne finisse, comme ça on dira que c’est toujours son anniversaire.

Les séries sur le journalisme, c’est comme les séries anciennes : il y en a plein, mais il n’y en a jamais assez.
La série québécoise Scoop a été créée par Réjean Tremblay (à qui on doit Lance et compte, institution de la télévision canadienne francophone) et Fabienne Larouche (que je vous avais présentée ici), toutes les deux étant journalistes de formation. Cela explique d’ailleurs probablement qu’il existe autant de séries sur le journalisme : les passerelles professionnelles sont plus faciles que, disons, de la boulangerie à l’écriture de séries.
L’action se déroule au sein de la rédaction de L’Express, qui dans le cas présent est un quotidien. Le journal est détenu par Émile Rousseau, un homme riche à la tête d’un empire dont L’Express n’est que l’un des joyaux. Toutefois il n’assure pas de fonctions au sein de la rédaction, laquelle, d’ailleurs, n’a pas d’éditeur lorsque la série commence. Le personnel de L’Express inclut en revanche Claude Dubé, rédacteur en chef ; Lionel Rivard, secrétaire de rédaction ; Richard Fortin dit « Tintin », un journaliste un peu gauche ; et, quand commence le premier épisode, une nouvelle recrue, Michel Gagné, qui débute pour la rubrique faits divers. Dans ce panorama très masculin, Stéphanie Rousseau est une des rares journalistes féminines de la rédaction ; elle travaille au départ sur un sujet relatif à l’environnement, et a la chance d’être envoyée en reportage auprès du ministre de l’Environnement, auprès duquel elle a réussi à décrocher une interview.
Vous l’aurez remarqué, Stéphanie partage avec le propriétaire du journal un nom de famille : ce n’est pas un hasard (nepo baby !), et c’est même une source de conflit. Ancienne joueuse de tennis, elle s’est engagée dans le journalisme contre l’avis de son père, et apparemment a démarré au bas de l’échelle comme tout le monde (si l’on en croit une réplique qu’elle lance à Michel sur sa propre expérience aux faits divers). Elle a cependant l’ambition de faire du journalisme coup de poing, et le premier épisode va la mettre dans une situation qui s’y prête.
C’est que, logée dans le même hôtel que le ministre qu’elle doit interroger le lendemain, Stéphanie fait une rencontre fortuite : celle de « Carla », au bar, qui lui fait part de son admiration depuis qu’elle est une petite fille pour sa carrière sportive et notamment sa prestation à Wimbledon. Sauf qu’un rapide calcul permet à Stéphanie de comprendre que « Carla » a environ 16 ans… et quand elle surprend le ministre dans sa chambre d’hôtel, avec « Carla » (si c’est bien son vrai nom), forcément elle tient un sujet bien plus important que ces histoires d’écologie qui, ah de toute façon quelle importance ça pourrait bien avoir, pas vrai ? Alors qu’un scandale politique sur un ministre (voire même, de l’avis de beaucoup de monde, un futur Premier ministre) qui a recours à une prostituée mineure, ça, c’est du sujet.
Scoop, toutefois, prend cette situation pour en faire quelque chose de bien plus intéressant qu’il n’y paraît. Car il ne s’agit pas juste de suivre Stéphanie dans son investigation, mais d’établir aussi les enjeux d’un article pareil s’il sortait dans L’Express. Claude, en particulier, se montre réticent à sa publication.
C’est là que se joue, par exemple, la relation avec son père : Stéphanie et Émile ne sont pas proches, et comme en plus il désapprouve son choix professionnel, on a le sentiment qu’il ne va pas lui faire de faveur. Claude, lui, est irrité : par le fait qu’il n’y ait personne pour être éditeur à la rédaction, et par le fait que le patron du journal non plus, vu qu’il ne lui a pas offert le job d’éditeur. C’est, qui plus est, un frileux, comme le démontrera un échange très tôt dans cet épisode initial, avec Lionel qui lui reproche la ligne éditoriale trop molle de L’Express (et les ventes en berne qui vont avec). Il craint les retombées potentielles pour le journal, en tout cas, et tente de freiner la publication des révélations par Stéphanie de ce qu’il considère être la vie privée du ministre, qui pourrait entacher à la fois sa carrière et sa vie familiale. Et puis dans tout ça, il y a le ministre lui-même, qui finit même par être reçu par Émile, tranquillement, pour parler entre hommes.
En moins d’une journée, ce qui devait être une véritable bombe à la une de L’Express est finalement passée sous le tapis. Stéphanie est furieuse, mais décide de redoubler d’efforts pour fournir à Claude toutes les garanties permettant la diffusion de l’information qu’elle a dénichée…
Scoop met en place les contradictions d’un monde où les intérêts se croisent mais aussi s’entrechoquent. Il y a des nuances intéressantes dés ce premier épisode, pourtant également chargé de scènes d’exposition, permettant d’aborder des nuances à la fois morales et juridiques pour L’Express dans cette affaire. Même Stéphanie aurait gros à perdre si ses sources n’étaient pas assez crédibles, ou si l’âge de « Carla » n’était pas formellement confirmé ; mais bon, ça elle s’en fout, elle. Par contre, Claude et Émile font preuve de plus de prudence. Mais eux, ils ne sont pas journalistes.
Malgré les archétypes mis en place dans ce premier épisode, Scoop se préserve même quelques surprises, par exemple pendant l’échange entre Émile et le ministre, dans lequel celui-ci confesse avoir effectivement couché avec une jeune prostituée (mais qu’il présente avec légèreté comme un « enfantillage« ). Le patron de L’Express aura en retour ces mots qui, en 30 ans, n’ont pas pris une ride :
« C’est quand ces bêtises-là te passent par la tête qu’il faut que tu penses à ta femme, à ta fille, à ta carrière. Mais pas après ».
Pour tous ses défauts, Émile n’en est pas au point d’offrir des passe-droits aux copains pédocriminels…
Alors, l’article sera-t-il publié ? Ce n’est pas encore garanti quand s’achève le premier épisode de Scoop : la série est profondément feuilletonnante…
On a déjà l’impression d’avoir été submergée dans le grand bain d’une série dense en seulement trois quarts d’heure. Alors qu’elle a tant à mettre en place, la série fait immédiatement le choix de ne pas reculer devant la complexité et la nuance. Elle le fait, en outre, avec une ambiance à la fois électrique (Stéphanie, en particulier, est d’une énergie à vous déboiter la mâchoire, et traverse ses scènes avec fougue et rage), et empruntant au polar des plus noirs. Il y a aussi, dans la réalisation, quelque chose qui m’a évoqué les meilleures séries de Bochco ; c’est sûrement en partie dû aux codes de l’époque, et à la musique, mais l’impression persiste même quand on essaie de la replacer dans son contexte.
Vous comprenez donc aisément pourquoi ça m’aurait peinée de ne pas dire quelques mots de Scoop en cette année (encore un peu) anniversaire !























 Quelque chose dont en revanche j’aurais pu parler plus tôt cette année, c’est Send Help, une dramédie lancée sur allblk cet été, avec devant et derrière la caméra des mecs d’Insecure. Alors permettez que j’ouvre une parenthèse pour parler un peu de son premier épisode, parce que je le trouve également très original. Mais pour une toute autre raison.
Quelque chose dont en revanche j’aurais pu parler plus tôt cette année, c’est Send Help, une dramédie lancée sur allblk cet été, avec devant et derrière la caméra des mecs d’Insecure. Alors permettez que j’ouvre une parenthèse pour parler un peu de son premier épisode, parce que je le trouve également très original. Mais pour une toute autre raison.
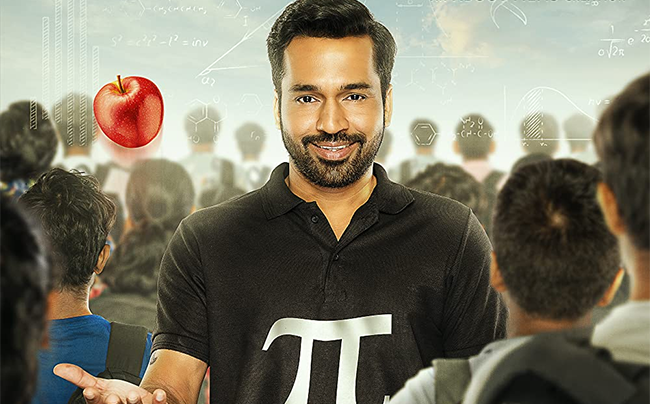

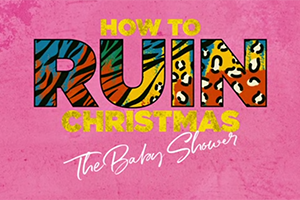 omme toujours, How to Ruin Christmas commence donc par nous faire crouler sous les informations, les bêtises, les cris et les problèmes. Et comme toujours, c’est dans sa résolution de tous ces conflits qu’elle brille.
omme toujours, How to Ruin Christmas commence donc par nous faire crouler sous les informations, les bêtises, les cris et les problèmes. Et comme toujours, c’est dans sa résolution de tous ces conflits qu’elle brille.
 En fait, ce premier épisode va assez peu montrer les Ewing, au final. C’est dans la maison voisine, celle des Fairgate, que se déroule l’essentiel de l’intrigue. Annie, la fille de 18 ans de Sid (issue d’un premier mariage), est venue passer quinze jours en Californie, mais elle ne s’entend pas avec sa belle-mère Karen, qui il faut le dire est la seule à tenter de lui poser des limites. Annie est en effet incontrôlable, sexuellement active (…y compris dans le lit de Sid et Karen), et aggressive à la moindre occasion ; le premier épisode de Knots Landing tourne un peu à l’afterschool special, nous donnant l’occasion de comprendre que ce comportement est en fait la manifestation d’une crise intérieure, et incitant Annie à rester à Knots Landing pour la résoudre. De façon plus secondaire, deux autres foyers nous sont également présentés : les Avery et les Ward. Leur apparition est pour le moment totalement secondaire dans le cas des Avery (Richard Avery agissant comme une sorte de comic relief) ou accessoire à l’intrigue d’Annie dans le cas des Ward (la jeune fille a apparemment couché avec Kenny quelques jours plus tôt et Ginger n’en a aucune idée… pour le moment ?).
En fait, ce premier épisode va assez peu montrer les Ewing, au final. C’est dans la maison voisine, celle des Fairgate, que se déroule l’essentiel de l’intrigue. Annie, la fille de 18 ans de Sid (issue d’un premier mariage), est venue passer quinze jours en Californie, mais elle ne s’entend pas avec sa belle-mère Karen, qui il faut le dire est la seule à tenter de lui poser des limites. Annie est en effet incontrôlable, sexuellement active (…y compris dans le lit de Sid et Karen), et aggressive à la moindre occasion ; le premier épisode de Knots Landing tourne un peu à l’afterschool special, nous donnant l’occasion de comprendre que ce comportement est en fait la manifestation d’une crise intérieure, et incitant Annie à rester à Knots Landing pour la résoudre. De façon plus secondaire, deux autres foyers nous sont également présentés : les Avery et les Ward. Leur apparition est pour le moment totalement secondaire dans le cas des Avery (Richard Avery agissant comme une sorte de comic relief) ou accessoire à l’intrigue d’Annie dans le cas des Ward (la jeune fille a apparemment couché avec Kenny quelques jours plus tôt et Ginger n’en a aucune idée… pour le moment ?).











