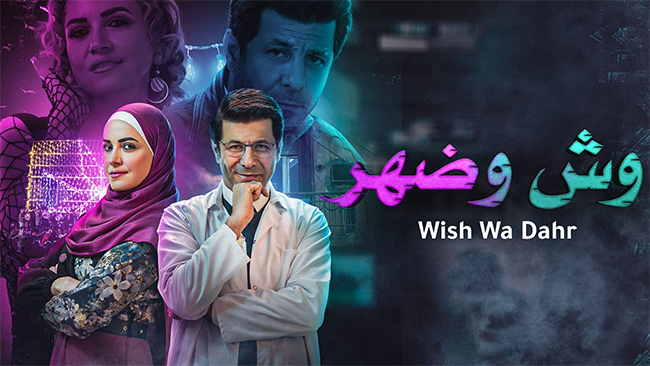La review du jour est une histoire de déception. Pour ma défense, cette déception découle d’une tromperie : la série dont il s’agit ici m’avait été vendue, tour-à-tour, comme un drama, comme une série d’action, comme un thriller, comme un legal drama…
…Et en fait c’est une série policière.
Comme vous le savez, j’évite désormais de parler de séries policières dans leur grande majorité, mais je tenais à faire une exception pour celle-ci, car il s’avère aussi que Jibril est une série malaisienne, et que ce n’est pas tous les jours que je tombe sur une série policière malaisienne. Mais le ton est donné.

La série suit le capitaine Jonathan Tuah Merawi ou juste John, un officier de la Pasukan Khas Teknologi Polis (ou PASTEK…), un service de police nouvellement créé pour enquêter sur les crimes en lien avec les nouvelles technologies. Avec à sa tête l’inspectrice Kim (mais qui se fait appeler « Aunty » par ses subordonnées), ce n’est pas une organisation très large, mais qui s’avère particulièrement importante à deux mois de la MINND (la « Machine Intelligence Neutral Network Design conference« ), un événement de portée internationale qui doit se tenir en Malaisie, donnant devrait donner le signal de l’entrée du pays dans une nouvelle ère technologique. Au début de ce premier épisode, la PASTEK vient par exemple de saisir de nombreux drones illégalement entrés dans le pays. Dans la review qui suit, chaque vous que vous verrez le mot PASTEK, vous pouvez sans vous tromper imaginer que je suis en train de pouffer comme une gamine derrière mon clavier ; apparemment c’est un hasard total, et le mot « pastèque » ne se dit même pas comme ça en malais.
L’intrigue démarre lorsque le président de LAKUNA, une compagnie spécialisée dans l’intelligence artificielle, l’homme d’affaires Nasir Fattah, est assassiné dans son bureau. Trois balles ont été tirées : deux en guise d’avertissement, à côté de lui, et une troisième en plein front. Sur place, force est de constater pourtant que le bureau n’a pas de vis-à-vis direct, et que le bâtiment le plus proche, est situé à un kilomètre de là, et à un angle rendant le tir impossible. La PASTEK soupçonne immédiatement l’usage d’un drone.
Mais, l’affaire étant sensible, le capitaine John demande l’autorisation de faire appelle à un consultant, l’avocat Jibril Azym.
La série nous le présente (et c’est là que c’est traitre) dans un prétoire, où il a été engagé sur une affaire de contrefaçon. Il défend un homme accusé par un fabricant de parfums d’avoir tenté de vendre un produit rigoureusement identique au sien ; Jibril s’apprête à poser des questions à une témoin, la chimiste Mme Yap, ancienne employée du fabricant de parfums. Sauf que les questions sont en fait en train de faire apparaître quelque chose qu’il semble avoir compris il y a un moment, mais qu’il révèle par paliers à la cour : l’accusation et la défense travaillent ensemble à créer un procès bidon qui serve d’excuse à soutirer à Mme Yap un échantillon d’un parfum qu’elle a créé, maintenant qu’elle travaille à son propre compte. L’espionnage industriel n’est pas là où on le croit ! L’affaire semble tirée par les cheveux (un faux procès juste pour voler un récipient ?!), mais le juge ne peut qu’admettre que tout concorde, et va dans le sens de Jibril. J’en conclus qu’en Malaisie, il n’y a pas de problème déontologique à se retourner contre son client.
Bref, c’est très impressionnant (quand bien même ça sent un peu le deus ex machina, mais pour une scène d’introduction, on pardonnera), et donne le ton : Jibril Azym est un homme observateur, intelligent, et capable de comprendre le pire des coups tordus. Dont acte.
Sauf que la scène est trompeuse, puisque c’est la première et dernière fois de l’épisode que Jibril va faire le travail d’un avocat. Pendant tout le reste de cet épisode introductif de Jibril, le personnage éponyme va servir de consultant à la PASTEK, comme on a vu des tonnes de consultants avant lui. Avec son air hautain, son assurance méprisante, et sa manie de ne pas expliquer son processus de pensée (on n’en aura un échantillon que dans les toutes dernières minutes de l’épisode), Jibril n’est pas exactement le genre de type qu’on a envie de suivre dans une enquête, et moins encore une enquête feuilletonnante. Car il faut noter que Jibril n’est pas un procedural drama : à la fin de l’épisode, on est loin d’avoir résolu l’affaire. En tout cas, nous on ne l’a pas résolue… mais Jibril a l’air convaincu qu’aucun drone n’a été utilisé ici, sans nous dire pourquoi, ou comment une balle aurait pu exécuter une trajectoire courbe de plus d’un kilomètre. Comme ça se trouve, pour lui, l’enquête est finie, il est juste là pour encaisser sa commission (après tout il a fourni au capitaine John une liste de ses tarifs dés le premier jour).
Comparée à beaucoup de séries malaisiennes (mais pas toutes, il faut le noter), Jibril a une jolie cinématographie ; un effort a vraisemblablement été fait du côté de la réalisation sur un plan visuel… mais sur d’autres plans, c’est plus inégal. Les dialogues ne sont pas géniaux, et sont qui plus est alourdis par un gros problème de rythme, avec plein de blancs qui ne sont pas des silences dramatiques, mais juste de silences que le montage aurait aisément pu résoudre. La quasi-absence de musique (hors quelques passages-clés) ne fait qu’en renforcer la lourdeur. Le cast est globalement plutôt bon, mais pas toujours bien dirigé, et dans certaines scènes c’est, là encore, un peu gênant.
Une série comme Jibril est une réponse implicite intéressante à une question qui s’est longtemps posée dans plusieurs pays, notamment d’Asie du Sud-Est, dont l’industrie télévisuelle n’est pas financièrement riche. La qualité de ces séries, pensait-on, serait améliorée d’un coup d’un seul avec de l’argent ! Sauf qu’avec Jibril, on voit bien que c’est plus compliqué. Pour commencer, la qualité, c’est relatif : si on veut appliquer les critères d’une série étasunienne par exemple, oui, effectivement, la comparaison ne sera pas à son avantage. Mais dans le fond, peut-être que les spectatrices malaisiennes, elles aiment ça, les silences, ou qu’à tout le moins, pour elles, ce n’est pas un inconvénient. Plus largement, on ne peut pas simplement investir dans la fiction d’un pays, comme le fait la plateforme Viu ici (Jibril faisait partie, avec The Bridge et Salon, de sa première commande de séries originales malaisiennes), et penser que ça change tout. Il y a le savoir-faire des professionnelles de cette industrie, la culture télévisuelle locale, et toutes sortes de paramètres qui continuent d’entrer en compte.
Enfin bon, il n’empêche que contrairement à ce qu’on m’aura laissé croire, Jibril n’est ni un drama, ni une série d’action, ni un thriller, ni un legal drama… Et si comme moi, vous êtes déçue, je vous ai glissé trois reviews de véritables legal dramas pour compenser.
Lire la suite »