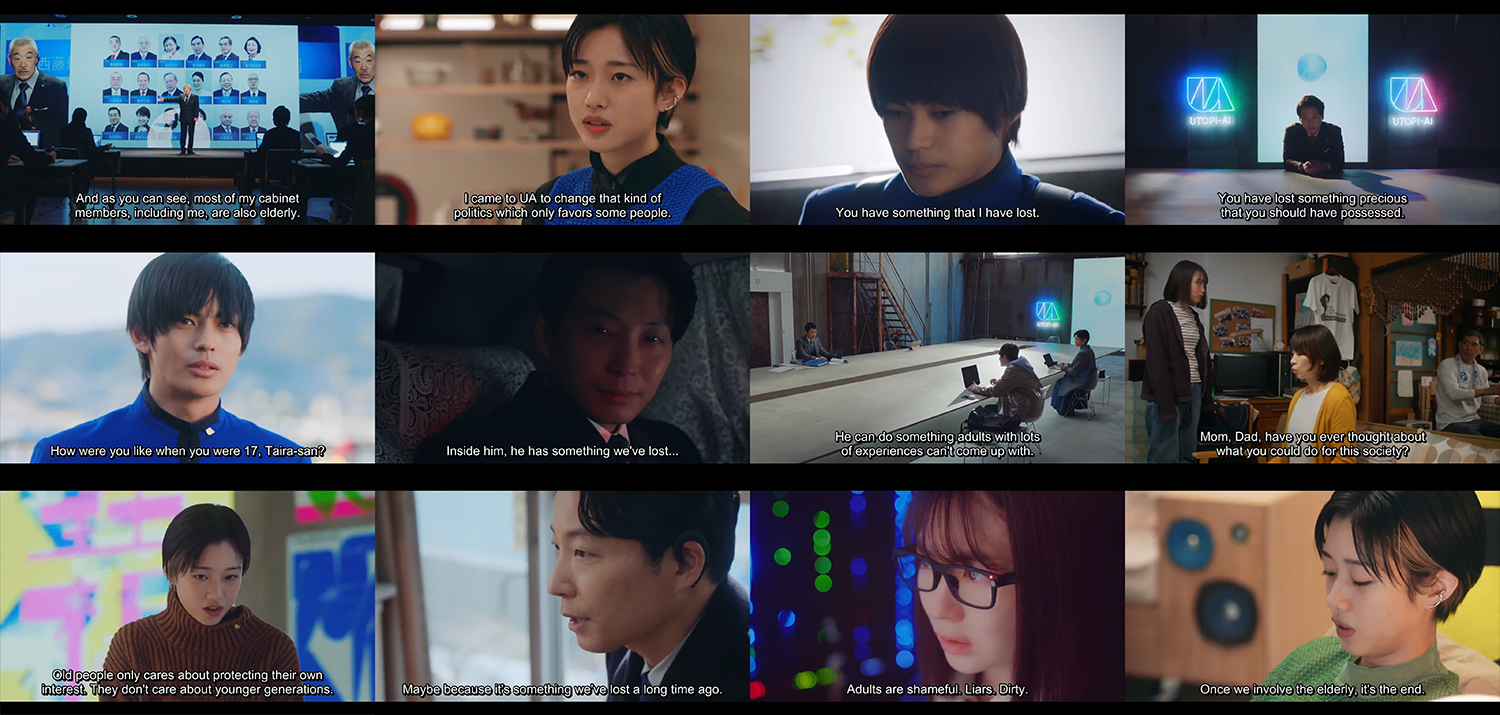L’ambition et la rancœur forment un cocktail explosif. Aslı Tuna croise un jour, dans les couloirs de son université, la célèbre journaliste Lale Kıran qui était venue parler à sa classe de journalisme. C’est un rêve qui se réalise, tant la jeune femme encense l’ex-reporter, aujourd’hui reconvertie dans la présentation d’Öteki Taraf, la quotidienne d’information la plus regardée du pays. Lorsqu’elle tente de l’approcher, cependant, afin de lui témoigner son admiration, Aslı se fait renvoyer gentiment dans les cordes : Lale lui réplique vertement que ses priorités sont faussées, et qu’au lieu de se prendre de passion pour une célébrité du journalisme, Aslı devrait être plus passionnée par le journalisme lui-même. Ce n’est pas nécessairement faux, mais il n’empêche : cette remarque, dispensée entre deux portes sans même y penser, blesse l’étudiante dans son orgueil… une erreur fatale.
La dernière série turque en date de Netflix, Kuş Uçuşu (ou As the Crow Flies de son titre international), nous invite dans le monde de l’information. Ou plutôt l’emploie pour y installer un thriller reposant sur les cercles du pouvoir et l’ambition dévorante. A raison de seulement huit épisodes d’une quarantaine de minutes (soit un peu plus de 5 heures et demies utiles), la série doit agir vite : dans son pays natal et sur le primetime traditionnel, c’est à peu près la durée de deux à trois épisodes…

Kuş Uçuşu s’inscrit dans la longue tradition des fictions dans lesquelles la fascination et la jalousie d’une femme se combinent pour la pousser à en évincer une autre. C’est une histoire aussi vieille que Showgirls, et la série emploie des ressorts similaires pour indiquer qu’Aslı veut devenir calife à la place du calife.
Une grande partie de la saison est dédiée à la suivre elle, à scruter le moindre de ses gestes, étudier le moindre de ses stratagèmes, et adopter son point de vue. Kuş Uçuşu n’arrive pas toujours à se décider quant à la façon de la présenter. Est-elle une anti-héroïne qui va, par son génie (certes machiavélique), se hisser au sommet grâce à ses ruses, alors qu’elle est partie de rien et que l’univers entier est contre elle ? Ou est-elle une antagoniste ? Car malgré la prédominance de sa perspective dans la série, Kuş Uçuşu persiste à aussi nous présenter Lale, cette journaliste reconnue, comme une femme parfaite, une oie blanche qui ne peut rien faire de mal et à laquelle, donc, on ne souhaite aucun mal non plus. Certes elle est toute puissante, mais épisode après épisode, elle prouve qu’elle mérite le respect à la fois de la profession et du public, et qu’elle dispose d’une intelligence fine qui justifie parfaitement la place qu’elle occupe dans le monde de l’information. Normalement, quand une série veut se débarrasser de quelqu’un de puissant, elle en montre au contraire les aspérités, les imperfections, la déchéance, si ce n’est la corruption. Rien de tout ça ici.
L’effet qui en résulte est qu’on ne sait pas trop sur quel pied danser. Le ton de la série semble ne jamais trouver qui devrait avoir notre attention, et moins encore notre empathie. La voix-off (masculine, donc ne représentant les pensées d’aucune des deux femmes) est quant à elle dédiée à essayer de brouiller encore le message envoyé, en filant une métaphore dans laquelle Aslı est un petit oiseau sous-estimé, et Lale une puissante lionne. Dans cette fable, selon le narrateur, se jouent des forces intemporelles, un jeu entre une proie et sa prédatrice ; mais cette logique se heurte à un autre problème.
C’est que, dans sa volonté de nous dépeindre Aslı comme une menace tangible pour Lale, Kuş Uçuşu recourt plusieurs fois à des deus ex machina pour s’assurer que ses plans fonctionnent. Et en particulier, par quelque miracle, cette jeune femme qui n’a absolument aucune forme de subtilité n’est absolument jamais soupçonnée de manipuler les gens ou de leur mentir. Pendant les premiers épisodes, elle rejoint Mon5, la chaîne qui diffuse Öteki Taraf, comme l’une des nombreuses stagiaires en lice pour un poste définitif à la rédaction ; elle va ensuite, une par une, évincer les autres stagiaires par diverses manœuvres. La seule fois où elle va être repérée, sa proie du moment elle-même lui promettra de ne rien dire à personne, l’encourageant au contraire à continuer son petit jeu. Pourquoi ? On ne sait pas. A part que, si Aslı était découverte, il n’y aurait plus de série (ou plus pour longtemps).
Il y aurait pourtant matière à explorer la façon dont la jeune femme est naïve, et convaincue, comme tant d’autres à son âge mais à un degré moins sociopathique, d’avoir les réponses qui échappent à ses aînées. Mais le scénario protège Aslı de l’échec, ce qui ne la force pas à être plus futée d’ailleurs.
Entre des mains plus subtiles, Kuş Uçuşu aurait pu être un glaçant jeu de pouvoir, l’une de ces séries grisantes dans lesquelles on est ravie de suivre les chemins tortueux de l’esprit de la protagoniste présentée comme « méchante », parce que son intelligence compense l’absence de droiture morale. Ici il est régulièrement évident qu’Aslı ne doit son succès dans ses divers coups bas qu’à la volonté de la créatrice et scénariste Meriç Acemi.
Là, comme ça, j’ai bien conscience d’avoir l’air très négative. C’est parce que (bêtement) j’attendais un thriller de ce thriller. Ce que j’ai découvert en le regardant, c’est que ce n’était pas la bonne chose à en attendre : Kuş Uçuşu est bien plus confortable, en réalité, avec l’idée d’être un mélodrame. Empruntant volontiers aux codes du primetime soap (visuellement, narrativement, et même en matière de musique), la série a en fait très envie de raconter une toute autre chose : les émois de Lale, qui, lentement, sent un piège se resserrer autour d’elle. Pas forcément celui qu’on pense, cependant ; Aslı n’est pas la pire menace qui la guette…
Ainsi la série passe-t-elle énormément de temps à nous dire combien Lale souffre. Elle souffre du stress de son quotidien, d’abord et avant tout. Elle est l’épouse d’un homme aimant, Selim, mais avec lequel la distance va croissant. Selim est un restaurateur qui n’hésite pas à sacrifier son propre travail pour passer du temps avec leurs deux filles quand Lale, qui travaille de longues heures, n’est pas disponible ; l’arrangement semblait convenir à tout le monde, mais avec les années il semblerait que cela ne fasse qu’élargir le fossé entre sa vie de couple/famille et le reste de son existence. En outre, à part Selim, absolument tout le monde dans l’entourage de Lale vient du monde de l’information, ce qui ne fait qu’isoler son mari par rapport au reste de sa vie.
Il y a autre chose : à la rédaction d’Öteki Taraf, Lale est entourée de vieilles connaissances. Sa patronne est Gül, la fille du président de la chaîne, et elles se connaissent depuis des années, quand elle a signé son contrat avec Mon5, la première chance de sa carrière au sortir de l’école de journalisme. A l’époque, Lale faisait partie d’un trio avec sa meilleure amie Müge et son petit-ami Kenan ; elles ont décroché le contrat pour Öteki Taraf ensemble mais… pas sans changements. Lale et Kenan ont rompu, et Müge, qui devait être co-présentatrice, a été jugée par la direction de Mon5 comme inutile à l’écran, et a été rétrogradée à un poste de directrice de la rédaction. Le trio, même éclaté, a continué de faire tourner la boutique, mais les sentiments d’antan n’ont jamais disparu. Quand commence la série, malgré les années, Kenan est toujours épris de Lale ; quant à Müge, elle est en pleine spirale auto-destructrice, jalouse de son amie sans pouvoir jamais le lui dire.
Dans tout cela, Lale fatigue. Sa vie est de plus en plus source de frustration. Elle est également sous pression, parce que l’heure est venue de renégocier son contrat avec la chaîne, et qu’elle a encore moins de temps et d’énergie disponible pour déterminer ses priorités.
Kuş Uçuşu adooooore ces tourments. A plusieurs reprises, elle va les intégrer aux plans d’Aslı, mais pour l’essentiel la série préfère les utiliser pour des intrigues dramatiques dans lesquelles le triangle amoureux entre Lale, Selim et Kenan provoque des tiraillements émotionnels. On passe, en définitive, beaucoup plus de temps là-dessus que sur quoi que ce soit d’autre.
Alors du coup, vous savez où vous vous situez !
Si vous aimez les primetime soaps mais n’avez pas des dizaines d’heures à consacrer à ce genre d’intrigue, honnêtement je ne peux que recommander Kuş Uçuşu : en matière de mélodrame, on n’a jamais eu à apprendre aux séries turques à faire leur métier ; et effectivement les manipulations d’Aslı sont divertissantes sur le moment.
En revanche si, comme moi, vous étiez là pour l’arrivisme, les coups bas, et éventuellement une critique du journalisme moderne, bon, là clairement, il vous faudra passer votre chemin. Cela ne signifie pas que Kuş Uçuşu n’aborde aucun de ces thèmes (elle esquisse d’ailleurs une embryon de discussion autour du rôle des réseaux sociaux dans la perception et la diffusion de l’information), mais ce n’est absolument pas sa priorité.