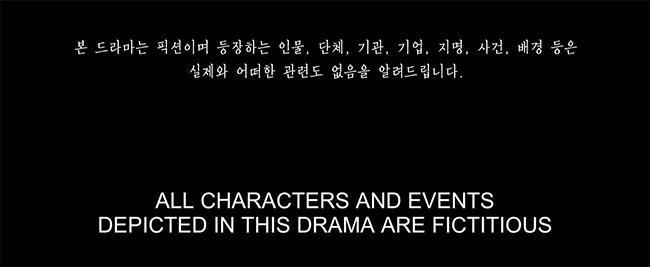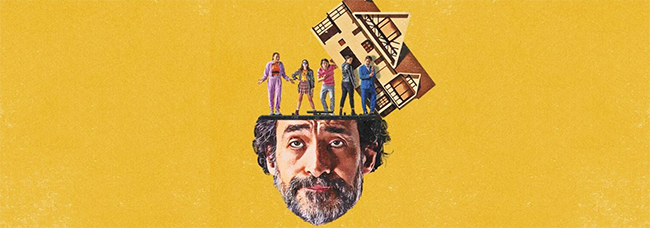Parfois on approche une série, on lit son résumé, on voit son matériel promotionnel… et on a l’impression qu’on sait déjà à quoi elle va ressembler. Avant même d’avoir cliqué sur le plus petit icône de lecture, on pense l’avoir cernée. Comme si on pouvait faire l’expérience d’une série sans la regarder.
A mon niveau (celui de quelqu’un qui regarde plusieurs centaines de pilotes par an), cette sensation de pouvoir prévoir ce que je vais regarder, c’est une habitude que j’essaie de combattre. En refusant de regarder des trailers, de lire les résumés, et même de lire des reviews, j’essaie de me forcer à me faire moi-même une opinion d’une série sans laisser quoi que ce soit parasiter mon ressenti. Mais c’est facile pour moi : je n’ai à peu près que ça à faire de ma vie. Tout le monde n’a pas le luxe d’avoir du temps pour tester un premier épisode avant de se faire une opinion. Parfois, pour faire des choix (et vu le nombre de séries qui existent, il faut faire des choix), être expéditive est nécessaire.
Avant que vous ne fassiez l’impasse sur Até que a vida nos separe, une série portugaise ajoutée sous le titre international Until Life Do Us Part au copieux catalogue de Netflix (la première série portugaise, en fait !), laissez-moi vous dire pourquoi elle est bien plus intéressante qu’elle ne pourrait le sembler au premier abord.

Tout commence avec une demande en mariage tout ce qu’il y a de plus romantique, dans un charmant petit restaurant, entre un beau jeune homme et une belle jeune femme. Sauf que celle-ci rejette la demande. Dans la scène suivante, elle profite de sa liberté en conduisant au crépuscule, et passe la nuit sur une plage. Au petit matin, elle est réveillée par de bruyants voisins qui se sont installés dans une tente juste à côté de la sienne. Mais les deux hommes qui sont arrivés dans la nuit sont tellement séduisants qu’au lieu de protester, elle esquisse un sourire excité, et reste avec eux.
Le démarrage du premier épisode d’Até que a vida nos separe est trompeur : la rencontre entre Catarina, Guilherme et Bruno n’est absolument pas l’objet de la série. A partir de cette scène, les trois jeunes gens vont au contraire apparaître, fugacement, dans l’arrière-plan d’une autre intrigue.
En réalité, Até que a vida nos separe s’intéresse donc à d’autres protagonistes, très différentes.
Vanessa découvre qu’elle vient de commencer sa ménopause ; une visite chez son amie de toujours, une gynécologue, le lui confirme. La nouvelle lui tombe un peu dessus comme une tonne de briques, quand bien même il lui est impossible de nier que divers effets secondaires, comme les bouffées de chaleur dont elle souffre, sont bel et bien omniprésents dans sa vie. Mais bon, ça veut dire qu’il va y en avoir de plus en plus, comme la disparition de sa libido. Elle vieillit… c’est un changement que son corps lui impose et auquel il va falloir s’adapter, et on peut comprendre qu’il lui faille un moment pour accuser le coup. Et puis, ce n’est pas comme si sa vie était parfaite en-dehors de ça. Elle gère une société d’organisation de mariages qui ne fonctionne qu’à peu près. Elle pense aussi à ce qui est et à ce qui aurait pu être, d’autant que le mariage qu’elle prépare concerne le fils d’un ex, Vasco, un homme très riche. Heureusement, il y a au moins une chose à laquelle elle peut se fier, c’est l’excellente relation qu’elle entretient avec sa fille Rita, qui bosse sur l’organisation de mariages avec elle.
De son côté, Daniel aussi prend de l’âge, mais pour lui les signes sont différents. Il le sent au fait que la vie de bohème qu’il a longtemps menée, en tant que photographe, touche ses limites. Sa maison, il la loue à ses riches parents, qui n’hésitent pas à augmenter son loyer ; ce genre de choses était éventuellement tenable dans sa jeunesse, mais dans la cinquantaine, ce n’est plus mignon du tout. La clope au bec, des fringues froissées et une casquette vissée sur le crâne à la fois par habitude et à la fois parce qu’il se dégarnit lentement, Daniel est frustré de n’être embauché que sur des événements mondains sans intérêt (et encore, uniquement parce que son vieux pote Vasco lui file des boulots), plutôt que de pouvoir vivre de la photographie d’art. Au moins, il a une bonne relation avec son fils Marcos, un étudiant en master de sociologie.
Até que a vida nos separe (« jusqu’à ce que la vie nous sépare », qui d’ailleurs est aussi le titre de la série maintenant qu’elle est sur Netflix en France) découpe son épisode en trois chapitres, dont on ne perçoit pas nécessairement comment ils sont connectés narrativement. Mais thématiquement, c’est assez net : la série philosophe sur le temps qui passe, et avec lui, la façon dont les relations évoluent.
A quoi ressemble l’amour, du point de vue de ces cinquantenaires ? Elles sont un peu blasées, aujourd’hui ; bien loin de l’enthousiasme des jeunes futures mariées qui se présentent dans les locaux de Vanessa, le cœur battant, l’âme débordant d’idéaux, pleines d’optimisme. Au fil de l’épisode, la série pousse ces héroïnes à s’interroger, mais aussi à interroger les autres ou simplement à capter des bribes de conversations entre inconnues, sur ce qu’est l’âge, ce qu’est la famille, ce qu’est l’amour, ce qu’est le mariage, ce qu’est le divorce. Ce qu’est la vie.
Sur beaucoup de ces choses, Até que a vida nos separe est un peu blasée. Mais pas totalement. Pas fondamentalement. D’ailleurs, l’air de rien, l’épisode est truffé de petites scènes dans lesquelles les parents de Vanessa, qui à leur grand âge s’aiment comme au premier jour, sont la preuve que tout n’est pas foutu. Peut-être tout simplement qu’il n’y a pas de solution miracle. C’est à chacune de trouver la réponse à toutes ces interrogations, peu importe ce à quoi elle ressemble.
Ces dernières années, j’ai eu l’occasion plusieurs fois d’attirer votre attention sur le lissage de la fiction internationale. Un lissage qui peut être simple à identifier, par exemple lorsqu’il concerne les formats (avec le recours au « standard » du format d’environ une heure pour les séries dramatiques, notamment, même pour les pays dont ce n’est historiquement pas dans la culture télévisuelle). Et aussi, parfois, un lissage plus subtil, presqu’indécelable sur les genres, les tons, les formes.
Ce lissage est dû en grande partie au fait que pendant longtemps, une série était produite à un endroit (ou éventuellement co-produite entre deux ou trois pays), puis exportée ailleurs. En intention première, on avait donc le public local de cet endroit à cœur, et le reste venait en seconde intention, quand la série était exportée. Si la série était exportée… Aujourd’hui, de plus en plus, les diffuseurs sont internationaux. Quand une plateforme est présente dans 190 pays (sur une planète qui n’en compte officiellement que 195), elle n’a plus de public local. Elle a des niches d’audience à séduire (et des quotas à remplir, souvent imposés à la force du bras par certains territoires), certaines étant linguistiques ou régionales, mais l’enjeu est différent. Or de plus en plus de diffuseurs suivent ce modèle, ou tentent de le suivre en étendant leur implantation à toujours plus de pays. Et ces diffuseurs (qu’on parle de plateforme de streaming ou simplement de chaînes linéaires ouvrant des filiales), ils emploient des flying producers qui traversent la planète plusieurs fois par an pour s’assurer que certains « standards » sont appliqués, quel que soit le pays de production d’une série donnée.
Cela ne signifie pas que tout se ressemble, loin de là. Toutefois, à certains égards, et comme je le disais, parfois de façon invisible, on y tend.
En tant que spectatrices, qu’est-ce que ça signifie pour nous ? Eh bien par exemple qu’il devient assez rare qu’une série soit un peu difficile d’accès. Pas pour voir les épisodes, mais pour les comprendre. Il devient rare, chez ces diffuseurs, qu’on suive des narrations sortant de l’ordinaire, qu’on adopte un style moins mainstream, qu’on cultive, même, une forme d’opacité, qui fait qu’une série peut déplaire parce que sembler trop incongrue. Il devient rare qu’on laisse une série avoir l’air être brouillonne ou expérimentale ; un flying producer s’assure au besoin que tout le monde saisit exactement ce qu’est et fait une série, universellement.
Vous savez où l’on trouve ce genre d’expérimentations, le plus souvent ? Chez les chaînes dont les ambitions ne sont pas internationales ! A l’origine, Até que a vida nos separe est une série de la chaîne publique portugaise RTP1, diffusée au printemps dernier ; Netflix n’en a fait l’acquisition qu’après-coup, mais n’a rien à voir avec sa production, comme pour beaucoup de séries nichées dans sa base de données. Eh bien ça se sent, et sans vouloir prétendre que toutes les séries des diffuseurs internationaux sont parfaitement formatées aujourd’hui (comme le prouvait encore récemment Foodie Love, à laquelle j’ai beaucoup pensé devant Até que a vida nos separe, il s’y produit encore des choses intéressantes), je ne suis pas surprise que ce soit à une chaîne comme celle-là qu’on doive une série un peu plus surprenante que la moyenne. C’est juste hautement ironique que désormais, ce qui ressemble le plus à une série indépendante soit une production d’une chaîne publique nationale, quoi.
Sur le papier, je n’étais pas enthousiasmée par Até que a vida nos separe, je le confesse. Mais heureusement, j’ai pris le temps de voir par elle-même que ce qu’elle met en place, et même la façon dont elle le met en place, est unique. J’ai plein d’autres choses à reviewer, et plus encore à regarder entre deux reviews, mais après avoir fini ce premier épisode, je n’ai qu’une pensée : voir les suivants. En partie parce que j’ai hâte de voir la façon dont Até que a vida nos separe a prévu de me prouver que, même maintenant, je suis loin de l’avoir totalement cernée.
Lire la suite »