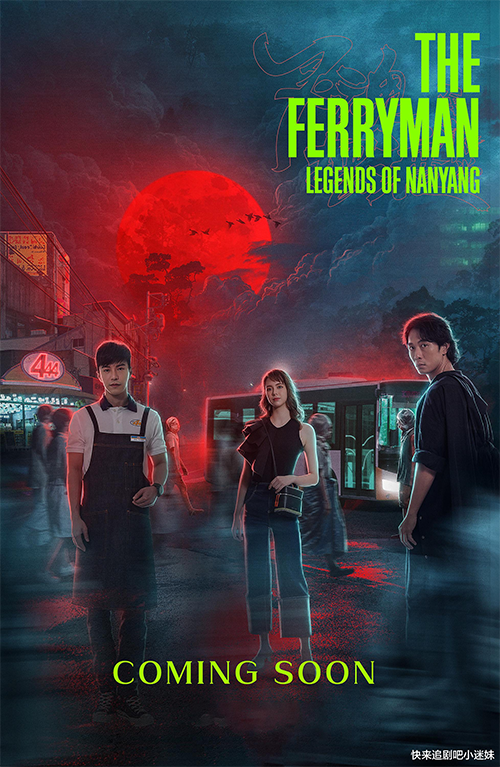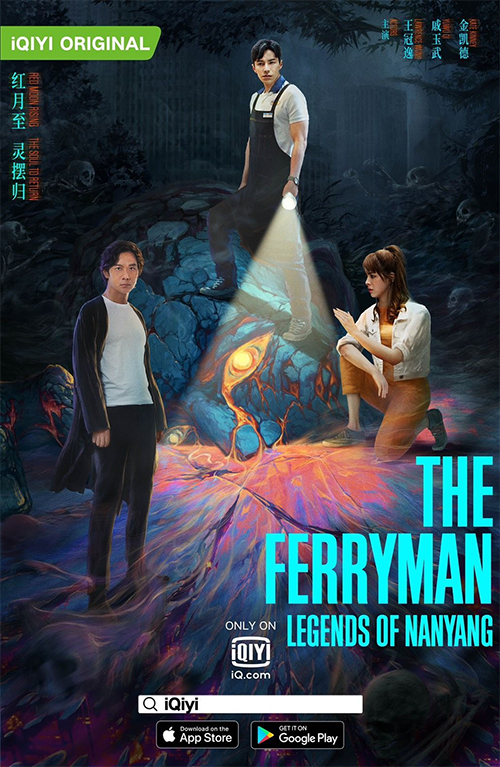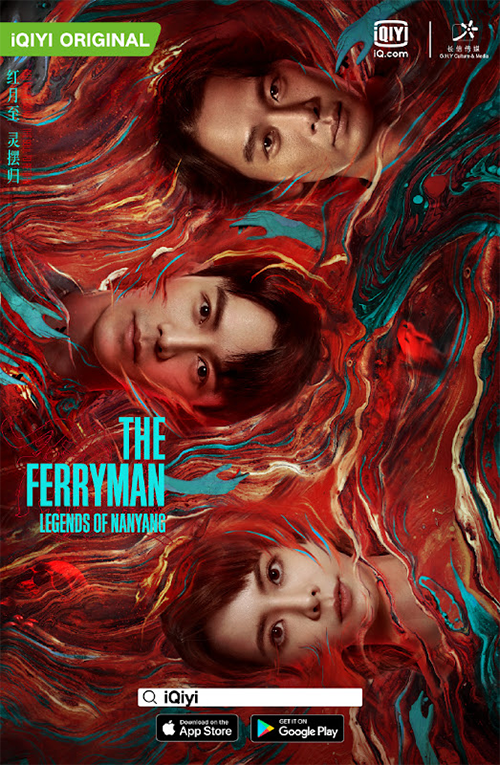En préparation du lancement de la comédie américaine Ghosts, je me suis lancée plus tôt cette année dans un visionnage de la version britannique qui en est à l’origine, et qui à ce jour compte 3 saisons. Au départ, l’idée était simplement de regarder le premier épisode et de s’arrêter là ; mais étant donné que je ne regarde pas beaucoup de comédies depuis quelques temps, finalement il est apparu je n’avais rien à perdre à me lancer dans une intégrale.
Même si aujourd’hui, on va effectivement se lancer dans une rétrospective de ces trois saisons de Ghosts, et même toucher quelques mots du pilote de l’adaptation américaine, il me faut cependant vous prévenir : je suis loin d’être fan. En fait, l’une des raisons pour lesquelles j’ai poursuivi mon visionnage aussi loin est que… j’attendais désespérément que quelque chose m’accroche. Eh oui, même à moi il arrive d’être patiente. Ou masochiste, selon le point de vue.

Après cette introduction sans nul doute alléchante, commençons par établir de quoi parle Ghosts, la comédie britannique de 2019 : un couple, Alison et Mike, essaie de se loger, mais vu la gueule du marché de l’immobilier, leur budget ne leur permet rien de très excitant. Alors qu’elles s’apprêtent à baisser les bras, Alison apprend le décès d’une grande tante dont elle ignorait l’existence. Miraculeusement, celle-ci laisse comme héritage un manoir ! Il y a, évidemment, des clauses en petits caractères dans cette révélation : la demeure est dans un état terrible, pour commencer. Alison et Mike, qui comme on l’a établi ne roulent pas sur l’or, vont devoir essayer de rénover l’endroit avec les moyens du bord. Ah, et aussi, le manoir est fabuleusement hanté, comme tout bon manoir centenaire qui se respecte.
Mais les ennuis ne commencent vraiment que lorsque, après une chute, Alison commence à être en mesure de voir et entendre les fantômes qui occupent la résidence.
Le premier constat qu’il me faut faire à propos de Ghosts, c’est que… au-delà de son synopsis, la première saison n’a pas grand’chose à offrir. Sans donner tout-à-fait dans le formulaic, la série n’essaie pas vraiment d’introduire de fil rouge, ni sur un arc ni sur une saison (et du coup encore moins sur la série). Je ne m’attendais pas, vu le sujet ou le format, à une série dotée d’une mythologie ultra-complexe ; mais j’espérais au moins que la série essaie de raconter autre chose, semaine après semaine, que « les fantômes sont impossibles à vivre, Alison et Mike galèrent avec la maison, voyons comment ce petit monde va quand même cohabiter ». En soi, cet enjeu n’est pas mauvais, c’est juste qu’il est parfois insuffisant pour s’impliquer durablement dans la série, parce qu’il est quand même répétitif. Comme en plus Mike accepte très vite qu’il y a des fantômes que sa femme peut voir mais pas lui, on élimine beaucoup de situations potentielles qui auraient pu prendre le temps d’être développé ; ç’aurait été une problématique cliché, je vous l’accorde, mais au moins cela nous aurait fourni des situations à résoudre. Là, il n’y a rien de tel. D’épisode en épisode, les mêmes problèmes trouvent les mêmes solutions… ou n’en trouvent pas, de façon à se poser à l’identique la semaine suivante. Personnellement, ça m’a laissée sur ma faim…
« Bah alors », vous apprêtez-vous à objecter (ne niez pas, je vous connais), « peut-être que la série est tout simplement une comédie sur la vie ensemble ». Oui et non, car cela ne prend vraiment forme qu’à partir de la deuxième saison.
A ma grande surprise, Ghosts joue très peu la carte de l’attachement dans un premier temps. Cela ne veut pas dire qu’Alison reste insensible au charme de celles qui hantent les couloirs de son habitation, c’est juste que les épisodes font rarement usage du lien qui se tisse. Même ça, ce n’est pas un fil rouge avant, je dirais, la fin de la saison 2. La plupart du temps, c’est même profondément contradictoire avec l’intrigue des épisodes, qui tournent presque tous autour du fait que les fantômes rendent la vie impossible au couple vivant.
Par exemple en fin de saison 1, Alison et Mike se voient offrir une opportunité unique : au lieu de bosser à la réfection du manoir (en plus de leur boulot à temps plein), ce qui étant donné leurs finances pourrait prendre des années, une chaîne hôtelière leur propose de racheter la propriété. L’offre semble alléchante, sauf qu’évidemment, les fantômes n’ont aucune envie d’être dérangés par des hordes d’employées et de clientes, et essaient donc de mettre fin aux négociations de vente. Sur la fin de l’épisode, Alison reconnaît que ça lui fait de la peine de les laisser derrière, mais qu’elle et Mike n’ont pas trop le choix… mais c’est tout. Pourquoi ça lui fait de la peine ? La série ne le dit pas vraiment, vu qu’Alison se plaint tellement des fantômes le reste du temps. Ils n’ont pas que des mauvais côtés, mais ils montrent quand même rarement les autres !
Lorsque, à partir de certains épisodes de la saison 2, Alison semble s’attacher aux fantômes, cela reste assez peu expliqué. Qu’ont-ils de si appréciable ? C’est du cas-par-cas, d’autant qu’Alison a des relations avec certains plus qu’avec d’autres. Par exemple Thomas, le poète maudit, est fou amoureux d’elle, et passe son temps à le lui faire savoir… ce qui la pousse à le recadrer régulièrement. Ou bien Kitty, la jeune femme noble pleine de naïveté et de bonne humeur, a décidé qu’Alison était sa meilleure amie, et celle-ci doit donc régulièrement lui accorder de l’attention, parfois à son corps défendant. A contrario, Alison n’a quasiment aucune interaction avec quelqu’un comme Fanny, une vieille femme grincheuse et psychorigide, ou Sir Humphrey, un noble décapité dont l’essentiel des activités quotidiennes consiste à tenter de réunir son corps et sa tête, généralement sans que quiconque lui prête de l’attention et encore moins de l’aide.
Cela limite encore plus les effets de l’affection supposément ressentie que de voir qu’en réalité, elle ne s’applique qu’à une partie de la population fantôme du manoir.
 Pourtant tout au sujet de Ghosts tend à indiquer que la série repose plus sur l’affectif que sur l’humour à proprement parler. Cela rend d’autant plus rageantes ses hésitations à explorer ses personnages pour nous donner envie de les prendre en affection !
Pourtant tout au sujet de Ghosts tend à indiquer que la série repose plus sur l’affectif que sur l’humour à proprement parler. Cela rend d’autant plus rageantes ses hésitations à explorer ses personnages pour nous donner envie de les prendre en affection !
La saison 1 ne comporte que deux intrigues de ce type, et encore, Ghosts humanise alors en priorité ceux sont déjà les plus sympathiques ! Pat, le chef scout bienveillant des années 80, et Robin, l’homme des cavernes joueur d’échecs, sont les deux fantômes les plus intelligents du lot (Pat étant plutôt intelligent sur un plan émotionnel, et Robin plutôt un intellectuel, ce qui est d’ailleurs une jolie distortion du stéréotype habituel sur son époque). Quand bien même ils ne sont pas sans défauts, ils sont clairement les deux personnages dont on avait le moins besoin de nous expliquer pour quelle raison ils pourraient se montrer attachants avec le temps.
Malgré cela, pendant un long moment, les fantômes ne sont pas très développés. Ce que nous savons de leur personnalité sera rarement détaillé ou nuancé : Kitty est une jeune femme noble avec un gros déficit d’affection, toujours en quête de l’amitié et l’approbation d’autrui (surtout Alison) ; Fanny est une ancêtre lointaine d’Alison très snob et à la critique facile ; Mary est une paysanne peu cultivée à qui il faut tout expliquer en permanence ; Thomas est un poète convaincu d’être un grand artiste mais qui passe surtout le plus clair de son temps dans la horny jail (et qui a jeté son dévolu sur Alison… oui, même sachant qu’elle est mariée) ; le Capitaine est un militaire qui voit tout par le prisme de la guerre et/ou de la stratégie ; Julian est un politicien plein de vices qui est d’ailleurs mort avec son pantalon sur les chevilles ; et bien-sûr Pat et Robin que j’ai déjà mentionnés. Il y a quelques fantômes supplémentaires, comme les fantômes qui vivent dans la cave parce que c’est là que se trouve leur fosse commune remontant à l’épidémie de peste, mais leurs apparitions sont sporadiques (et je ne pense pas qu’on les ai montrés ni évoqués après la saison 2). Une fois que vous savez ça, vous savez tout ce qu’il y a à savoir des fantômes, dans les grandes lignes.
Fort heureusement, ça s’arrange à partir de la saison 2. Il y a quelques épisodes pendant lesquels la série s’autorise quelque chose d’un peu plus touchant, comme par exemple un fantôme qui est triste de ce qu’il a laissé derrière lui en mourant, ou de la nostalgie face à tout ce qui a changé depuis son vivant… Hélas il faudra vraiment faire preuve de patience pour que la série essaie d’enrichir ses portraits au lieu de jouer la répétition.
Par exemple il est établi très tôt que le Capitaine est un homosexuel refoulé, donc quand, après quelques épisodes, il se prend d’affection pour un personnage masculin de passage, on a droit à une répétition des mêmes gags proposés précédemment. En outre, notre Capitaine n’a pas fait de coming out même après des décennies passées dans le manoir avec les autres fantômes, aussi on n’obtiendra pas vraiment une réaction de la part des autres personnages, à qui il n’est jamais donné l’occasion de rebondir sur le sujet (bien qu’il semble que ce soit un secret de polichinelle). Du coup, si ni le scénario ni les personnages dans ce scénario ne s’y intéressent, pourquoi en tant que spectatrices le devrions-nous ? Ce n’est pas toujours clair, surtout que beaucoup de ces tentatives ne suscitent pas plus l’émotion que le rire. Alors au juste, qu’est-ce qu’on fait là ?
Je me suis longtemps posé la question. A mon sens, ces défauts commencent vraiment à être gommés à partir de la saison 3, sans conteste la plus réussie, peut-être parce que c’est celle qui hésite le moins à donner dans le tear jerker. Or c’est aussi la première saison pendant laquelle j’ai réellement ri, et je crois sincèrement que c’était ce qui lui manquait : un équilibre.
Plus que toute autre, la saison 3 de Ghosts (et à ce jour la dernière, même si son équipe de production se dit prête à rempiler) propose un fil rouge : l’apparition de Lucy, la demi-soeur qu’Alison ignorait avoir. C’est l’occasion pour la série de tisser une vraie relation entre les deux femmes, fragile mais avec une intéressante évolution. En outre l’existence de Lucy pose, bien-sûr, des questions juridiques et morales quant à l’héritage du manoir (lequel est toujours un gouffre financier, et d’ailleurs c’est vraiment appréciable de voir Ghosts parler d’argent, plus précisément d’argent qui manque), ce qui permet de préserver les enjeux des deux saisons précédentes. En parallèle, Alison est désormais entourée de ses fantômes avec plus de complicité que jamais, et la dynamique « les fantômes sont impossibles à vivre, Alison et Mike galèrent avec la maison, voyons comment ce petit monde va quand même cohabiter » se transforme en une routine chaleureuse et confortable, toutes les personnes impliquées consentant un effort pour que la vie soit un peu plus supportable. Ou la mort, c’est selon. Au point qu’au moins trois intrigues (sur six) utiliseront à leur avantage le fait que Mike est, bon gré mal gré, exclu de la plupart des interactions avec les fantômes.
 Il faut donc du temps à la série britannique Ghosts pour trouver un équilibre, et le ton juste. Ce qui incite à regarder la version américaine, qui a débuté hier soir, avec prudence également.
Il faut donc du temps à la série britannique Ghosts pour trouver un équilibre, et le ton juste. Ce qui incite à regarder la version américaine, qui a débuté hier soir, avec prudence également.
Dans les grandes lignes, l’adaptation pour CBS est plutôt fidèle. Le double épisode d’hier suit d’assez près l’intrigue des deux premiers épisodes de la série de BBC. A une exception près, et non des moindres : Ghosts l’Américaine évite soigneusement de parler d’immobilier ou de questions d’argent. Samantha et Jay ne sont même pas en train de chercher à se loger quand démarre la série, et l’héritage d’une propriété leur apparaît donc plutôt comme une option à explorer ou non, pas une opportunité de la dernière chance. A l’exception d’un bref moment pendant lequel Jay, dans le deuxième épisode, indique avoir dépensé toutes les économies du couple (ainsi qu’épuisé les fonds disponibles sur les cartes de crédit) pour lancer les travaux dans la maison, on dirait que cette nouvelle version veut gommer l’aspect financier de l’intrigue.
Mais c’est surtout du côté des fantômes qu’il y a du changement. Il était évident que ceux-ci appartiendraient à des époques différentes, le Royaume-Uni et les Etats-Unis n’ayant de toute évidence pas la même histoire. Sauf que cela s’accompagne d’autres changements… à commencer par le fait que globalement, ces fantômes ont une apparence plus jeune ! C’est particulièrement vrai pour Hetty (l’homologue de Fanny), Pete (le pendant américain de Pat), Isaac (un équivalent du Capitaine, bien que bien plus ouvertement gay) et Trevor (le politicien faisant écho à Julian). En outre, la paysanne Mary a été remplacée par une hippie du nom de Flower (…évidemment), elle aussi d’apparence plutôt juvénile.
Ghosts version US fait aussi le choix de donner un rôle différent à certaines de ses protagonistes : il n’y a plus de poète transi d’amour pour Sam, et c’est donc le frat boy Trevor qui fait des avances à la jeune femme à la place (par voie de conséquence, l’Amérindien Sasappis semble n’avoir pas spécialement de rôle au sein du groupe). On pourrait aussi parler des aptitudes particulières de certains fantômes, dont les cartes ont été légèrement rebattues.
Au moins pour le moment, il s’agit cependant de changements de surface, et seules les puristes de la Ghosts britannique y trouveront vraiment à y redire. C’est-à-dire pas grand monde parce que, comme on l’a vu, ce n’est pas le genre de série qui suscite des vocations de fans hardcore. On n’est pas là pour ça.
Reste donc à voir comment la série américaine va tirer partie de ses différences, et en faire quelque chose de valable. Mais surtout, je suis curieuse de savoir si, ayant appris de la progression de son aînée, elle va en gommer les lenteurs, et trouver un équilibre plus vite. Sinon, quel intérêt à un remake ?
Lire la suite »























 A ces difficultés s’en ajoutent d’autres, qui ont moins trait au genre de What We Do in the Shadows, qu’à ses choix propres : cette première saison ne semble pas savoir où elle va. En particulier, elle aurait pu choisir de ne pas du tout être feuilletonnante, ou de l’être… mais on vit dans un étrange entre-deux.
A ces difficultés s’en ajoutent d’autres, qui ont moins trait au genre de What We Do in the Shadows, qu’à ses choix propres : cette première saison ne semble pas savoir où elle va. En particulier, elle aurait pu choisir de ne pas du tout être feuilletonnante, ou de l’être… mais on vit dans un étrange entre-deux. Il y a toutefois quelque chose que je porterai au crédit de What We Do in the Shadows : de toutes les comédies/dramédies que j’ai vues (ou revues, comme Death Valley) à l’occasion de ce weekend spécial, c’est vraiment celle qui prend ses vampires le plus au sérieux.
Il y a toutefois quelque chose que je porterai au crédit de What We Do in the Shadows : de toutes les comédies/dramédies que j’ai vues (ou revues, comme Death Valley) à l’occasion de ce weekend spécial, c’est vraiment celle qui prend ses vampires le plus au sérieux.
 Comme un peu toutes les comédies à base de vampires, Aoki Vampire no Nayami prend des libertés avec le mythe. Ce sont des choix qui sont toujours intéressants (par exemple les vampires de Vampiry Sredney Polosy hier étaient parfaitement capable de sortir la journée sans aucune difficulté), et ceux-ci ne font pas exception. Sou et Aoi sont par exemple capables de circuler dehors en journée, mais leur peau est sensible au soleil et ils portent donc, en plus de leur masque, des lunettes de soleil, des gants, des vêtements à manches longues, et même des parapluie. Le problème majeur qu’ils rencontrent au moment de leur tentative de servir le déjeuner au café est que, la journée, ils n’ont pas d’énergie : un vampire est supposé dormir à ce moment-là, et vivre plutôt la nuit. Ils manquent donc de s’évanouir de fatigue plusieurs fois, ce qui évidemment met un point final à l’expérimentation. Ils ne semblent pas non plus avoir de problèmes avec les croix (il y en a sur leur cercueils et Aoi aura une phrase étrange sous-entendant qu’il dort mieux avec une croix… on n’en saura pas plus).
Comme un peu toutes les comédies à base de vampires, Aoki Vampire no Nayami prend des libertés avec le mythe. Ce sont des choix qui sont toujours intéressants (par exemple les vampires de Vampiry Sredney Polosy hier étaient parfaitement capable de sortir la journée sans aucune difficulté), et ceux-ci ne font pas exception. Sou et Aoi sont par exemple capables de circuler dehors en journée, mais leur peau est sensible au soleil et ils portent donc, en plus de leur masque, des lunettes de soleil, des gants, des vêtements à manches longues, et même des parapluie. Le problème majeur qu’ils rencontrent au moment de leur tentative de servir le déjeuner au café est que, la journée, ils n’ont pas d’énergie : un vampire est supposé dormir à ce moment-là, et vivre plutôt la nuit. Ils manquent donc de s’évanouir de fatigue plusieurs fois, ce qui évidemment met un point final à l’expérimentation. Ils ne semblent pas non plus avoir de problèmes avec les croix (il y en a sur leur cercueils et Aoi aura une phrase étrange sous-entendant qu’il dort mieux avec une croix… on n’en saura pas plus).

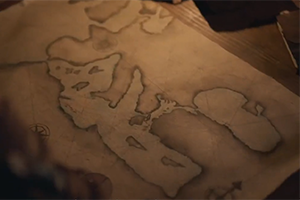 Vous l’aurez peut-être compris, ce qui est impressionnant dans Barbaroslar, c’est l’échelle. L’intrigue se déroule dans non pas une, pas deux, mais trois villes du pourtour méditerranéen, en plus de l’action qui se déroule sur l’eau… et c’est juste le premier épisode !
Vous l’aurez peut-être compris, ce qui est impressionnant dans Barbaroslar, c’est l’échelle. L’intrigue se déroule dans non pas une, pas deux, mais trois villes du pourtour méditerranéen, en plus de l’action qui se déroule sur l’eau… et c’est juste le premier épisode !