
Il y a peu de choses qui me mettent autant en rogne que le manque de courage scénaristique, en matière de télévision.
Quand on pense à tout ce que cela représente de mettre une série à l’antenne : le temps passé à la développer, les sommes engagées, le nombre de professionnelles impliquées… tout ça pour qu’au final le scénario n’ose rien et se limite au service minimum ? C’est tout bonnement inacceptable.
Si je voulais me contenter du strict minimum je serais encore avec mon ex. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle je trouve que le manque de courage scénaristique est encore pire lorsqu’il concerne un remake/reboot/revival/rewhatever.
Donc oui, on parle du premier épisoede de Fantasy Island aujourd’hui. Avec quelques spoilers, j’aime autant vous prévenir.

Et avant que quelqu’un dans le public ne lève la main pour objecter que, « oui, bon, enfin, Fantasy Island, ça n’a jamais vraiment été une franchise très exigeante », je vous arrête tout de suite : Fantasy Island, c’était quand même pas The Love Boat (même si j’admets bien volontiers que sur le papier, la formule est similaire).
Historiquement, Fantasy Island a toujours revendiqué son aspect fantastique, non pas à des fins d’escapisme mais plutôt comme un exutoire : les invitées de l’île fantastique arrivent avec un désir spécifique que l’île peut leur permettre de réaliser temporairement… qui n’est pas ce qui les attend. Invariablement, les invitées arrivent, sûres d’obtenir ce qu’elles souhaitent (elles ont payé suffisamment cher pour ça !), et leur hôte leur indique rapidement que soit leur vœu comportait des zones d’ombre inattendues, soit il n’était pas réellement ce qu’elles souhaitaient. Beaucoup des désirs étaient dangereux, soit émotionnellement, soit même physiquement (certaines invitées de la série d’origine sont mortes sur l’île !). Et quand ils ne l’étaient pas, ils permettait de révéler quelque chose de troublant tout de même. Il faut toujours se méfier des souhaits. Malgré tout, même quand les choses tournaient mal, elles étaient sous contrôle, grâce à l’intervention de l’omniscient Mr. Roarke. Et après s’être fait une frayeur, ou s’être confrontée à des vérités peu agréables, les invitées repartaient comme elles étaient venues… et comblées. Satisfaites non pas d’avoir obtenu ce qu’elles cherchaient, mais d’avoir acquis une forme de sagesse.
En somme, Fantasy Island était une série high concept, dont la structure procédurale permettait des variations infinies autour de contes moraux, de thrillers psychologiques, et autres explorations de la nature humaine. C’était la raison de son succès (ça, et quelques gimmicks entrés dans la conscience collective), qui lui ont permis de compter 7 saisons pour la première série, puis, plus tard, de décrocher deux mises à jour télévisuelles (et une au cinéma, mais c’est pas mon terrain de chasse).
Ce qui nous amène à Fantasy Island 2021 (ou 2 Fantasy 2 Island), qui débarque donc avec la même formule, les même outils, les mêmes opportunités… et près d’un demi-siècle de recul par-dessus le marché. On pourrait s’attendre à deux-trois trucs. Ou au moins à une colonne vertébrale. Mais non.
Fidèle à la structure d’origine, 2F2I propose effectivement de suivre deux intrigues parallèles, de deux invitées dont les intrigues ne seront pas connectées.
Il y a d’une part une présentatrice d’un journal télévisé local, Christine Collins, qui prend des vacances bien méritées après un pétage de plombs très public : elle était devant la camera lorsqu’elle s’est lancée dans un long monologue furieux envers un stagiaire qui avait amené des donuts au studio, alors qu’elle se prive de nourriture depuis des années pour être camera-ready. A son arrivée sur l’île, elle n’a qu’un souhait : manger non-stop, sans aucune conséquence sur son apparence. C’est ça, son fantasme.
Il y a d’autre part une femme âgée, Ruby Akuda, qui est atteinte d’un cancer incurable en phase terminale. Elle est en paix avec le diagnostic, et elle sait que tout sur l’île n’est que temporaire, mais pour quelques jours, juste quelques jours, elle est venue avec son mari vivre loin de la maladie, avant que la mort ne les sépare.
Elles sont accueillies par Elena Roarke (nièce de), qui adopte immédiatement deux attitudes bien distinctes : pour Christine, de l’inquiétude voire même de la sévérité. Pour Ruby, de la douceur et de la bienveillance. Elle force la main à Christine, essayant de l’obliger à se poser des questions dérangeantes comme si elle voulait lui donner une leçon ; avec Ruby, elle veut juste s’assurer qu’elle est heureuse et passe de bonnes vacances…
Pourtant ce qui est frappant, c’est que Christine est clairement celle qui est le plus en souffrance. Elle est aussi celle qui a le plus de choses à régler, entre le deuil de sa mère, une relation difficile à son corps et à la nourriture, et une histoire complexe avec un beau-père verbalement maltraitant, beaucoup de souvenirs lui reviennent alors qu’elle était juste venue pour, enfin, après des décennies de régimes, manger. Il est vrai qu’elle n’est pas certaine de savoir ce qu’elle veut manger, mais en-dehors de ça, elle veut juste déjeuner en paix, sans avoir à subir les souvenirs qu’Elena fait remonter à la surface. De quoi Christine est-elle affamée ?
Ruby est, par comparaison, simplement en train de profiter d’une (littérale) fontaine de jouvence obtenue grâce à son séjour sur l’île, et qui lui permet ainsi qu’à son mari d’avoir 20 ans à nouveau ; elle n’a besoin de rien, mais l’épisode tente de lui inventer des frustration en révélant qu’en réalité, Ruby a toujours été bisexuelle, et que c’est une vie qu’elle se serait « interdite », faute de… pardon je veux être sûre d’avoir bien entendu… faute de « courage ». Ruby a beau expliquer qu’elle a eu une vie heureuse, qu’elle a choisi de passer sa vie avec son mari et qu’elle ne regrette rien, Elena va, sur la fin de son séjour, l’enjoindre à faire preuve de ce « courage », ce qui implique pour elle de ne plus jamais quitter l’île, donc rester jeune, en bonne santé, et… sans son mari qui lui, doit bien-sûr repartir. Quel choix fera-t-elle ?
Vous aurez peut-être remarqué qu’il y a des choses qui ne vont pas dans ce premier épisode de 2F2I. Par exemple : tout.
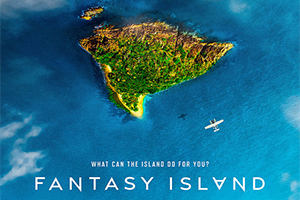 Ce premier épisode de Fantasy Island commence en ayant l’air d’avoir quelque chose à dire sur le culte de la minceur, les attentes démesurées placées sur les femmes dés leur plus jeune âge pour coller à des critères de beautés stricts, et/ou sur les troubles du comportement alimentaires, que Christine a CLAIREMENT développés. Du tout. En fait on a un peu l’impression qu’Elena est furieuse contre Christine de souhaiter s’offrir des vacances loin de ces terribles préoccupations qui ont jalonné la majeure partie de sa vie. Pas loin de se faire engueuler pour son fantasme, Christine est traitée comme une mauvaise élève lorsqu’elle refuse de répondre aux questions invasives d’Elena, alors qu’elle donne tous les signes de quelqu’un qui pourrait arriver à des conclusions par elle-même si on lui laissait le temps de s’interroger sur ce qu’elle a vraiment envie de manger. Mais pas du tout. D’ailleurs quand au final Christine découvre ce qu’elle avait vraiment envie de dévorer… la conclusion de l’épisode le lui retire dans un volte-face décevant au possible.
Ce premier épisode de Fantasy Island commence en ayant l’air d’avoir quelque chose à dire sur le culte de la minceur, les attentes démesurées placées sur les femmes dés leur plus jeune âge pour coller à des critères de beautés stricts, et/ou sur les troubles du comportement alimentaires, que Christine a CLAIREMENT développés. Du tout. En fait on a un peu l’impression qu’Elena est furieuse contre Christine de souhaiter s’offrir des vacances loin de ces terribles préoccupations qui ont jalonné la majeure partie de sa vie. Pas loin de se faire engueuler pour son fantasme, Christine est traitée comme une mauvaise élève lorsqu’elle refuse de répondre aux questions invasives d’Elena, alors qu’elle donne tous les signes de quelqu’un qui pourrait arriver à des conclusions par elle-même si on lui laissait le temps de s’interroger sur ce qu’elle a vraiment envie de manger. Mais pas du tout. D’ailleurs quand au final Christine découvre ce qu’elle avait vraiment envie de dévorer… la conclusion de l’épisode le lui retire dans un volte-face décevant au possible.
Quant à Ruby… oh mon Dieu par où commencer ? Son intrigue toute entière repose sur le fait qu’Elena l’a prise en pitié, et qu’elle veut à tout prix lui offrir quelque chose qui lui manque, alors que Ruby répète plusieurs fois qu’elle est sereine avec la vie qui est la sienne. Cette histoire de sexualité (le mot « bisexualité » n’est évidemment pas prononcé, tu parles de courage) qui aurait été contrariée est surtout une excuse pour qu’Elena, qui fait une grosse crise de validisme, lui offre quelque chose… sauf que Ruby n’en veut pas ! Elle est soudain mise face à un cas de conscience qu’elle n’a pas ressenti, on lui force limite la main à rester sur l’île pour « vivre avec courage » alors que ce n’était ni ce qu’elle voulait en arrivant, ni même ce qu’elle a voulu pendant l’épisode. Et puis ce mythe que les personnes bisexuelles seraient forcément déchirées par la monogamie, vraiment, on en est encore là ? Et je parle même pas des plans insistants sur les corps parfaits en bikini… à se demander si la writers’ room a connaissance de la symbolique de l’autre moitié de l’intrigue.
Alors au final, personne ne quitte l’île en ayant appris quelque chose, ni sur soi-même, ni sur rien. Le fantasme culinaire ultime de Christine s’est avéré être une illusion, et Ruby… bah, elle est pas partie du tout. Et du coup en tant que spectatrices, qu’est-ce qu’on en tire sur le plan émotionnel, psychologique ou moral ? Bah bof.
Alors qu’il aurait suffit de quoi ? D’un rien, pour donner de la saveur (pun totally intended) à cet épisode introductif. Ne pas annuler le wish fulfillment de Christine, par exemple, ç’aurait été impeccable ; la laisser repartir, rassasiée, et ne pas chercher à la détromper (peut-être éventuellement la jouer l’ambiguité après son départ histoire de ne pas effrayer les annonceurs : Fantasy Island est une série de network). Peut-être insister sur son côté symbolique et laisser la véracité du truc en suspens ? Quant à Ruby… bon, clairement, il s’agit d’un personnage qui va rester dans les épisodes suivants, sa conclusion n’en est donc pas une. Mais en apportant une simple variation (faire d’elle une lesbienne, par exemple, ou faire d’elle la personne qui suggère de rester, ou, à défaut, insister sur l’identité de la jeune femme qu’elle rencontre sur l’île…), on aurait pu changer beaucoup de la signification de cette intrigue.
Le problème c’est que pour toutes ces solutions, il aurait fallu avoir du cran. Et Fantasy Island a beaucoup de choses : une distribution (permanente ET temporaire) presque exclusivement féminine, dont une héroïne charismatique ; une majorité de protagonistes racisées ; et du budget. Elle a aussi un gros problème de direction d’actrice dans la quasi-totalité des scènes de Christine, ou alors je me rends pas compte : elle joue toujours aussi mal, Bellamy Young ? Mais elle n’a pas de cran. Sa seule ambition est de faire… ma foi, ce que font beaucoup de séries similaires à l’heure actuelle : essayer de tout faire à la fois sans déplaire à personne.
Devinez quoi : c’est déplaisant quand même.


Lire la suite »



























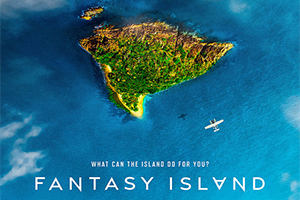 Ce premier épisode de Fantasy Island commence en ayant l’air d’avoir quelque chose à dire sur le culte de la minceur, les attentes démesurées placées sur les femmes dés leur plus jeune âge pour coller à des critères de beautés stricts, et/ou sur les troubles du comportement alimentaires, que Christine a CLAIREMENT développés. Du tout. En fait on a un peu l’impression qu’Elena est furieuse contre Christine de souhaiter s’offrir des vacances loin de ces terribles préoccupations qui ont jalonné la majeure partie de sa vie. Pas loin de se faire engueuler pour son fantasme, Christine est traitée comme une mauvaise élève lorsqu’elle refuse de répondre aux questions invasives d’Elena, alors qu’elle donne tous les signes de quelqu’un qui pourrait arriver à des conclusions par elle-même si on lui laissait le temps de s’interroger sur ce qu’elle a vraiment envie de manger. Mais pas du tout. D’ailleurs quand au final Christine découvre ce qu’elle avait vraiment envie de dévorer… la conclusion de l’épisode le lui retire dans un volte-face décevant au possible.
Ce premier épisode de Fantasy Island commence en ayant l’air d’avoir quelque chose à dire sur le culte de la minceur, les attentes démesurées placées sur les femmes dés leur plus jeune âge pour coller à des critères de beautés stricts, et/ou sur les troubles du comportement alimentaires, que Christine a CLAIREMENT développés. Du tout. En fait on a un peu l’impression qu’Elena est furieuse contre Christine de souhaiter s’offrir des vacances loin de ces terribles préoccupations qui ont jalonné la majeure partie de sa vie. Pas loin de se faire engueuler pour son fantasme, Christine est traitée comme une mauvaise élève lorsqu’elle refuse de répondre aux questions invasives d’Elena, alors qu’elle donne tous les signes de quelqu’un qui pourrait arriver à des conclusions par elle-même si on lui laissait le temps de s’interroger sur ce qu’elle a vraiment envie de manger. Mais pas du tout. D’ailleurs quand au final Christine découvre ce qu’elle avait vraiment envie de dévorer… la conclusion de l’épisode le lui retire dans un volte-face décevant au possible.













