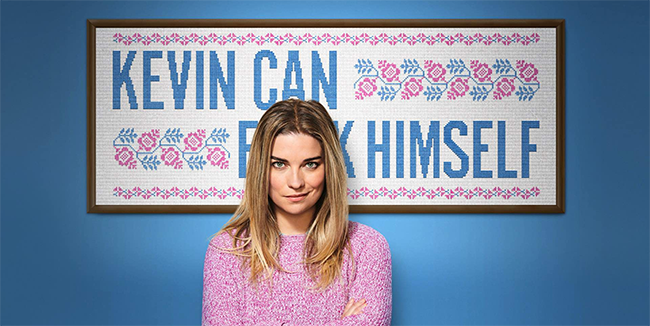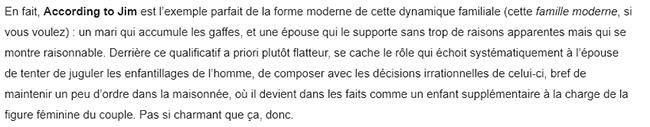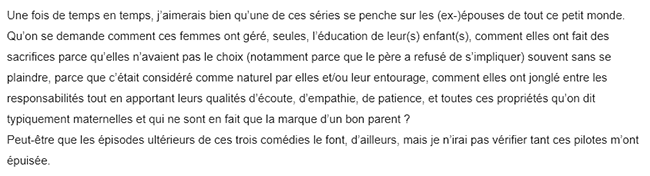Si j’ai hésité avant de me lancer dans une review du premier épisode de Kevin Can F**k Himself, ce n’est pas parce que je n’avais pas envie d’écrire à son sujet, mais parce que l’ambition dévoilée dans cet épisode inaugural donne le vertige. Très honnêtement, je me suis demandé si j’avais pris toute la mesure de ce que je venais de voir. Ne jamais exclure la possibilité qu’écrire une review ne fasse que mettre en évidence ma bêtise…
Comme vous pouvez le voir, je me suis finalement ravisée. Après tout, ce que j’aime aussi dans les reviews dites de « pilote », outre la question de la découverte (et du partage de celle-ci), c’est le fait qu’il s’agisse d’une photographie à un instant donné de ma compréhension et de mon appréciation d’une série. Toutes deux peuvent évoluer avec les épisodes, et c’est même heureux ; alors coucher sur papier les impressions initiales peut être intéressant. Plus tard, en comparant les notes, en constatant que certaines choses initialement évoquées ont été abandonnées (ou que d’autres au contraire ne se sont révélées qu’en cours de saison/série), en voyant ce qui m’avait fait forte impression et n’était finalement pas capital pour la série, on obtient une mesure plus exacte du chemin parcouru.
…Bon et puis plus prosaïquement, pour des séries comme Kevin Can F**k Himself, on n’a pas trop d’une review dédiée pour expliquer le concept d’un épisode introductif complexe.
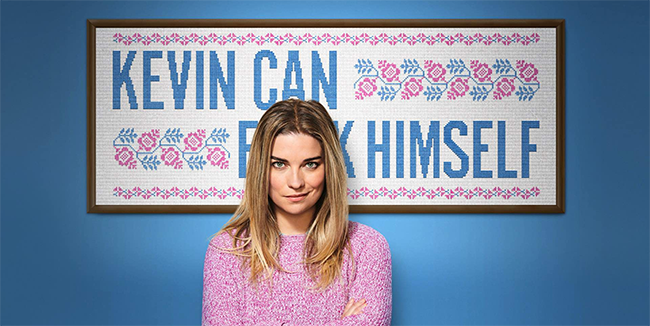
Avant de détailler ce concept, quelques mots sur le sujet de la série elle-même. Kevin Can F**k Himself, dont le titre évoque à dessein un sitcom de 2 saisons appelé Kevin Can Wait (mettant en scène le comédien Kevin James), s’intéresse à un couple d’Américains moyens : Kevin, un installateur de câble, et son épouse Allison, caissière dans un magasin d’alcool. Leur dynamique est celle d’environ tous les couples de séries domestiques étasunienne, Kevin n’ayant jamais vraiment grandi dans sa tête, et Allison étant plutôt celle qui est organisée et sérieuse, limite à l’excès. Le couple n’a pas d’enfants, sauf si l’on compte leurs amies/voisines qui sont aussi immatures que Kevin, et qui passent le plus clair de leur temps libre dans le salon de Kevin et Allison.
C’est le moment où, si vous me le permettez, je vais me citer moi-même. Dans la review du pilote d’According to Jim, il y a quelques mois, je vous expliquais les dysfonctionnements induits par cette description des dynamiques de couple, qui sont devenues dans les années 90 le standard du sitcom familial de network :
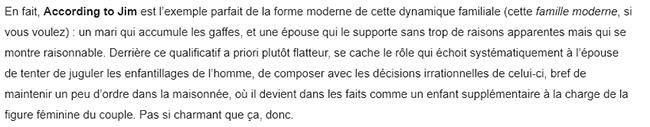
A plusieurs reprises au cours de son premier épisode, Kevin Can F**k Himself joue sur ce registre, en rappelant à travers les dialogues, notamment, des pitreries passées de Kevin, qui correspondent en tous points aux intrigues typiques de ce type de sitcom, généralement trop intéressées par l’aspect « rigolo » des aventures du mari pour vraiment se poser la question des conséquences. Il y a aussi plusieurs scènes (et on va y revenir) qui mettent en lumière l’insouciance obstinée de Kevin, plus intéressé par le beer pong avec ses potes ou sa console de jeux, face à une Allison qui essaie désespérément d’organiser leur anniversaire de mariage. Kevin Can F**k Himself repose sur ces éternels tropes, supposément représentatifs de la vie familiale de l’Amérique moyenne. D’ailleurs la série fait ouvertement référence à certains de ces sitcoms directement (comme voir le bedonnant Kevin en bleu de travail dans son salon, comme c’était le cas de… Kevin James dans The King of the Queens). Mais c’est facile de le prétendre quand les intrigues sont toujours montrées du point de vue du personnage masculin, comme toutes les autres comédies du genre.
Sauf que non. Pas du tout. Kevin Can F**k Himself n’est pas un sitcom de network. C’est au contraire une série dramatique d’AMC… une chaîne qui n’a jamais produit le moindre sitcom depuis Remember WENN, sa toute première série originale en 1996 et déjà produite en single camera.
C’est là que pour la seconde fois aujourd’hui, je vous demande de bien vouloir m’excuser, parce que je vais me citer à nouveau. Cette fois c’est la review combinée que je vais rappeler à votre bon souvenir, un article brassant mes impressions sur 3 sitcoms : Man With a Plan, Son of Zorn… et Kevin Can Wait.
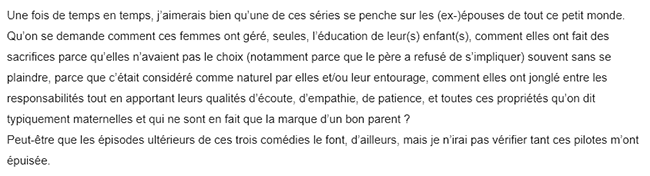
C’est exactement ce vœu que Kevin Can F**k Himself exauce. Alors évidemment, Kevin et Allison n’ont pas d’enfants, comme je l’ai dit ; à ce titre certaines des dynamiques passent à la trappe (j’ai cependant hâte de voir si cet aspect de leur vie familiale va être abordé à un moment). Ce détail mis à part, Kevin Can F**k Himself fait effectivement le choix de s’intéresser à la perspective d’Allison, soulignant le travail qui lui échoit, les efforts qui sont les siens, la patience qui est attendue d’elle dans une vie où tout tourne autour des désirs de Kevin.
A quoi ressemble une vie de facto mise au service de son mari ?
C’est à ce stade qu’on entre dans l’aspect conceptuel de Kevin Can F**k Himself.
Là où les scènes proposées du point de vue de Kevin reprennent les standards du sitcom multicamera, en revanche, les scènes proposées du point de vue d’Allison sont tournées en single camera. Tout change, du tout au tout : l’angle (les plans sont généralement plus larges en multicam, et focalisés sur le visage d’Allison en single camera), les couleurs, les lentilles, le son, même.
Lorsque son mari n’est pas au centre des attentions et qu’elle se retrouve hors de son orbite, Allison ne vit pas dans un monde coloré et loufoque ; elle est au contraire sujette à un stress intense, parce que c’est sur ses épaules que repose la vie de couple. C’est à elle de prendre les décisions, grandes comme petites, et le problème n’est pas tellement qu’elle en ait la responsabilité mais plutôt qu’elle doive prendre ces décisions malgré Kevin. Celui-ci est parfaitement content de sa vie, et pour cause ! Il ne voit donc pas l’intérêt de se poser une seule des questions avec lesquelles Allison bataille au quotidien. Grand adepte de l’immobilisme, et encouragé en ce sens par le reste de son entourage, Kevin a déjà tout le confort dont il a besoin. Même si ce confort, il est en réalité assuré par Allison.
Un aspect fascinant de la configuration de cet épisode est qu’Allison vit dans le monde de Kevin, mais, mécanisme notable, l’inverse ne se produit jamais. A un tel point que je n’osais pas respirer sur la fin du pilote, quand Kevin Can F**k Himself a failli changer cette dynamique. J’avais quelque chose dans la main pendant mon visionnage, et l’objet en question est tombé sur mon bureau avec un bruit sourd, sous l’effet de la surprise. C’est à mon sens le dispositif le plus marquant de cette exposition.
Kevin Can F**k Himself commence alors qu’Allison n’a pas encore fait le lien entre son stress et le comportement de son époux, qui en cause une large partie (…mais peut-être pas tout).
Le premier épisode démarre alors qu’elle a même encore des espoirs de projets, et espère améliorer leur vie commune en prévoyant d’emménager dans une nouvelle maison. Tout ce qu’il lui faut, c’est ne pas perdre le cap, et progressivement pousser Kevin dans la bonne direction ! Les rêves d’Allison (ce n’est pas le premier : on apprend qu’à un moment elle voulait reprendre ses études) ne sont pas démesurés, ils témoignent simplement d’une volonté d’améliorer l’ordinaire, d’obtenir plus de confort, d’aspirer à un peu plus de sérénité. Les changements qu’Allison appelle de tout son être sont des chances (et une ligne de dialogue l’explicitera vraiment bien vers la fin de l’épisode) de faire table rase de ce qui ne fonctionne pas, et d’enfin souffler un peu. Bref, c’est un désir d’obtenir pour elle ce qu’elle fournit à Kevin.
Allison rêve (sans doute déraisonnablement, mais les épouses aussi ont droit à la déraison) d’appuyer sur un bouton qui transforme son existence en conte de fées, ou au moins, en conte de fées domestique. Le problème c’est qu’évidemment, elle ne peut pas porter ces changements à bout de bras. La scène-pivot de ce premier épisode va éteindre les dernières de ses illusions quant à sa propre vie, et lui faire comprendre que l’avenir idéal auquel elle se raccrochait… ne se produira jamais. Il n’y a pas de « mieux ». Quoi qu’elle fasse, elle est impuissante : elle n’a jamais eu le contrôle, elle a juste eu des responsabilités. Un travail colossal dont, en plus, son mari n’a eu de cesse au fil des années de souligner l’inutilité, la frigidité, et/ou la stupidité.
Kevin Can F**k Himself est la deuxième série cette année, après WandaVision, à s’appuyer presque totalement sur la culture télévisuelle américaine pour raconter son intrigue. Pas de la même façon, ni dans le même but ; mais toujours en reprenant les codes de séries antérieures pour raconter des histoires qui, eh oui ma bonne dame, même en 2021, sont encore neuves.
Des dizaines d’épouses de télévision ont vécu sans sourciller (ou jamais au-delà d’un épisode donné, exactement comme décrit pour le pilote d’According to Jim) la stagnation imposée par des maris qui, de leur point de vue, avaient tout pour être heureux. Le pire, c’est que ces femmes de fiction ont alimenté une culture sexiste bien réelle, elle, et qui a influencé les dynamiques de nombreuses cellules familiales américaines (et au-delà). D’ailleurs Allison elle-même tire une partie de ses fantasmes… de sitcoms similaires.
Bien que n’étant pas exactement un sitcom elle-même (ou à la rigueur, disons qu’elle l’est pour moitié), la série Kevin Can F**k Himself est l’héritière de plusieurs décennies de fictions s’appuyant sur le language des sitcoms, parlé par des millions de spectatrices, pour faire passer son message. Et de spectatrices il est bien question ici.
Je ne sais pas où Kevin Can F**k Himself va aller au-delà de cette introduction. La brutalité de son propos comme de son concept peut mener à de grandes choses, surtout une fois que l’héroïne n’est plus dupe de l’hypocrisie de son existence. Pour le moment, le premier épisode reste assez flou sur ce que seront les conséquences du changement de perspective d’Allison, et ce n’est après tout pas son rôle de tout dévoiler d’emblée.
La bonne nouvelle c’est que maintenant, mes premières impressions ont été mises à l’écrit, et que je pourrai y revenir d’ici quelques épisodes. Et au passage, si vous n’en aviez pas encore l’intention, j’ai peut-être réussi à vous convaincre d’y jeter un oeil. Avec ou sans mari.


Lire la suite »