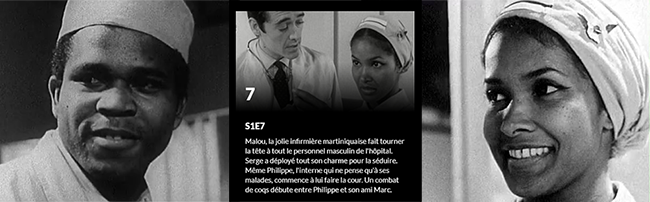De tous mes regrets en 2020, ne pas avoir trouvé le temps ni les mots de vous parler de Followers est mon plus grand. En tout cas téléphagiquement parlant… et en fait, même au-delà. Followers a été tellement importante pour moi.
Ce mois-ci, vous avez voté pour que l’article bonus correspondant aux donations sur Tipeee porte sur l’une de mes séries préférées de 2020, m’offrant une seconde chance. J’espère ne pas la gâcher.
Il est assez rare pour la fiction japonaise de parler de show business ; il y a des exceptions, bien-sûr, comme Toranai de Kudasai!!! ou par exemple, et j’ai toutes les intentions du monde de vous en parler à un moment, de M: Ai Subeki Hito ga Ite. Mais globalement les choses en sont là, et les raisons à cela sont multiples.
Toutefois, la plus importante d’entre elles pourrait se résumer aisément à « on ne chie pas là où on mange » ! Rappelons que la plupart des séries japonaises sont produites en in-house, c’est-à-dire par les équipes de production des chaînes elles-mêmes, et non par des sociétés de production indépendantes. Du coup, le meilleur moyen de ne pas froisser la direction ni les partenaires commerciaux de celle-ci, c’est encore de ne pas mettre le sujet sur le tapis du tout, et de passer sous silence le fonctionnement de l’industrie et plus encore ses coulisses. Faudrait pas que quelqu’un se sente visé, d’autant que comme vous le savez, l’industrie du divertissement japonaise repose sur les synergies. Tout le monde mange au même endroit ! Se mettre à dos une agence artistique ou une maison de disques, c’est inconcevable.
Force est de constater que ce sont des considérations dont Netflix n’a mais alors rien à péter. D’abord, qui va oser se fâcher contre Netflix, hein, qui ? Et quand bien même, vous pensez que Netflix joue son bilan annuel sur le marché japonais ? Voilà. Donc du coup : perché. Au moins en partie. Et puis pour le moment, la politique de fiction japonaise de Netflix en est encore au point d’essayer d’offrir des séries révolutionnaires dans le panorama national (ce qui n’est plus vraiment sa priorité dans la plupart des autres pays du monde), donc à la limite, bouleverser le statu quo, c’est bon pour les affaires.
C’est ce qui explique que, malgré le nombre restreint de séries live action originales produites au Japon pour la plateforme, on en trouve déjà deux sur le show business, libérées de (quasiment) toutes les contraintes du milieu. Après Zenra Kantoku (dont la deuxième saison n’arrivera pas une minute trop tôt en juin), voilà donc que Netflix nous a proposé en février l’an dernier la série Followers.
Qui va plus loin encore dans la démarche, en fait : cette fois, impossible de s’abriter derrière un biopic.

Followers est, fondamentalement, une histoire d’ambition.
Celle de Limi Nara, d’abord, une photographe ayant rencontré le succès et désormais au sommet de sa carrière. Lorsque démarre la série, elle est la reine de la soirée pendant la remise d’une récompense de Femme de l’Année ; elle se prépare également à exécuter plusieurs photoshoots pour de grandes publications et à voyager à l’international ; elle travaille avec les figures les plus importantes du divertissement ; elle a une bande d’amies dans le show business (le manager Yuruco, l’agent-star Akane, et la cheffe d’entreprise Eriko), avec lesquelles, au fil des décennies, elle a vécu les évolutions de sa carrière. Il faudrait aussi mentionner l’influence immense qu’elle a, au-delà de ses activités professionnelles, sur les réseaux sociaux. Tout semble lui réussir mais ce n’est, évidemment, pas si simple. Car même arrivée à ce point dans sa vie, il y a encore des choses qui manquent à Limi, de nouveaux objectifs à atteindre.
A l’inverse, la jeune actrice Natsume a tout à construire. Arrivée à Tokyo où elle espère percer, elle ne décroche pour le moment que des rôles de cadavres, et survit uniquement grâce à des petits jobs dans la restauration ainsi que le soutien sans faille de sa meilleure amie Sunny. Rien ne semble fonctionner alors qu’elle ne rêve que d’évoluer et de réaliser son rêve… mais elle manque aussi d’un petit quelque chose qui lui permettrait d’avancer. Est-ce elle qui ne sait pas se vendre, la totale indifférence qu’elle suscite sur les réseaux sociaux, le fait qu’elle n’ait pas signé avec la bonne agence, ou tout simplement les attentes du milieu qui ne correspondent pas à qui elle est ? Un peu de tout cela. Toujours est-il que dans le premier épisode, son agent l’avertit que si elle ne décroche pas un rôle rapidement (…et « une personne vivante », cette fois), elle perdra jusqu’à son contrat avec la compagnie artistique.
C’est hélas ce qui se produit après une expérience déshumanisante sur le plateau d’un photoshoot publicitaire qui tourne à l’échec ultime… mais qui paradoxalement s’apprête à changer le cours de sa vie.
Il apparaît rapidement que l’ambition que veut décrire Followers n’est pas une idée aveugle du succès ni de la célébrité. Ce n’est pas exactement la gloire qui importe aux héroïnes principales de la série (et pas plus aux autres), mais plutôt la recherche d’une satisfaction, d’un équilibre, bref, du bonheur.
Followers interroge, au passage, si notre ambition sert toujours nos propres intérêts ; si nous cherchons ce dont nous avons réellement besoin ; qui sont les amies que l’on mérite, celles que l’on ne mérite pas et celles qui ne nous méritent pas ; qui nous voit réellement dans un monde où la visibilité semble au centre de tout et pourtant si flottante. Ce n’est pas tant les réseaux sociaux eux-mêmes qui intéressent Followers, mais les habitudes sociales qui ont envahi presque toutes nos relations à cause d’eux, y compris notre relation à nous-même.
Ne vous y trompez pas. Followers a bel et bien l’intention de parler du show business en lui-même, et pas de le traiter comme simple métaphore. Et il s’y déroule des choses vraiment courageuses pour une série japonaise parlant de l’industrie du divertissement japonaise… comme par exemple avoir une intrigue, justement, dans laquelle une personnalité froisse une compagnie et voit sa carrière quasiment détruite dans la foulée. Followers dit à voix haute ce que tout le monde sait sur l’entertainment japonais, mais ose à peine chuchoter depuis des années.
C’est fait de façon d’autant plus audacieuse que Followers fait ce que les séries des quatre coins du monde sur le show business font de mieux, c’est-à-dire mêler réalité et fiction, en invitant des personnalités japonaises à jouer leur propre rôle (Erika Sawajiri, Miyavi, Naomi Watanabe, Yuu Yamada…), tout en ayant, à son générique, des personnalités japonaises qui incarnent des rôles de composition (Mika Nakashima jouant la chanteuse sayo, ou Nobuaki Kaneko qui m’a donné l’une de mes chansons préférées de l’univers et endosse le rôle du manager Yuruco, par exemple). Dans ce joyeux brouillage, on peut ainsi se permettre d’interroger sa personnalité publique (Nakashima occupe la scène musicale nippone depuis près de 20 ans), ou se cacher derrière un rôle de soutien ou de guest pour explorer d’autres choses. Et toutes les nuances au milieu. Evidemment, comme c’est toujours un peu le cas pour ce type de fiction, certaine des subtilités n’apparaîtront qu’à celles parmi le public qui connaissent l’industrie japonaise ; l’essentiel du message, cependant, est parfaitement audible pour quiconque regarde la série avec des yeux neufs.
Mais de toute façon, la série ne se résume pas à ça.

Followers se réclame d’un héritage féministe. Un féminisme moderne, qui se veut à la fois optimiste et réaliste sur les difficultés rencontrées par ses personnages féminins, et qui a la volonté affichée de se vouloir inclusif.
Explicitement, la série s’interroge sur les possibilités de bonheur d’une femme japonaise de nos jours : plus particulièrement, entre 2018 et 2020 puisque son intrigue de 9 épisodes seulement s’étend sur deux années. Ses protagonistes Limi et Natsume, ainsi que leur entourage respectif, personnifient des choix et des opportunités différentes, que la série interroge. Toutes les femmes en question étant des femmes actives de deux générations, la notion de succès est omniprésente, mais Followers s’interroge sur sa forme en permanence.
Par certains égards, les scènes dans lesquelles les groupes d’amies se réunissent pour partager les hauts et les bas pourra rappeler d’autres séries, et c’est assez naturel. Les passages mettant en scène Limi et ses amies Yuruco, Akane et Eriko, a fortiori parce qu’on parle de femmes riches et un peu âgées, évoqueront à l’occasion Sex & the City. En 2020 ? Voilà qui fait un peu cliché au premier abord.
Mais il faut bien garder à l’esprit qu’il n’y a pas eu de Sex & the City japonais. En fait, il n’y a jamais eu de série comme Followers dans toute l’histoire (pourtant longue) de la télévision nippone. Une série dont deux des personnages centrales sont LGBT (ainsi qu’au moins un personnage secondaire) ; où il y a des scènes de sexe lesbien (TRANSIT GIRLS, la première série lesbienne de ce pays, 4 ans plus tôt, n’en avait pas, et on s’y embrassait du bout des lèvres) ainsi que des références au mariage et à l’adoption par des hommes gay ou bi ; où l’on montre le sang d’une fausse couche et la cicatrice d’une ablation du sein ; où l’on parle de désir d’enfant mais aussi de l’ambivalence face à ce désir ; où l’on a été mariée plusieurs fois ou bien on manifeste le désir de ne pas choisir le mariage plutôt que le travail ; où l’on fait un enfant toute seule ; et bien plus encore. Il peut arriver qu’un dorama fasse référence à certains de ces aspects, mais aucune série n’en a abordé autant, et certainement pas avec une approche bienveillante mais analytique qui il y a encore quelques années aurait été inimaginable.
Cela ne veut pas dire que Followers réussit sur tous les points. Cela étant, je crois qu’on sera toutes d’accord pour dire que quand on est la première à faire quelque chose, on a le droit à quelques tropes un peu usés ailleurs.
Followers est en outre une série qui n’emploie pas ces chemins pour le plaisir de remplir des quotas, mais bel et bien parce qu’elle a quelque chose à en dire. Le meilleur signe, c’est que lorsque la série n’a rien à dire de ses personnages et de leurs intrigues, elle s’autorise à les laisser en sommeil pendant un épisode ou deux, plutôt que de leur faire jouer les second couteaux dans les intrigues des autres. Et vice-versa, d’ailleurs. Si tout le monde avait ne serait-ce que cette présence d’esprit, on éviterait déjà beaucoup de problèmes dans certaines représentations boiteuses.
Mais même comme ça je n’ai pas encore tout dit du bonheur que représente Followers.
Tout simplement parce que ce n’est pas seulement une série qui a quelque chose à raconter. C’est une série qui a une intention marquée sur comment le raconter.
On dit souvent que la télévision est un medium d’autrice, par opposition au cinéma qui serait principalement le terrain de jeu des réalisatrices. Il y a de bonnes raisons, d’un point de vue historique et industriel, à cette conception des choses, mais il faut tout de même rappeler que nombre de grandes réalisatrices de la planète ont commencé et/ou produit des oeuvres majeures pour la télévision. Et ce n’est certainement pas récent. Si vous en doutez, Lars Von Trier revient à la télévision danoise avec Riget Exodus l’an prochain pour vous le rappeler.
Parmi ces grandes réalisatrices, il faut maintenant compter Mika Ninagawa. Elle est, certes, la co-autrice de la série (avec Yuri Kanchiku, qui signera l’an prochain la série japonaise évènement First Love ; et Kouta Ooura), mais elle est avant tout la réalisatrice de l’intégralité des 9 épisodes de la série. Photographe de formation, à l’occasion réalisatrice de clips musicaux ou de publicités léchées, elle est connue principalement pour ses couleurs vives, qui forment la patte reconnaissable entre mille de Followers. Une série comme ça non plus, il n’y en a pas souvent au Japon (un pays où encore une fois les réalisateurs de séries sont plutôt des employés de chaînes que des créatifs indépendants, et où les séries, tournées dans des délais très serrés quasiment en parallèle de la diffusion, n’ont pas souvent le bénéfice de la post-prod).
Il n’y a rien que Mika Ninagawa aime tant que les couleurs saturées, surtout si elles sont placées en contraste direct avec d’autres couleurs saturées et/ou des motifs complexes. Plus il y a d’accessoires, de fleurs, de néons, de filtres, plus elle est contente.
Chose sur laquelle nos goûts se rejoignent ! L’ensemble donne des scènes d’une beauté intense, où une même pièce peut changer de couleur du tout au tout, d’une scène à l’autre ou parfois au cours d’une même scène, pour refléter une émotion différente. Où les vêtements fluo se pressent devant des papiers peints chargés. Où les lampes sont omniprésentes, rajoutant des couleurs primaires ou secondaires à des plans qui n’en manquaient pourtant pas. Les lectrices les plus fidèles de ces colonnes comprendront que je donne l’un des meilleurs compliments possibles en disant que le style visuel de Mika Ninagawa m’évoque celui de Luiz Fernando Carvalho. Le soir pour m’endormir, je les imagine s’envoyer des polaroids fluos chacune depuis le bout de leur monde. Personne n’est plus amoureuse que moi de la façon dont Mika Ninagawa est amoureuse de la couleur.
A cela faut-il aussi ajouter un univers bourré de références artistiques (notamment cinématographiques ; encore une fois je me répète, mais c’est l’école Luiz Fernando Carvalho), une camera qui ne se répète jamais, une obsession pour trouver les lieux les plus hauts en couleur de Tokyo, et par-dessus le marché une passion invétérée pour le symbolique… Where do I sign ?
Ce n’est pas qu’une question stylistique. Même moi qui suis peu experte dans l’aspect technique de la réalisation, je suis capable de vous rappeler que la forme a toujours un sens. Aucune gratuité dans la façon dont Followers vous provoque des fractures de l’oeil à chaque seconde, non seulement parce que comme on l’a dit la série a plein de choses à explorer dans ses intrigues, mais surtout parce que l’idée, c’est d’agir comme un rehausseur d’émotion. Je ne saurais compter le nombre de fois où j’ai explosé en sanglots, ravagée par la beauté d’une scène ou d’une autre. Le genre de beauté qu’a choisi Followers est du genre qui vous rend vulnérable à la moindre émotion ; tout est plus intime dans ce Tokyo bariolé. La ville est vaste, mais jamais impersonnelle ; en fait tout le monde semble y avoir trouvé sa place visuellement. Ce n’est pas un patchwork « pop », c’est une succession d’existences et chacune a son style, son lieu où chaque protagoniste existe sans concession (l’appartement de Limi ne pourrait être habité que par elle !).
J’aimerais pouvoir dire que c’était l’effet de surprise, mais revoir la série pour les besoins de cette review (…genre j’étais contrainte et forcée !) m’a fait strictement le même effet. Il y a quelque chose dans la beauté étourdissante de Followers qui donne encore plus d’impact à ses personnages, à leurs émotions, à leur sort, à leurs amitiés.
En un sens c’est une bonne chose que si peu de séries accomplissent ce que produit Followers. On a besoin de médiocrité parce que si on regardait des choses puissantes comme ça tous les jours, on ne tiendrait tout simplement pas le choc. Mais la bonne nouvelle c’est qu’il existe aussi des séries comme Followers, ambitieuses, belles et sincères, qui nous détruisent et nous mettent sur pied dans le même mouvement.
Et après que tout cela soit dit, je ne peut m’empêcher de remarquer que, bon sang, cette review n’est vraiment pas à la hauteur de ce que j’ai ressenti devant cette série.