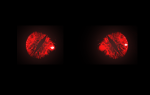Ce confinement apporte des visionnages des plus improbables. Cette semaine je me promenais sur Youtube l’âme en peine, plutôt dans l’optique de grignoter des extraits, mais boulottant finalement tout ce qui me passait sous la souris (j’ai même regardé trois épisodes de la saison 5 de Rules of Engagement, une série que chaque fibre de mon être méprise… TROIS ! si c’est pas un appel à l’aide, ça).
C’est à ce stade que, pour la première fois depuis des mois, l’algorithme a fait un truc sensé et m’a dirigée vers la chaîne Hunny Haha, où se trouvent les séries originales de TVLand. Dont l’intégrale des deux saisons de Happily Divorced.
Devinez de quoi on parle aujourd’hui.

A la base, je n’ai certainement pas commencé un rewatch de Happily Divorced en vue de faire une review.
S’il y a bien une chose sur laquelle on peut tous tomber d’accord, c’est que reviewer un sitcom multi-camera est la chose la moins gratifiante au monde. Déjà, reviewer une comédie, c’est toujours un peu compliqué. Mais alors, reviewer une comédie dont le format repose principalement sur des gags (et moins sur une histoire : le genre du sitcom est profondément procédural, à la base), c’est pire. A cela s’ajoute le fait que la formule du sitcom multicam reste inchangée depuis des décennies, et qu’en plus Happily Divorced, je vous le disais précédemment, est volontairement basée sur une certaine nostalgie d’un humour grand public. A la base, les raisons qui font exister cette série sous sa forme finale se prêtent donc peu à une critique inédite. Ce n’est pas impossible, mais ça ne va pas de soi.
Personne ne commence un marathon de Happily Divorced dans le but d’en faire une review. Et la meilleure preuve c’est que les reviews globales de Happily Divorced, on en trouve moins que (pour caricaturer) de Mad Men.
Cela étant posé, Happily Divorced a des propriétés intéressantes, et uniques. Même la plus « simple » des comédies a des choses à dire, et du coup moi aussi. Rassurez-vous, je tiens ce crachoir fermement.
Pour commencer on pourrait justement parler de l’héritage de Happily Divorced.
Un héritage dont la série se réclame ouvertement, et qui lui a permis de trouver sa place dans la grille de TVLand à la perfection (une chaîne qui pour l’essentiel fait son beurre non pas de ses fictions originales, mais au contraire de son recours à l’épais catalogue de la syndication), de toute évidence. Dans le cas de Happily Divorced au moins, cet héritage n’est pas une simple solution de facilité : toutes les séries de Fran Drescher portent haut et fort leur parenté avec les classiques que sont I Love Lucy, The Brady Bunch, ou Gilligan’s Island. Leur point commun ? Il s’agit de sitcoms en multicam diffusés pendant les années 50 et 60, et Fran est née à la fin des années 50, faites le calcul. Ces séries reviennent régulièrement dans des références ou des parodies dans The Nanny et Happily Divorced (un peu moins dans Living with Fran), en plus d’inspirer, tout simplement, le style d’humour lui-même. Ca fait d’ailleurs près d’un an que j’ai un article en préparation sur le sujet, un jour peut-être même que je le finirai.
Il s’agit donc assez peu de faire appel exactement à la nostalgie des spectateurs, mais plutôt de puiser dans les influences télévisuelles de la créatrice elle-même. Ce qui fait de Fran Drescher… eh bien, Fran Drescher, c’est sa familiarité avec une forme de savoir-faire classique qu’elle veut faire perdurer. Elle a grandi devant des séries qui restent chères à son cœur (vous mentez si vous prétendez ne pas ressentir la même affection pour vos premières amours télévisuelles en dépit des années et des tendances), qui ont construit son rapport à la fiction et à l’humour ; chacune des séries dont elle est à la tête, depuis, s’inscrit dans cette tradition. Fran Drescher, reine des téléphages.
Elle n’est pas la seule à le faire ; Rachel Bloom, dans Crazy Ex-Girlfriend, procède exactement de la même façon avec le théâtre musical par exemple ; ces deux-là étaient vraiment faites pour s’entendre.
A cette nostalgie d’une certaine vision du sitcom vient s’ajouter, cependant, une envie d’en moderniser les héros, les situations et les gags, paradoxalement.
Parce que Happily Divorced, c’est une série dont les personnages principaux approchent au minimum la cinquantaine, ne forment pas exactement une famille, n’ont pas d’enfants… et passent le plus clair de leur temps à parler de sexe.
D’ordinaire (y compris dans la filmographie de Fran Drescher), le sexe dans les sitcoms se résume à des insinuations à double-sens et des suggestions de ce qui se passe. Pourquoi ? Parce que pardi, le sitcom multicam est historiquement un genre familial (d’où le grand nombre de situations domestiques), et son humour est construit pour être compréhensible par toutes les tranches d’âges présentes devant la télévision en primetime. Ca ne veut pas dire que les personnages de ces séries n’ont pas de vie sexuelle, mais ils se contentent d’y faire allusion de façon détournée, ou d’apparaître côte à côte dans le même lit, en s’embrassant sagement sous les draps (ces fameux draps qui recouvrent le torse des femmes mais pas celui des hommes). Il ne s’agirait pas de fâcher des spectateurs et encore moins de annonceurs.
Dans Happily Divorced, on ne montre peut-être pas le sexe, mais on en parle sans détour. Et pour cause : la situation du départ, c’est que Fran Lovett apprend au bout de 18 ans de mariage que son époux Peter (pardon : « Petah ») est gay. Une grande partie de l’humour tient donc au fait que les personnages n’ont plus de relations sexuelles ensemble, et tentent donc (avec l’énergie du désespoir) d’avoir des relations sexuelles avec d’autres. Happily Divorced s’intéresse donc principalement à ces deux quasi-quincas, ainsi qu’à leur meilleure amie Judi qui est elle aussi célibataire, qui cherchent un partenaire plus ou moins romantique pour combler un manque. Et ce manque est nécessairement sexuel, parce que l’affection et même la vie commune restent inchangées après le divorce de Fran et Petah. La pomme de la discorde, c’est précisément la sexualité.
L’un des gags récurrents de Happily Divorced est ce reproche que fait Fran à Petah d’avoir « décidé » de la priver de sexe ; bien entendu ce ressort en masque un autre, plus dramatique, qui est que la vie que Fran pensait avoir a déraillé à cause de la révélation tardive de l’homosexualité de son mari, mais vers la fin de la saison 2 on apprendra qu’en réalité, elle et Petah ont toujours su cette homosexualité, et qu’ils ont fait leurs choix en ignorant ce fait.
Happily Divorced ne traite pas le sexe comme quelque chose d’abstrait, pourtant. Cela lui serait facile, mais au contraire au fil des répliques et gags visuels, la série est très spécifique quant aux actes désirés ; ce ne sont pas forcément des mots crus qui sont employés, mais ils sont très souvent directs. Masturbation (parent pauvre de la sexualité vu les circonstances) et pénétration de divers orifices sont régulièrement abordées, aussi bien par les personnages ayant la cinquantaine (Fran, Petah et Judi) que la génération au-dessus (Glenn et Dori, les parents encore très actifs de Fran). Rien n’est jamais honteux à dire dans la série, ni à propos du sekse qu’on fait, ni à propos de celui qu’on veut faire. Et pour un couple qui s’est séparé uniquement sur le plan sexuel, Fran et Petah sont étonnamment capables de comprendre l’un les besoins de l’autre et d’y répondre positivement, quand bien même (…à l’exception d’un épisode) ces besoins ne sont pas comblés ensemble. Dans Happily Divorced, tout le monde est horny, et après tout on est entre adultes alors pourquoi s’en cacher ?
C’est terriblement rafraîchissant parce que cette façon très, hm, frontale, d’aborder la sexualité, elle est rare dans les sitcoms multicam ET elle est rare dans les séries avec des héros de cette tranche d’âge (en 2011 Grace & Frankie n’était encore qu’une étincelle dans l’œil de Marta Kauffman). Et elle n’était certainement pas présente dans les séries qui ont inspiré à Fran Drescher son humour ! Déjà que Lucy et Ricky faisaient lit à part…
Fran était déjà entrée dans la vie active quand The Golden Girls a débuté, et l’influence de cette série est donc infiniment moins présente dans l’oeuvre de Drescher, mais on est un peu plus dans ce voisinage-là.
Happily Divorced est donc une série pleine d’envie de renouveler le genre, mais désireuse de ne jamais le renier. Sa formule illustre en fait à la perfection la situation de ses personnages, qui arrivent avec une histoire longue et pleine de rebondissements, des personnalités forgées au fil des décennies et des relations tissées, et un besoin de changement à la fois organique et contradictoire. C’est exactement là qu’en sont Fran et Petah, et selon les épisodes, leur entourage.
A plusieurs reprises, chacun des personnages (Fran et Petah plus souvent que les autres évidemment) va devoir se confronter au besoin d’aller de l’avant, de s’adapter à des circonstances qui changent, mais sans jamais repartir de zéro. La conclusion de nombre des intrigues, et de la série elle-même, c’est qu’ils ont traversé des décennies côte à côte, et que les évolutions ne changent pas qui ils sont individuellement, ni qui ils sont ensemble. C’est parfois difficile à accepter après autant de temps passé dans une certaine configuration, mais c’est aussi un réconfort incroyable que d’avoir des gens sur qui ont peut compter pendant toute une vie adulte.
Dans Happily Divorced, il faut réévaluer certaines choses même après des décennies, mais il y en a d’autres sur lesquelles on peut toujours compter : qui on est, d’où on vient, et l’affection que l’on se porte. Le reste finalement est accessoire, parce qui si on sait qui on est, d’où on vient, et qu’on s’aime, alors dans le fond on peut faire face à tout. C’est une série où l’on apprécie ce que l’on a construit, quand bien même rien n’est garantit dans la vie.
 On pourrait parler encore longtemps… oui bon, JE pourrais parler encore longtemps d’autres caractéristiques de Happily Divorced. De sa place assumée dans le Franiverse (et son rappel d’acteurs, importants mais aussi mineurs, étant déjà apparus dans les 2 autres séries de la trilogie) et de sa place dans la transmission de la culture télévisuelle au sens large (voir aussi : Joan Collins) (je dois VRAIMENT finir cette article un jour), du discours de la série sur la difficultés financières (je recommande d’ailleurs à mes lecteurs les plus intéressés par la question un rewatch de The Nanny, l’une des séries les plus blue collar des années 90, qui n’en ont pourtant pas manqué), des thématiques qui reviennent de série en série dans les anecdotes présentées ou dans les intrigues, du rôle quasi-invisible de Peter Marc Jacobson dans ces décennies de télévision consacrées à mettre en valeur son ex-femme, de la garde-robe presque exclusivement violette de Fran Lovett, même…
On pourrait parler encore longtemps… oui bon, JE pourrais parler encore longtemps d’autres caractéristiques de Happily Divorced. De sa place assumée dans le Franiverse (et son rappel d’acteurs, importants mais aussi mineurs, étant déjà apparus dans les 2 autres séries de la trilogie) et de sa place dans la transmission de la culture télévisuelle au sens large (voir aussi : Joan Collins) (je dois VRAIMENT finir cette article un jour), du discours de la série sur la difficultés financières (je recommande d’ailleurs à mes lecteurs les plus intéressés par la question un rewatch de The Nanny, l’une des séries les plus blue collar des années 90, qui n’en ont pourtant pas manqué), des thématiques qui reviennent de série en série dans les anecdotes présentées ou dans les intrigues, du rôle quasi-invisible de Peter Marc Jacobson dans ces décennies de télévision consacrées à mettre en valeur son ex-femme, de la garde-robe presque exclusivement violette de Fran Lovett, même…
Ne me mettez pas au défi. Comme quoi, on en trouve, des choses à dire, sur un sitcom multicam !
Il s’agit d’autant de raisons pour lesquelles le timing était absolument parfait pour moi. Après avoir dévoré plusieurs saisons de Bob’s Burgers (où les personnages n’ont jamais honte de leurs kinks respectifs, et parfaitement respectés lorsqu’ils les expriment parce que l’affection qu’on se porte va au-delà) et lamenté devant des épisodes d’Ana Andi Nos qu’on n’ait pas assez de séries comme remède au jeunisme (où les personnages arriveraient avec un long passé fait de choix et de relations établies, au lieu de jouer leur avenir dans chaque épisode comme tant d’autres séries), j’étais fin prête pour ce marathon Happily Divorced. J’en ressors… écoutez, presque réconfortée à l’idée que l’une des créatrices et comédiennes de télévision que j’aime le plus au monde (si ce n’est LA) soit toujours capable de me toucher, m’amuser, m’évoquer la télévision de jadis et en même temps me montrer une fiction moderne.
Je pense parfois que je ne pourrais pas aimer Fran Drescher plus que je ne l’aime déjà (et honnêtement Indebted n’aide pas), et puis voilà qu’arrive ce rewatch de Happily Divorced.
Toute la gratitude du monde n’y suffirait pas.


Lire la suite »



























 On pourrait parler encore longtemps… oui bon, JE pourrais parler encore longtemps d’autres caractéristiques de Happily Divorced. De sa place assumée dans le Franiverse (et son rappel d’acteurs, importants mais aussi mineurs, étant déjà apparus dans les 2 autres séries de la trilogie) et de sa place dans la transmission de la culture télévisuelle au sens large (voir aussi : Joan Collins)
On pourrait parler encore longtemps… oui bon, JE pourrais parler encore longtemps d’autres caractéristiques de Happily Divorced. De sa place assumée dans le Franiverse (et son rappel d’acteurs, importants mais aussi mineurs, étant déjà apparus dans les 2 autres séries de la trilogie) et de sa place dans la transmission de la culture télévisuelle au sens large (voir aussi : Joan Collins) 
 Il faut d’ailleurs préciser que dans le manga, c’est un vrai chat qui interagit avec les humains de la maison et accomplit les corvées du quotidien (dans un style plutôt épuré, comme vous pouvez le constater). C’est donc plutôt normal que la série ignore totalement qu’elle a employé un acteur humain plutôt qu’un acteur chat, parce que ce n’était pas le propos de base, en fait. Ca n’a jamais été le but. Dans le fond, tout ce que fait Kyou no Nekomura-san, c’est repousser les limites de la suspension d’incrédulité ; mais une fois qu’on tient pour acquis que c’est à un chat qu’on a affaire, alors ce n’est plus étrange du tout. Ou disons, pas plus que prétendre que l’un des héros d’une série de science-fiction est vraiment né
Il faut d’ailleurs préciser que dans le manga, c’est un vrai chat qui interagit avec les humains de la maison et accomplit les corvées du quotidien (dans un style plutôt épuré, comme vous pouvez le constater). C’est donc plutôt normal que la série ignore totalement qu’elle a employé un acteur humain plutôt qu’un acteur chat, parce que ce n’était pas le propos de base, en fait. Ca n’a jamais été le but. Dans le fond, tout ce que fait Kyou no Nekomura-san, c’est repousser les limites de la suspension d’incrédulité ; mais une fois qu’on tient pour acquis que c’est à un chat qu’on a affaire, alors ce n’est plus étrange du tout. Ou disons, pas plus que prétendre que l’un des héros d’une série de science-fiction est vraiment né