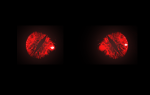Je ne regarde plus la télévision linéaire, mais à l’époque où c’était encore le cas, il était de tradition pour au moins une chaîne par an de rediffuser Sissi avec Romy Schneider pour Noël. Aucune idée si c’est toujours vrai, vous me le confirmerez.
Toujours est-il qu’à mes yeux, Noël est le moment idéal pour vous présenter ma review de Die Kaiserin, une série que j’avais tentée au début de l’année, histoire d’empêcher un 712e revisionnage des deux saisons de The Great qui étaient alors à ma disposition. Ne doutez pas, d’ailleurs, qu’on reparlera de The Great prochainement (surtout maintenant que les grèves étasuniennes sont passées), une fois la colère et la douleur estompées. Hulu, tout ça se paiera un jour.
Die Kaiserin semblait être la série parfaite à s’enfiler pour rester dans un univers similaire à celui de The Great, tout en changeant un peu de paysage. Ce genre de pari est toujours un peu risqué : troquer une série qu’on adore pour une inconnue qui supposément lui ressemble est rarement un socle sain sur lequel bâtir une relation avec une fiction. Mais à ce moment-là, je venais de regarder Marie-Antoinette et je me sentais pousser des ailes.
Die Kaiserin raconte donc l’histoire de la jeune Elisabeth de Bavière, à partir du moment de sa rencontre avec l’Empereur Franz Josef, jusqu’à son mariage avec lui pour rejoindre la cour des Habsbourg en Autriche.

Die Kaiserin suit plusieurs des tropes que l’on trouve dans les autres séries que je viens de citer : une jeune femme qui n’est pas vraiment prête pour ce qui l’attend est mariée à une tête couronnée qui lui apparaît comme un prince charmant… avant de découvrir la cruelle réalité de la vie du palais.
Il n’y a bien-sûr pas que The Great ou Marie-Antoinette pour se lancer dans ce genre d’intrigue ; à peu près toutes les séries se déroulant au sein d’une cour royale reposent plus ou moins sur ce schéma, quel que soit le continent. Les héroïnes de ces fictions ont toutes en commun d’être dépeintes comme plutôt intelligentes et surtout anticonformistes. Elles représentent un idéal d’indépendance charmante, dans un environnement qui ne se prête surtout pas à leur épanouissement et fait tout pour les étouffer, les ramener à leur condition de femmes, les diminuer et/ou les pervertir. L’enjeu est pour elles de rester fidèles à leur nature, de rester authentiquement indomptables, d’incarner un idéal pseudo-féministe dont l’anachronisme varie d’une série à l’autre.
…C’est que, il ne faut pas que cela éclipse totalement l’escapisme : malgré tout cela, la vie à la cour doit quand même un peu faire rêver. Ne serait-ce que visuellement, parce qu’on se fait pas chier à raconter cette histoire sans montrer plein de belles tenues d’époque, quand même.
Die Kaiserin ne fait pas vraiment exception, ni n’apporte grand’chose d’inédit au genre. Dans le cas qui nous occupe, l’indocilité de la protagoniste principale est même assez faiblarde : Elisabeth est unique parce qu’elle aime pas que les animaux meurent, qu’elle écrit des poèmes, et qu’elle aime se balader pieds nus. Quelle rebelle.
 A son crédit, Die Kaiserin ne semble qu’à moitié convaincue par la personnalité de sa propre héroïne ; par moments, la façon dont la série la dépeint semble plutôt questionner ses capacités cognitives que dresser le portrait d’une jeune femme têtue. Car non seulement Elisabeth n’a jamais été préparée à un tel Destin, mais elle ne s’est jamais vraiment intéressée à grand’chose si ce n’est… ce qui passe un peu pour des intérêts spécifiques, au moins dans les premiers épisodes. Honnêtement, c’est difficile de ne pas interpréter certains aspects de son portrait ou certains dialogues comme des tentatives de la placer sur le spectre autistique, et je ne sais pas trop qu’en penser vu le peu d’intérêt que la série investit réellement dans cette interprétation. C’est comme si elle n’avait elle-même pas décidé vraiment qu’en faire.
A son crédit, Die Kaiserin ne semble qu’à moitié convaincue par la personnalité de sa propre héroïne ; par moments, la façon dont la série la dépeint semble plutôt questionner ses capacités cognitives que dresser le portrait d’une jeune femme têtue. Car non seulement Elisabeth n’a jamais été préparée à un tel Destin, mais elle ne s’est jamais vraiment intéressée à grand’chose si ce n’est… ce qui passe un peu pour des intérêts spécifiques, au moins dans les premiers épisodes. Honnêtement, c’est difficile de ne pas interpréter certains aspects de son portrait ou certains dialogues comme des tentatives de la placer sur le spectre autistique, et je ne sais pas trop qu’en penser vu le peu d’intérêt que la série investit réellement dans cette interprétation. C’est comme si elle n’avait elle-même pas décidé vraiment qu’en faire.
Je suis d’autant plus dubitative face à ce traitement que Die Kaiserin opère progressivement une bascule en cours de saison : une fois mariée, Elisabeth tente d’interférer de plus en plus dans les affaires d’État. Chose pour laquelle elle n’avait jamais manifesté le moindre intérêt, et n’a jamais été formée ; son propre goût pour la poésie et la nature ne l’a éduquée ni à la rigidité du protocole, ni aux nuances de la diplomatie, ni aux enjeux géopolitiques de son continent. Die Kaiserin voudrait nous faire croire que c’est son affection pour Franz qui lui donne l’envie (et, par quelque miracle, la compétence) de s’immiscer dans les affaires publiques. C’est un peu gros, mais je suppose que quand on a de grands yeux bleus ça passe.
Enfin, ça passe aux yeux de la série, en tout cas. Die Kaiserin veut lui donner raison, même en dépit du bon sens ; il n’y a pas le discours qu’on entendait, par exemple, dans la première saison de The Great, sur les limites de l’héroïne, son arrogance à penser (jeunesse naïve oblige) qu’elle sait mieux que tout le monde, son incapacité à saisir la complexité non seulement de la cour mais du monde. Non, à la place, Elisabeth est incomprise, et a toujours l’instinct juste même s’il ne se matérialise pas nécessairement par les effets qu’elle espère (mais c’est toujours la faute des convenances, jamais la sienne). Die Kaiserin se refuse à lui apporter de l’épaisseur en la rendant durablement imparfaite ; elle n’a pas de défaut, elle est juste délicieusement… quirky.

Pour le meilleur et pour le pire, la série n’est pas préoccupée que par le sort de la protagoniste éponyme. En fait, Die Kaiserin noie les intrigues personnelles d’Elisabeth dans un ensemble drama qui n’est pas sans intérêt, mais en retire résolument à son héroïne, laquelle par conséquent pâlit souvent par comparaison.
Ainsi, Franz se débat avec son rôle d’Empereur, dont il n’a hérité que quelques années plus tôt, et dans le sang. Lui-même a échappé à une tentative d’assassinat, et craint la réaction du peuple qu’il sait toujours volatile. C’est aussi, toutes proportions gardées, un progressiste, qui estime que l’Empire ne se portera que mieux s’il investit dans la paix et la technologie, plutôt que la guerre et la tradition. Cela n’est pas très populaire, ni auprès de son conseil ni au sein-même de sa famille. Cette position, nous suggère Die Kaiserin, n’est toutefois pas simplement une question de principes humanistes : Franz a, très jeune, été confronté à la violence à la fois de la cour et du peuple, et quand ce n’est pas sa mère qui décide pour lui, ce sont en grande partie ses traumatismes qui le guident. Mais l’épuisent, aussi. C’est un peu la raison pour laquelle il a choisi Sisi plutôt que sa sœur Helene (à laquelle l’opportunité de devenir Impératrice a donc été ravie). En partie parce qu’Elisabeth semble s’extirper des convenances auxquelles il a toujours été soumis ; et en partie parce que c’est une décision qu’il s’autorise à prendre seul. Le début d’une autonomie vers laquelle jusque là il a peiné à s’émanciper.
La mère de Franz, l’Archiduchesse Sophie, qui en tant que femme n’a évidemment jamais pu monter sur le trône en son nom propre, est la première à s’opposer à ses vélléités d’autonomie… pourtant au nom de ses propres terreurs. C’est une femme qui pense en termes de pouvoir, et elle voit celui de sa dynastie s’effriter ; elle y assiste en fait depuis des années et est terrifiée de perdre ce qui appartient aux Habsbourg. Sa priorité est là, quoiqu’il arrive… mais Die Kaiserin prend le temps d’épaissir son portrait, d’aller au-delà l’image rigide et exigeante qu’elle présente au monde et à elle-même. Si elle est aussi terrifiée, c’est qu’elle a perdu beaucoup lors des événements passés, y compris un enfant ; en plus de son autonomie en se mariant, et d’une partie de son statut lorsque Franz s’est marié. C’est elle qui avait initialement prévu que son aîné, d’ailleurs, épouse Helene. Ce choix d’épouse de la part de Franz est pour Sophie le symbole d’un fossé qui se creuse entre elle et son fils aîné, qui échappe de plus en plus à son contrôle. Cela aussi l’effraie. En fait, tout l’effraie : le passé, le présent, le futur. Présentée comme un colosse aux pieds d’argile, Sophie constitue probablement la protagoniste la plus nuancée de la série.
Le portrait de famille ne serait pas complet sans Maximilian, le deuxième fils de la famille impériale. Rien ne lui permet jamais d’oublier sa position dans l’arbre généalogique et, bien-sûr, comme tous les autres princes en son genre, cela le ronge. C’est un anti-conformiste amer (il s’imaginait être celui qui épouserait Elisabeth pour cette raison), un homme d’État éconduit (il se figure être un grand diplomate mais n’est pas écouté par son frère), un épicurien vengeur (il couche avec tout ce qui porte un jupon, tout en fulminant d’avoir perdu l’amour de sa vie). Il a le sentiment de ne jamais obtenir ce qu’il veut, alors il satisfait la moindre de ses pulsions. Cela fait des années qu’il jalouse son frère ainé, et bien-sûr son désir de posséder Elisabeth n’a fait que renforcer cela. Les affronts successifs finissent par pousser Maxi à commencer la planification d’un coup d’État avec plusieurs nobles qui ne rêvent que de se débarrasser d’un progressiste comme Franz, et qui sont, eux aussi, nerveux face à la grogne populaire.
 Die Kaiserin hésite quant à la façon de présenter la fureur du peuple. Par moments, elle insiste sur la pauvreté, l’indignation, la colère des gens « d’en-bas ». Elle introduit même quelques protagonistes pour personnifier et fomenter la révolte, mais a du mal à leur donner quelque chose d’aussi consistant qu’aux membres de la famille royale.
Die Kaiserin hésite quant à la façon de présenter la fureur du peuple. Par moments, elle insiste sur la pauvreté, l’indignation, la colère des gens « d’en-bas ». Elle introduit même quelques protagonistes pour personnifier et fomenter la révolte, mais a du mal à leur donner quelque chose d’aussi consistant qu’aux membres de la famille royale.
Et puis de l’autre, bien-sûr, c’est triste d’être pauvre et de mourir pour l’Empire, mais enfin, c’est l’Empire ! Sans Empire, qui pour porter les belles robes et se prélasser dans les jardins de la série ? Sans Empire, où est la romance ? Sans Empire, qui conduira les luttes fratricides dans les couloirs dorés du palais de Vienne ? Die Kaiserin a du mal à masquer son attrait pour tous ces aspects de la royauté, et combien elle tient à la préserver. L’Histoire, certes, lui donne raison pour le moment, mais la série n’a même pas vraiment envie d’introduire un sens du danger, et moins encore de se préoccuper vraiment du fond. Sur le fond, bon être pauvre c’est nul, mais c’est comme ça, voilà. Et ça ne dérange que les pauvres, en plus (à part Elisabeth qui n’est bonne qu’à jouer les dames patronnesses un jour par mois en moyenne). Là où une série comme The Great était un peu capable d’apporter une réflexion à ce fait de la part de certaines protagonistes, fussent-elles maladroites dans leur processus de pensée ou imparfaites dans l’exécution de leurs intentions, Die Kaiserin ne fait jamais plus qu’effleurer la surface du problème, n’interroge jamais les privilèges ou les angles morts. Son obstination à présenter Elisabeth comme une femme touchée par la cause du peuple et devenant une héroïne pour lui, ne résiste pas à un examen ne serait-ce qu’un peu attentif des dynamiques. Et des enjeux pour ce peuple, que la série traite plus comme un décor que comme des gens avec de graves préoccupations, dans lesquelles…
Imaginez cela. Une série produite en 2022 qui n’est pas capable de voir que commenter les inégalités sociales, les instabilités mondiales, et les tentatives de prendre le pouvoir par la violence, permettent de parler aussi bien du passé que du présent. Passer complètement à côté de tout cela est dur à pardonner.
J’ai fini la première saison de Die Kaiserin, parce que bon, elle n’est pas bien longue de toute façon, et ai compris que j’avais, une fois de plus, commis une erreur.
Quelques mois après mon visionnage, The Great est revenue pour une troisième (et hélas, dernière, a-t-on ensuite appris) saison. Qui m’a donné tout ce que j’espérais, et plus encore. Et puis, au pire, qu’y a-t-il de mal à revisionner quelques centaines de fois supplémentaires une série qui me comble réellement ?