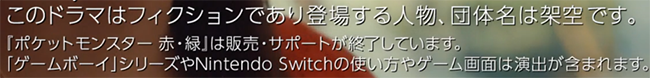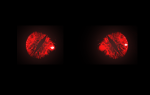Le monde se divise en deux : les séries qu’on aime, et celles qu’on n’aime pas. A la grande rigueur, en trois, si l’on inclut les séries auxquelles on est tellement indifférentes qu’on les oublie avant même l’épisode fini. Mais en tout cas, d’une façon générale, les choses sont simples.
…Sauf évidemment lorsqu’on se retrouve devant une exception, sinon c’est pas drôle. Dans le cas de Such Brave Girls, je me trouve dans l’étrange et inconfortable situation d’avoir du bien à dire d’un épisode de série que je n’ai pas du tout aimé.
Avant que vous ne tiriez des conclusions hâtives de ce TW, non, ce n’est même pas ça le problème. Et d’ailleurs ce n’est pas non plus le point fort.

Josie et Billie vivent avec leur mère Deb dans une petite maison un peu miteuse qui est tout ce qui leur reste. Entre ça et leurs jobs minables, ce n’est pas une vie très reluisante, mais il ne faut pas perdre espoir : Deb a rencontré Dev (…sans commentaire), un homme qui ne l’attire pas beaucoup mais qui a une maison énorme en cours de construction. Ça vaut bien quelques sacrifices. D’ailleurs pour dîner, Deb a invité Dev à venir à la maison rencontrer ses filles, dans l’espoir que la relation se pérennise. Ce qui est bien, c’est que ce n’est pas du tout cynique ni vénal. Mais Deb, la morale, elle s’en fout ; tout ce qu’elle veut c’est s’extirper de sa condition médiocre, quoi qu’il en coûte. Même si ça doit faire du mal à autrui.
Avec une mère pareille, il n’est pas vraiment étonnant que Josie et Billie ne soit pas les jeunes femmes les plus équilibrées du monde. Josie, l’aînée, souffre de diverses conditions, notamment la dépression, l’anxiété et un intérêt certain pour les médicaments ; elle traine sa misère partout où elle va mais semble toujours en rajouter par plaisir d’être misérable, comme une espèce de Mercredi Addams de supermarché. Sa petite sœur Billie est tout son contraire : elle est vive, entreprenante… ainsi que prompte à la colère. Elle se montre complètement obsédée par son ex Nicky, dont elle n’a pas compris qu’il était son ex et qu’elle harcèle de textos à longueur de journée. De la même façon qu’elle est d’un naturel violent avec autrui, Billie menace aussi une trentaine de fois par jour de mettre fin à ses jours si elle n’obtient pas ce qu’elle veut (elle n’obtient rien de ce qu’elle veut et est toujours en vie).
Les protagonistes de Such Brave Girls se racontent qu’elles se débattent avec les traumatismes, qu’elles ont des vies odieuses, qu’elles affrontent tout l’univers chaque jour. En réalité, leur vie est terriblement banale. Mais se l’avouer pourrait suggérer qu’elles sont, elles-mêmes, assez banales, et c’est évidemment hors de question. Une partie de l’humour de la série repose donc sur le ridicule dont elles se couvrent, pas tellement vis-à-vis d’autrui mais surtout vis-à-vis de nous, qui sommes dans la confidence, en essayant de donner du sens à des choses qui n’en ont pas vraiment. Mille psychodrames traversent leurs existences, qui sont autant d’excuses de se raconter des histoires sur à quel point elles sont dysfonctionnelles ; si elles n’avaient pas cela, elle n’auraient que l’échec. Qui plus est, ces héroïnes se montrent complètement aveugles à leur propre fumisterie, mais sont conscientes de façon aiguë que les deux autres membres de leur famille ne sont pas à prendre complètement au sérieux (ignorant que nous avons cette opinion des trois membres !). Ces dynamiques jouent un grand rôle dans la façon dont Such Brave Girls évite l’embarras de seconde main tout en permettant de prendre du recul sur les actions des protagonistes.
C’est déjà une approche appréciable (je suis allergique au second-hand embarrassment encore plus qu’à la codéine), mais là où ce premier épisode de Such Brave Girls est brillant, c’est dans les dialogues. Ils fusent à toute vitesse, souvent débités sur un ton pince-sans-rire, et regorgent de répliques se tenant en équilibre instable entre le subtil et l’absurde. S’il fallait déterminer quel est le love language de Deb, Josie et Billie, ce serait probablement la brutalité. On se dit non seulement toujours ce qu’on pense, sans aucun filtre, mais on parle aussi de choses extrêmement violentes comme s’il n’y avait rien de plus normal.

Sauf que Such Brave Girls a les défauts de ses qualités. Tout ce qui peut sembler positif dans ce que je viens de dire, est à double tranchant. L’humour noir limite nihiliste, en contradiction avec la vanité extrême des personnages et leur capacité à tout transformer en tragédie extrême, ça peut être aussi marrant que terriblement déprimant, voire repoussant.
Et sans nul doute, les personnalités de Deb, Josie et Billie sont écrites pour être repoussantes, à dessein. On n’est pas supposée s’identifier à elles (…franchement, inquiétez-vous si c’est le cas). Les héroïnes de Such Brave Girls sont écrites pour qu’on puisse les juger, peut-être même les mépriser. Et très franchement, en l’espace d’un épisode d’une demi-heure, j’avais déjà l’impression de trouver le temps long. Hormis éventuellement le lien entre Josie et Billie, qui, quand elles ne se chamaillent pas, sont plutôt complices (d’ailleurs elles sont jouées par deux actrices qui sont réellement des sœurs !), personne n’a ici de qualité rédemptrice, de bon côté qui permettrait de s’attacher ne serait-ce qu’un peu. Le ridicule consommé de ces personnages nous en empêche, et, bah, je sais pas pour vous, mais moi, regarder une série où tout le monde m’insupporte, je sais pas faire. J’avais beau trouver les mécanismes futés et efficaces, ça ne passait pas. Pour rire, il faut décrisper la mâchoire une fois de temps en temps…
Sans aller jusqu’à parler de torture (je ne suis pas aussi dramatique que les personnage de Such Brave Girls !), en tout cas venir à bout de ce premier épisode m’a demandé un effort. Je sentais bien que ce n’était pas le genre de série pour moi. Et pourtant, elle est bien, cette série. Bien écrite, bien interprétée, vraiment intelligente. Juste, je peux pas.
Ya des séries comme ça, qui refusent qu’on les range dans une boîte bien ordonnée.




























 Toutefois, Pocket ni Bouken wo Tsumekonde est très spécifique dans les souvenirs qu’elle ravive, et prend grand soin de se référer autant que possible à l’univers de Pokémon, en brouillant les frontières entre l’univers du jeu et celui de Madoka (et donc le nôtre). Cela se sent par exemple quand Madoka quitte sa maison et que la scène de son départ se fait, en partie, en vue du dessus. Ou bien en présentant les informations distillées par la narration en voix-off dans des encadrés ressemblants ceux du jeu. Ou, lorsqu’un nouveau personnage est introduit dans la série, on a droit à un écran statistique. Ou encore, des passages pendant lesquels Red (le protagoniste du jeu) circule dans divers décors sont intercalés entre des plans de Madoka marchant dans les rues de Tokyo… Vous voyez le genre. La série a le sens du détail, et fourmille de références (je ne pense même pas les avoir toutes perçues), auxquelles évidemment il faut ajouter l’habillage sonore et l’usage de certaines couleurs. C’est très efficace ! Tout cela, avant même que Madoka n’ait recommencé à jouer au jeu de son enfance, car la nostalgie ne lui est pas réservée.
Toutefois, Pocket ni Bouken wo Tsumekonde est très spécifique dans les souvenirs qu’elle ravive, et prend grand soin de se référer autant que possible à l’univers de Pokémon, en brouillant les frontières entre l’univers du jeu et celui de Madoka (et donc le nôtre). Cela se sent par exemple quand Madoka quitte sa maison et que la scène de son départ se fait, en partie, en vue du dessus. Ou bien en présentant les informations distillées par la narration en voix-off dans des encadrés ressemblants ceux du jeu. Ou, lorsqu’un nouveau personnage est introduit dans la série, on a droit à un écran statistique. Ou encore, des passages pendant lesquels Red (le protagoniste du jeu) circule dans divers décors sont intercalés entre des plans de Madoka marchant dans les rues de Tokyo… Vous voyez le genre. La série a le sens du détail, et fourmille de références (je ne pense même pas les avoir toutes perçues), auxquelles évidemment il faut ajouter l’habillage sonore et l’usage de certaines couleurs. C’est très efficace ! Tout cela, avant même que Madoka n’ait recommencé à jouer au jeu de son enfance, car la nostalgie ne lui est pas réservée.