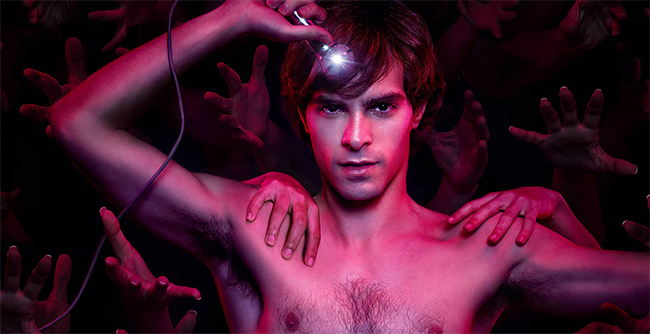Viaplay est probablement l’une de mes plateformes préférées de ces dernières années. La plupart de ses séries originales sont non seulement très convaincantes sur un plan qualitatif, mais également animées d’une volonté d’aller au-delà de la solution de facilité. Pour moi, c’est l’anti-Netflix : la réussite est au rendez-vous à quasiment chaque sortie. Tenter une série de Viaplay au hasard, ce n’est jamais une perte de temps.
Je me dois d’ajouter que Viaplay offre un éventail de séries absolument saisissant lorsqu’il s’agit de parler de personnages féminins complexes. Harmonica, Pørni, Systrabönd, Heder, ou Älska Mig (les tags sont en fin d’article si vous avez loupé ces reviews) offrent des portraits fins et nuancés dont je ne me lasse pas. Et cette consistance ne saurait être accidentelle.
Cette impression se confirmait avec le lancement cet été de Håber du kom godt hjem, une série adolescente dont il va être question dans la review du jour. Et avant d’aller plus loin :
Pour ma défense, j’ai jamais promis qu’on allait se marrer.

Louise et Monica sont la meilleure amie l’une de l’autre ; inséparables, leurs vies se ressemblent en outre beaucoup. Par exemple, chacune a un petit ami stable : Mikkel pour l’une, Peter pour l’autre. Les deux couples sont à un stade où, ma foi, on commence à évoquer la possibilité de rapports sexuels, et pour les deux adolescentes, c’est l’objet à la fois d’une fascination et d’une appréhension. Sont-elles prêtes ? Est-ce le bon moment ? Et… veulent-elles sauter le pas toute seule ?
En-dehors de ça, il y a les rapports avec les parents, la vie au lycée, bref, la routine.
C’est justement pour briser la routine que toutes les quatre décident, un soir, de s’introduire illégalement dans l’enceinte de leur lycée pour une fête improvisée. Avec quelques autres potes, l’idée est simplement d’avoir un lieu au chaud pour être ensemble, boire, mettre un peu de musique, et évidemment être loin du regard inquisiteur des adultes. C’est dangereux mais pas trop, juste ce qu’il faut. Louise, de son côté, a invité secrètement Thais, un camarade de classe ténébreux mais impopulaire. Elle tente de se convaincre qu’elle n’est pas attirée par lui, mais toute la soirée elle n’a d’yeux que pour le jeune homme, et a en revanche du mal à réprimer son mouvement de recul quand Mikkel tente de passer du temps avec elle. Comme elle n’est pas dans son état normal, Monica ne manque pas de remarquer que quelque chose cloche ; mais on parle d’adolescentes et évidemment ça tourne au conflit au lieu de gérer la situation avec finesse. Au bout du compte, les deux amies se disputent ; Louise décide de rentrer chez elle, laissant Monica à la fête.
Elle va se le reprocher amèrement pendant la suite du premier épisode de Håber du kom godt hjem, et vraisemblablement au-delà.
C’est que, la scène d’introduction de la série ne laisse pas vraiment de doute quant au sujet de l’intrigue : Monica a été violée, dans la nuit, sur la pelouse givrée du stade de ce lycée qui quelques heures plus tôt semblait être le parfait refuge. Lorsqu’elle l’apprend, le lendemain, Louise est évidemment effondrée pour son amie, mais aussi rongée par la culpabilité. Si seulement elle n’avait pas laissé son amie derrière…
Mais il y a plus pressant : déterminer qui a violé Monica. C’est que, celle-ci, qui avait perdu connaissance, ne le sait pas elle-même.
Håber du kom godt hjem est l’un de ces teen dramas (et je suis toujours reconnaissante quand ça arrive) qui essayent de s’adresser à une tranche d’âge extrêmement précise, plutôt qu’essayer de ratisser large au risque de proposer une intrigue plate qui parle à tout le monde. Parfois, une série pour ados peut (et doit ?) ne pas plaire aussi aux préados ET aux jeunes adultes. Cela permet à la série de trouver un ton qui sonne comme authentique, qui maintienne une ambiance sincère, qui ne se force pas ni à rendre les choses plus digérables ni à les rendre plus dures. L’équilibre trouvé par Håber du kom godt hjem, qui évoque celui d’autres séries adolescentes scandinaves (je n’ai pas regardé tout SKAM, mais c’est difficile de ne pas discerner la parenté), fonctionne bien, et c’est d’autant plus nécessaire vu le numéro d’équilibriste requis par le sujet de la série lui-même.
Dans l’ensemble, ce premier épisode expose de façon intelligente à la fois les circonstances, et l’état d’esprit de son héroïne. C’est d’ailleurs un choix auquel je ne suis pas habituée, de voir ce genre d’intrigue du point de vue non pas de la victime, ni de la police (qui fait ici une très brève apparition, au moins pour le moment), ni même du criminel, mais bien du point de vue de quelqu’un qui, concrètement, n’a pas grand’chose en jeu dans ce qui se trame. Je ne sais pas si ça compte comme un women in refrigerators ? La perspective, après tout, reste féminine.
Une fois passée la simple mise en place des faits (Louise apprend ce qui est arrivé à Monica, on a droit à un long flashback d’environ une moitié d’épisode sur le déroulement de la fête), ce premier épisode de Håber du kom godt hjem a en outre le bon sens de commencer déjà à discuter de l’après. Déjà se dessinent quelques propos que, je pense, la série va ensuite étudier au fil de son intrigue : le refus de Monica de porter plainte formellement (elle a juste passé les examens médicaux), la réaction des parents (la mère de Monica étant prompte à adresser des reproches), le choc des potes au lycée (dont Peter, Mikkel et Thais, dont les réactions sont guettées avec intérêt d’emblée, leur statut de petit-ami parfait en dépend)… On commence à s’interroger sur tout ce qui entoure le viol, soit les ramifications légales et sociales. En cela Håber du kom godt hjem m’a un peu rappelé la série thaï The Judgement, mais comme je ne l’ai jamais finie, cette foutue série (c’est de plus en plus courant que j’aie du mal à finir les séries dont le sujet m’attire le plus, ces dernières années…), je ne saurais le garantir complètement.
Et naturellement la question principale qui se pose est : qui ?
Qui a osé faire l’impensable ? Qui a fait entrer dans la vie de Monica (et par ricochets, de Louise) cette nouvelle réalité qu’on arrivait jusque là à puissamment ignorer ? Désormais tout le monde est triste, mais aussi inquiet. Tant qu’on ne sait pas qui, on ne sait pas non plus quand…
Håber du kom godt hjem fait du bon travail, dans cet épisode introductif, pour mettre en place tous les mécanismes typiques de ces situations : les devoirs ont été faits. C’est accompli avec d’autant plus de brio qu’il s’agit d’un épisode d’une demi-heure à peine, ce qui n’est pas un petit exploit. Pour le reste, j’ai l’impression que la série met en place une enquête informelle (puisque la police n’a pas assez d’éléments en sa possession à l’heure actuelle pour déterminer grand’chose) par Louise, et en même temps, bien-sûr, une observation des retombées sur cet ensemble de personnages de ce qui est à la fois un drame personnel, et un problème collectif.
C’est pour le moment plutôt bien tourné… quand bien même il n’y a, pour le moment, rien de foncièrement nouveau pour qui s’est déjà intéressée au sujet.

























 Nodoka représente non seulement l’envie d’aller de l’avant, de résoudre les problèmes, de tout donner pour aller vers le mieux ; mais elle incarne aussi une furieuse rage contre tous ceux (…masculin volontaire) qui ont conduit à la situation présente. Sa colère se déchaîne crescendo, des larmes de dégoût roulant sur son menton, le visage déformé par la colère. Rien dans la scène n’est fait pour l’atténuer, la tourner à l’humoristique, ou la dépeindre comme excessive. Non, FIRST PENGUIN! assume que cette colère dure 3 minutes ininterrompues pendant lesquelles les hommes autour de Nodoka n’ont qu’à se taire et subir la fureur de la jeune femme, parce qu’ils la méritent. Et ça, c’est assez nouveau, et un peu désarmant.
Nodoka représente non seulement l’envie d’aller de l’avant, de résoudre les problèmes, de tout donner pour aller vers le mieux ; mais elle incarne aussi une furieuse rage contre tous ceux (…masculin volontaire) qui ont conduit à la situation présente. Sa colère se déchaîne crescendo, des larmes de dégoût roulant sur son menton, le visage déformé par la colère. Rien dans la scène n’est fait pour l’atténuer, la tourner à l’humoristique, ou la dépeindre comme excessive. Non, FIRST PENGUIN! assume que cette colère dure 3 minutes ininterrompues pendant lesquelles les hommes autour de Nodoka n’ont qu’à se taire et subir la fureur de la jeune femme, parce qu’ils la méritent. Et ça, c’est assez nouveau, et un peu désarmant.