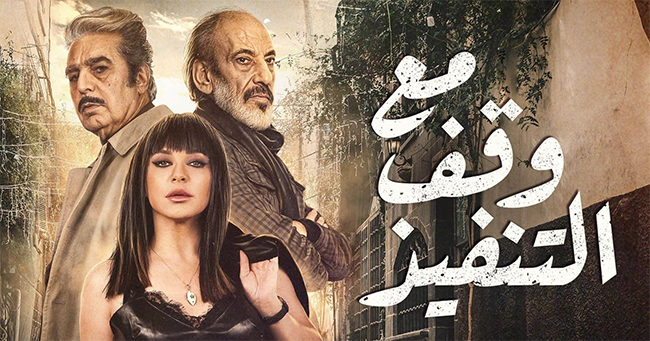Je ne dirai rien de nouveau sur Julia que la critique ne vous a déjà dit ; seulement voilà, je voulais le dire aussi.
De mon point de vue elles sont rares, de nos jours, les séries américaines qui donnent l’impression d’avoir autant de cœur et de sincérité (il y en a, et heureusement ; d’ailleurs on parlait de Our Flag Means Death il y a quelques semaines à peine !). Si souvent les projets de fiction, plus encore lorsqu’ils sont conçus pour les diverses plateformes de SVOD, semblent préférer rivaliser de grandiose… et surtout de budget. Même si Julia n’a pas été tournée avec des bouts de chandelle, elle a néanmoins placé son attention dans autre chose que dans la volonté d’en mettre plein les yeux, et c’est ce qui m’a charmée.
Cela, et la nourriture, naturellement ; quiconque me lit ne serait-ce qu’un mois sur deux aura remarqué que les séries sur les bons petits plats m’attirent spontanément.

Julia Child est une icône de la télévision américaine, où à partir de 1962, elle a commencé à apparaître ; elle n’a pas inventé le genre de l’émission culinaire, en revanche elle a fait partie des pionnières, et l’a popularisé comme jamais avant elle. Naturellement, si vous avez vu Julie & Julia, c’est un peu plus facile de cerner à qui on a affaire dans Julia, à la différence que le film ne s’intéressait pas à l’émission télévisée qui l’a rendue célèbre dans les foyers américains, mais plutôt à la création de son premier livre de cuisine.
La série suit avec minutie le lancement de l’émission, et les étapes nécessaires autant à sa conception théorique qu’à sa création matérielle.
Mais, à travers elle, Julia s’intéresse aux débuts (ou presque, c’est quand même déjà les années 60) de la télévision. En tant qu’amatrice d’histoire télévisuelle, vous connaissez probablement ma fascination pour ce genre de choses, d’autant qu’en définitive, assez peu de séries font de leur sujet les origines de la télévision, ce qui semble un peu étrange parce que du côté du cinéma, les options ne manquent pas. En tout cas il y a dans Julia une curiosité évidente (et communicative !) pour les innovations de la télévision lorsqu’elle n’était encore qu’un media jeune.
Je ne sais pas si la télévision innove encore ; je suppose que sur de nombreux tournages, une idée un peu hors du commun peut parfois sauver un épisode, secrètement, là où personne ne le remarque. Mais des innovations comme au début de la télévision, quand des genres télévisuels entiers n’étaient pas encore tout-à-fait des genres, que des stratagèmes restaient à imaginer pour filmer non seulement bien, mais vite et sans montage (contraintes techniques obligent), des épisodes hebdomadaires… non, ça n’existe plus. On ne fait plus vraiment de la télévision comme ça. On ne fait plus grand’chose comme ça, tant la maîtrise des arts audiovisuels a atteint un autre degré ; et je l’aime follement, cet esprit de la télévision de pionnier, où tout ou presque était à créer, à la fois sous contrainte et sur mesure.
En parallèle, Julia interroge la célébrité de sa protagoniste, qui est elle aussi une expérience relativement nouvelle. Il n’y avait en effet pas autant de célébrités de télévision, d’autant qu’avec son émission culinaire, Julia Child était destinée essentiellement à un public féminin et domestique, ce que la série interroge en partie. Cette exploration intime de la célébrité, du choc qu’elle induit dans le quotidien de quelqu’un qui n’y a jamais vraiment aspiré, à une époque où une star du show business est avant tout une personnalité du monde du cinéma, c’est aussi ce que Julia suit. L’opinion de Julia Child sur sa propre célébrité évolue, découvrant au détour de la première saison de son émission culinaire différents aspects, qui la touchent différemment. Fort heureusement, cette célébrité se produit à l’âge de la cinquantaine, quand l’héroïne doit s’adapter à ce phénomène plutôt que se construire autour de lui (beaucoup de fictions sur la célébrité s’intéressent à des protagonistes bien plus jeunes !).
On pourrait penser dans tout cela que Julia est une série où les conflits ne manquent pas : de la création d’une émission à la gestion des réactions de son entourage face aux changements induits par celle-ci, Julia aurait pu faire le choix de dramatiser pas mal de choses. Sauf que ce n’est pas le cas ! Il s’agit même d’une série avec aucun véritable conflit, et surtout rien qui ne puisse se régler en 45 minutes.
Avec un ton léger (mais pas inconséquent !), Julia ne veut pas nous laisser sur le bord de notre siège à nous demander si la popularité soudaine de Julia Child va ruiner son mariage, ou endommager une amitié de longue date, ou perdre sa chemise dans l’investissement coûteux qu’est une émission culinaire. Non seulement parce qu’une simple consultation de Wikipedia peut rapidement nous détromper, mais surtout parce que son but n’est pas de susciter d’excitation superficielle. Non, ce qu’elle veut, c’est nous intéresser au cheminement interne de ses protagonistes, et nous faire apprécier la maturité de leurs réactions. Malgré son ton de dramédie bondissante, Julia prend au sérieux son aspect dramatique plutôt que de verser dans le soapesque superficiel.
C’est de la bonne vieille télévision grand public, fiable, et intelligente ; comme on en fait de moins en moins souvent.

Alors que reste-t-il à dire quand les personnages ne s’affrontent quasiment pas (ou jamais durablement) ? Ma foi, tellement de choses !
Pour commencer, Julia Child est un peu l’anti-Mrs. Maisel : la série insiste, autant que les hommes qu’elle croise, sur le fait qu’elle ne correspond pas à l’idée que beaucoup se font de la femme idéale. Malgré son talent dans les arts culinaires domestiques, Julia n’est pas une femme qui ressemble à la ménagère que l’on trouve d’ordinaire sur les écrans de télévision : c’est une femme grande, très grande (« trop » grande), à la silhouette imposante au lieu de frêle, qui s’exprime avec un accent étrange et une voix haut perchée, et qui s’exprime avec aplomb, qui plus est. Tout le monde semble conscient de cet « inconvénient » (sauf peut-être son époux Paul, ou en tout cas il s’en fout royalement s’il a remarqué), et si ce n’est pas la première fois qu’on lui fait des remarques (même son père lui en fait !), entrer dans le monde de l’image vient effectivement renforcer les insécurités de Julia.
Et encore une fois, ce genre d’interrogations sur l’apparence et les critères de beauté féminins, c’est généralement une quête intérieure que l’on laisse soit à des personnages plus jeunes (typiquement, des adolescentes apprenant à s’y conformer), soit à des protagonistes âgées qui sont en train de perdre leur beauté de jadis à cause de la ménopause et/ou le vieillissement. Mais Julia Child n’a jamais correspondu à ces impératifs, elle ne perd pas vraiment quoi que ce soit, et son cheminement intérieur apparaît comme inédit ; son traitement de la ménopause, évoquée pendant une petite partie de l’intrigue, est d’ailleurs assez rafraîchissante. Dans le même temps, les réactions (masculines) autour de son apparence sont balayées régulièrement, Julia étant assez attentive à ce que les hommes ne soient jamais pris au sérieux bien longtemps dans leurs idées arrêtées sur ce à quoi les femmes, et à travers elles le monde, devraient ressembler.
Mais d’ailleurs parlons-en, de représentations, parce qu’il est rare de voir les années 60 ainsi !
C’est que, Julia prend un personnage qui est un modèle de domesticité et qui excelle dans les tâches domestiques, ainsi qu’elle s’illustre par sa vie domestique avec Paul. Même si jamais Julia Child n’a été l’image d’Epinal de la femme au foyer (et que la création de son émission est tout le contraire d’une vie domestique), l’héroïne correspond tout de même à de nombreux de ses critères, et la série parle de la façon dont Julia incarne les attentes de son époque. Et de la façon dont elles sont en train de changer, un peu à son insu : j’ai trouvé intelligent d’incorporer la remise en cause et la remise en question féministe sur la fin de la saison, mais en y apportant (certes par la voix de Paul ; j’aurais aimé que ce soit Julia qui vienne à cette conclusion) une attitude relativement équilibrée : le féminisme (d’une vague en outre nouvelle pour Julia, née en 1912) n’a peut-être pas tort sur la façon dont l’existence de Julia Child en tant que personne publique accomplit dans l’imaginaire collectif… mais ça ne veut pas dire qu’il est totalement incompatible avec la mission que The French Chef s’est donnée. C’est une critique qui est adressée à Julia, la célébrité culinaire, mais que la série Julia elle-même reprend à son compte en acceptant qu’elle n’a pas la solution parfaite (comme tant de choses quand elle parle d’elle-même au travers de ses intrigues, ce qui d’ailleurs lui arrive fréquemment). Avec en prime un propos sur le divertissement qui revendique un droit à une certaine futilité : « We know what matters. And the wonderful thing about this show is that it doesn’t. Not like that. It won’t save or ruin the world« . On devrait avoir le droit d’être passionnée par quelque chose d’un peu inutile au monde. Julia se sent investie d’une mission de vulgarisation de la gastronomie française, à la fois parce ce que c’est ce qu’elle aime, parce que c’est aussi naturel pour elle que de respirer, et parce qu’elle croit que ça peut apporter culturellement à ses spectatrices. Mais elle ne se fourvoie pas quant à la signification de ce qu’elle fait.
Dans Julia, ces paradoxes peuvent exister ; ils sont pris au sérieux mais jamais au point de bouleverser l’objectif de la série ou son ton.
Il est également rare de trouver dans des fictions sur cette époque tant de femmes qui parlent entre elles du monde dans lequel elles vivent, et des femmes si différentes qui plus est : Julia, bien-sûr ; mais aussi sa meilleure amie Avis, une veuve, Judith, son éditrice, Alice, la productrice associée au sein de la station publique WGBH… D’ailleurs Julia est une nouvelle série qui vient s’ajouter à mon genre télévisuel préféré : « puzzled men get mad at how much they don’t understand the women they need the most« . C’est un peu long, mais c’est bon. Je veux d’ailleurs un tatouage de la réplique d’Avis sur la popularité têtue de son amie (« I don’t know, I just think about how many more hours in the day we’d have if we didn’t have to spend so much of it apologizing to men for your success« ).
Alice, bien que porteuse d’un rôle secondaire, a droit à non pas une seule comme on aurait pu le penser, mais plusieurs intrigues en toile de fond : ses difficultés à exister à la station, où elle est la seule femme noire ; son rapport compliqué avec sa mère, son amitié avec Julia et Avis, son célibat. Elle a en outre une personnalité que la série prend le temps de détailler : un peu insécure, mais aussi ambitieuse et passionnée. Alice est, voyez-vous, une téléphage de la première heure, l’une de nos ancêtres ; c’est avec tellement de fierté qu’on la voit parler de ses séries préférées avec une étincelle si familière…! Elle est passionnée de télévision autant que moi, et j’ai trouvé tellement facile de me lier à elle ! Dans une série où Julia Child, charismatique et complexe comme elle est, occupe tant de place, ça relevait un peu du miracle. Les diverses intrigues d’Alice, bien qu’occupant peu de temps d’antenne, ne sont jamais traitées comme accessoires, et à l’occasion s’entremêlent pour nous révéler les contradictions d’une femme qui tente d’exister dans un milieu et une époque qui y sont peu favorables.
Dans une moindre mesure, Julia s’intéresse aussi à des protagonistes juives. C’est le cas de Judith, pour laquelle il s’agit de quelque chose d’assez invisible dans ses interactions avec les Child, mais pour qui c’est en réalité assez fondateur, notamment dans sa relation à sa supérieure hiérarchique, l’incroyable Blanche Knopf. C’est, disons, tranquillement important : la série n’en fait pas une revendication, mais raconte quand même, l’air de rien, la signification de cette intersection d’identités parfois difficiles à concilier pour Judith.
L’épisode de San Francisco est glorieux sur des représentations différentes. Julia y retrouve un vieil ami, James Beard, pour lequel la série a une affection brève mais réelle. Il l’emmène dans un cabaret de drag où, bien que surprise, Julia découvre qu’elle a parfaitement sa place. L’épisode à San Francisco est aussi une occasion de rare de voir des personnages asiatiques dans une série historique ! Combien de fois y avez-vous vu des personnages asiatiques ? Même des figurants ou petits rôles ? Souvent à la télévision US, parce qu’il est naturel de penser à la lutte pour les droits civiques, on dirait que la communauté asiatique n’a pas existé (c’est également vrai de la communauté hispanique, d’ailleurs). Or, ça faisait plaisir de voir des (hommes, en l’occurrence) asiatiques, dont un chef prestigieux par exemple.
Comme photographie de celles et ceux qui d’ordinaire figurent à peine en arrière-plan de la représentation qu’on a des années 60, Julia se pose là.
Bon, à quel moment on parle de bouffe, dans tout cela ? Eh bien, assez régulièrement, en fait.
D’abord parce que chaque épisode porte le nom de la recette que Julia porte à la télévision (le premier, « Omelette », m’évoquant en outre le cultissime « Pielette« ). Ces recettes successives ne sont pas accessoires : à de maintes reprises, nous allons suivre la façon dont elles sont déconstruites pour pouvoir être montrées. Julia Child, ça ne fait aucun doute, connaît son affaire lorsqu’il s’agit de cuisiner, en particulier la cuisine française dont elle est férue et pour laquelle elle est connue ; mais elle doit aussi apprendre à faire entrer son art culinaire dans le format très rigoureux d’une émission de télévision d’une demi-heure.
Mais ça ne se borne pas à cela : la série dépeint la fascination de l’Amérique pour cette femme incroyable et ses plats exquis ; et en même temps, elle nous montre, via le quotidien de Julia Child, encore plus de plats exquis, concoctés pour son mari, ses amies, ou parfois simplement dégustées au restaurant. La camera s’arrête quelques instants, dans un épisode, sur des mets délicieux… parce que notre fascination pour la cuisine n’a jamais tari. Aujourd’hui, outre les émissions culinaires à la télévision, il y a toute une constellation médiatique autour de la nourriture, qu’on parle des émissions de télé réalité avec Gordon Ramsay, des chaînes Youtube Bon Appétit ou Tasty, ou des millions de recettes hallucinantes inventées (parfois juste pour choquer) sur des plateformes comme TikTok… La planète entière est fascinée par la nourriture sous diverses formes, et je ne suis moi-même pas en reste, qui consulte régulièrement des videos de type « street food« , apprends sur la science culinaire avec Ann Reardon ou Adam Ragusea, et suis les voyages de gens comme Mike Chen.
Julia, indirectement, raconte les origines de cette fascination, tout en la nourrissant.

Pourtant, ce n’est même pas ce que je retiendrai le plus de Julia. Le ravissement provoqué par cette première saison se loge dans un aspect que je n’avais pas vu venir.
La relation entre Julia et Paul m’a donné des papillons dans le ventre. J’ai rarement vu une relation amoureuse à la télévision qui me donne autant envie de m’écrier que c’est ça que je veux dans la vie. La vie de couple de Julia et Paul est touchante, vibrante, solide. Elle est bâtie sur une adoration mutuelle, mais aussi une maturité rarement palpable dans les couples de télévision. Elle n’est jamais durablement en danger, parce que chacune est raisonnable et sait ce qu’il y a à perdre. Cela fait chaud au cœur.
Ce que j’ai aimé va même au-delà. Ce n’est pas que pour cela que j’ai été fascinée par Julia. Pas seulement parce que c’est l’un des rares mariages de fiction qui semble réellement avoir ses propres mécanismes internes. Pas seulement parce que cette relation permet de voir, fait encore rare à la télévision, des personnes (et notamment une femme) de plus de 50 ans parler de sexe et le pratiquer. Mais aussi parce que je crois que depuis quelques années, et je soupçonne que ça n’aille qu’en empirant, je me régale des représentations de personnages plus âgés que moi, et de voir ce qui les anime. De par mon histoire personnelle, c’était toujours quelque chose d’important à mes yeux que d’avoir des représentations possibles de l’avenir (quand j’étais ado et que je découvrais Gilmore Girls, à l’époque, je préférais Lorelei à Rory), mais ça l’est de plus en plus que de me demander à quoi vont ressembler les années qui viennent, ou, plutôt, à quoi elles peuvent ressembler. Les suggestions pour passer sa vingtaine ou sa trentaine ne manquent pas dans les séries. Mais la suite ? Je prends toutes les suggestions que la fiction voudra bien me faire.
Et Julia Child apparaît ici comme le genre de personne que je m’imagine bien devenir, avec l’âge : quelqu’un d’obstinément passionné. J’ai réalisé que j’avais besoin de ce modèle et c’est, peut-être plus encore que la nourriture (ce qui n’est pas peu dire), ce qui m’a fait rester devant mon écran pendant cette première saison. D’autant que c’est si rare de voir une femme sans enfant ! Si peu de séries savent me dire à quoi pourrait potentiellement ressembler ma vie, moi qui n’en ai pas non plus ; les femmes d’un certain âge, comme on les appelle, à la télévision, ce sont presque systématiquement des mères et des grands-mères, et rarement des femmes avec des projets intellectuels et/ou créatifs. Imaginez ça, une femme ménopausée qui au lieu de servir de miroir (ou pire, de repoussoir) dans les intrigues de personnages plus jeunes, a ses propres plans pour l’avenir ? De nouvelles choses pour l’exciter et l’occuper ! C’est ça que je veux. Même si en ce qui me concerne, c’est plutôt sur la télévision qu’à la télévision que ça peut se passer. Ou plutôt sur la trajectoire d’Avis, réalistiquement. Mais au moins, il y a un pluriel d’options. C’est plus que ce que beaucoup de séries peuvent donner.

…Devant Julia, je ne voyais pas défiler le temps. La première saison (puisque nous savons d’ores et déjà qu’une autre est en route) compte 8 épisodes, et pourtant elle est passée plus vite que d’autres séries pourtant plus courtes que j’ai pu regarder ces derniers mois, qui à l’occasion me provoquaient de l’ennui et même de la souffrance.
J’écris plusieurs dizaines d’articles par an maintenant (déjà 84 publications en 2022, celle-ci incluse !), grâce à votre formidable soutien sur uTip, qui en détermine le volume. Si je choisis toujours mes sujets (c’est une des conditions dont j’ai découvert qu’elles étaient nécessaires pour éviter le burnout), certains me pèsent plus que d’autres. Parfois je voudrais voleter vers un nouveau pilote plutôt que finir les deux derniers épisodes d’une saison calamiteuse, mais dont je suis si prête de voir le bout pour une review. Parfois au contraire, je me suis imposé de parler d’un pilote alors que je veux juste poursuivre mon marathon The Good Wife, que je ne parviens toujours pas à conclure alors que je l’ai entamé au début de l’été dernier. Je vis globalement bien ces négociations avec moi-même, entendons-nous bien, mais c’est tout de même notable quand une série est non seulement le parfait visionnage pour moi, mais aussi la parfaite inspiration pour écrire, et que le timing s’insère dans mon planning au sein de ces colonnes.
Comme je le dis si souvent, écrire ici n’accomplira jamais quoi que ce soit d’important, mais j’aime bien que ce soit aussi bien fait que possible. Alors, quand en plus ça m’apporte autant de plaisir qu’avec Julia, je trouve qu’il me faut le souligner aussi. Ne serait-ce que parce que, si vous ne l’avez pas encore fait, cela pourrait vous décider à vous y mettre à votre tour.
« Television is like a window, and the best of it opens to the most remarkable places ; that food itself is like a passport ; that the culture, the history, is locked inside the flavors and the aromas that are unique to each cuisine. I don’t cook for chefs. I cook for other cooks. For ordinary people (mostly women, housewives) and I say to them : you have endless horizons, far beyond the walls of your house, your block, your town. The whole world is your oyster… quite literally. And if you take the time it requires to make a great meal, then you may feel the same sense of accomplishment, of mastery, that I feel. And because I’m not a chef… I’m not always a very good cook… because I fail, they tend to believe it. And so we go on this journey together. »
Difficile de ne pas être sentimentale quand une série touche avec grâce à tout ce qui me fait vibrer. Merci de m’avoir lue à son sujet, quand bien même je n’ai rien dit de révolutionnaire ; merci de faire, si souvent, ce chemin avec moi.


Lire la suite »





























 Dans son interrogation des normes, Annarasumanara accomplit parfaitement ce qui est attendu d’une série sur l’adolescence. Son regard sur l’âge adulte est intransigeant, et insiste à plusieurs reprises sur un conflit de générations qui va bien au-delà d’une simple rébellion. Dans un monde où les adultes font défaut, les enfants n’ont pas d’autre choix que de grandir trop vite. Pas étonnant que dans cet univers, le magicien Ri Eul apparaisse, paradoxalement, comme le seul adulte de confiance, puisque c’est le seul à cultiver leur émerveillement d’enfant.
Dans son interrogation des normes, Annarasumanara accomplit parfaitement ce qui est attendu d’une série sur l’adolescence. Son regard sur l’âge adulte est intransigeant, et insiste à plusieurs reprises sur un conflit de générations qui va bien au-delà d’une simple rébellion. Dans un monde où les adultes font défaut, les enfants n’ont pas d’autre choix que de grandir trop vite. Pas étonnant que dans cet univers, le magicien Ri Eul apparaisse, paradoxalement, comme le seul adulte de confiance, puisque c’est le seul à cultiver leur émerveillement d’enfant.