
Quinze années, à l’échelle d’une vie, ce n’est pas beaucoup (ou du moins est-ce à espérer). Sur internet ? C’est comme effleurer l’infini.
En janvier 2007, je commence à préparer les premiers articles de ladytelephagy, parce que je ne veux pas ouvrir à vide. Je veux alors tout simplement parler de ce que j’aime et de ce que je regarde au quotidien (…ce n’est pas toujours la même chose !), et y faire ce que je ne fais pas ailleurs, puisque j’écris déjà des articles plus factuels, et alimente la base de données de (feu) SeriesLive.com, où j’officie depuis 2003 (je ne quitterai sa rédaction qu’en 2012 après maintes initiatives, épisodes de podcast et aventures inédites). Je le vois alors vraiment comme un blog, mes écrits sérieux et réfléchis étant ailleurs.
Et donc, ça fait 15 ans aujourd’hui.
En l’espace de 15 années, évidemment, pas mal de choses ont changé.
Je lance moins de coups de gueule. J’expérimente moins sur la forme et plus sur le fond. Je privilégie la curiosité plutôt que de partager ce qui m’est connu et/ou confortable. Je ne cherche plus à parler à tout crin de ce qui fait l’actualité dont tout le monde parle. Je n’organise plus de petits jeux idiots où on gagne des cookies à la myrtille. J’ai arrêté les listes de mauvaise foi sur ce que je n’aime pas dans une série que de toute façon je n’aime pas. Je me concentre sur les reviews pures plutôt que sur les impressions générales. Et je voyage. Je voyage tellement…
Certains de ces changements se sont faits un peu à mon insu ; pour d’autres, je suis ravie que mon travail ait évolué, parce que j’y ai consacré suffisamment de temps et d’énergie pour en arriver là. Ce n’est franchement plus un blog, aujourd’hui (d’ailleurs je n’utilise plus ce terme pour en parler). C’est « ce que je fais ».
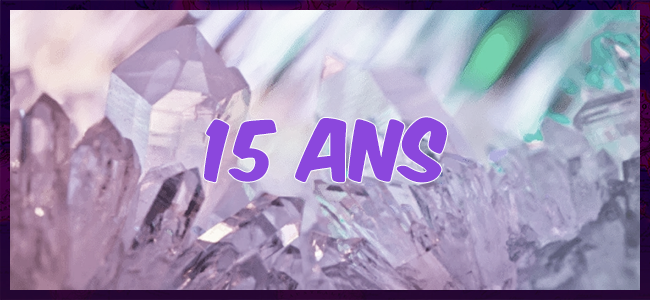
Si je voulais aujourd’hui consacrer quelques lignes à cet anniversaire, qui sans doute n’émeut que moi, c’est que… ce que je ne savais pas, c’est à quel point écrire dans ces colonnes (d’abord sur Canalblog puis sur mon propre Dotcom) me changerait, moi. Quand on écrit régulièrement sur les séries, tout naturellement cela influe sur notre consommation. Et ça, personne ne vous en prévient.
Au départ, on écrit parce qu’on a envie d’écrire. Il y a tant d’espace à remplir sur un blog tout neuf ! Et puis on s’interroge sur la régularité (à une époque je m’étais fixé « un article chaque vendredi. minimum. », et globalement j’ai essayé de m’y tenir autant que possible même après avoir arrêté d’utiliser ce slogan). Mais qui dit régularité, dit : sujet. Et il fallait donc à un moment ou à un autre s’interroger sur les sujets à propos desquels j’allais écrire. Comment écrit-on sur la télévision ? En réalité de mille façons, mais il me fallait trouver la mienne.
Tout était à inventer et il faut croire qu’avec le temps j’ai inventé le petit recoin d’internet où je peux parler très exactement de ce que je veux sans plus me soucier de ce dont ça va avoir l’air. J’imagine que c’est une belle métaphore sur le fait de prendre de l’âge, aussi. Accepter que je ne gagnerai jamais aucun concours de popularité, arrêter totalement de consulter les statistiques de fréquentation (seuls les chiffres, désespérément en berne, des commentaires, me touchent encore), cesser de me sentir en compétition avec qui que ce soit, a beaucoup aidé ; au juste je ne sais plus pourquoi je me mettais la rate au court-bouillon avec ces préoccupations-là.
Parallèlement, pour ne pas dire mécaniquement, ces changements dans ma propre attitude se sont aussi accompagnés de changements dans ma consommation de séries. J’ai cherché de moins en moins à regarder ce que tout le monde regardait, à me préoccuper de ce qui sortait et quand et si j’étais dans les temps ou si j’avais accumulé du « retard« , à vérifier si je voyais les séries qu’il FALLAIT (pourquoi ?) voir… Du coup je suis aussi devenue moins prescriptive. Gagnante-gagnante.
Tout cela ne s’est pas produit du jour au lendemain. Derrière la publication d’une review, il y a tout un processus conscient dont en fait on discute assez rarement, même entre nous. Quels sont les choix que l’on fait, chaque semaine, surtout quand il y a tant à voir et donc tant à reviewer ?
Il était possible, certes, de publier des reviews « par épisode » (ça se faisait beaucoup plus que maintenant, même si plusieurs médias spécialisés entretiennent encore un peu la tradition… mais à une ère post-binge watching, allez savoir pour combien de temps encore), sauf que ça n’a jamais été mon truc. Alors j’ai commencé à regarder encore plus de pilotes. C’est un exercice télévisuel qui a toujours eu ma préférence : j’aime les défis narratifs qu’il se fixe autant que l’excitation d’entrer dans un nouvel univers. Le pilote, c’est rarement le meilleur épisode d’une série (…cette concession m’arrache la gueule), mais c’est souvent le plus fascinant par ses tentatives, ses intentions, son potentiel. Or, les potentiels me font rêver !
Lorsqu’on se demande sur quoi on va écrire cette semaine, le pilote est en plus, à mon sens, le grand facteur d’égalité téléphagique : tout le monde peut venir à une review de pilote les mains dans les poches. On a toutes le même bagage sur une série donnée quand elle commence (hors les quelques olibrius qui regardent les trailers, peut-être). Même si les références que ce pilote évoque peuvent être plus inégalitaires, même si l’inscription d’une série nouvelle dans l’Histoire télévisuelle peut avoir un impact plus ou moins palpable sur sa compréhension, même si l’industrie locale qui a enfanté d’une série venue de l’autre bout du monde est inconnue… quand commence son premier épisode, on en est toutes au même point. Du coup, je vois ça comme étant mon rôle que d’expliquer ces autres facteurs autant que je le peux. Prendre conscience de cela (à force d’écrire, certainement pas dés le premier jour) a radicalement changé mon approche des reviews. Alors, plus j’écrivais sur les pilotes, plus je voyais de pilotes, forcément. Plusieurs centaines par an. Ce qui forcément faisait boule de neige.
Il est d’autant plus vrai que l’écrit influence la consommation, maintenant que le nombre de mes publications est dépendant du montant des contributions le mois précédent ! Je ne peux plus écrire quand ça me chante sur ce qui m’obsède à un moment donné, et ça a plein d’avantages (et certes aussi quelques inconvénients). Et c’est vrai pour d’autres aspects que les pilotes, bien-sûr.
…Je me rappelle encore demander la permission, presque honteuse, à mes lectrices d’alors (et pour certaines, d’aujourd’hui), de parler d’autre chose que de séries américaines. Je regardais des séries japonaises depuis quelques années pourtant, mais cela semblait si… indécent. J’avais totalement souscrit à l’idée qu’une vraie série, une bonne série, une série, quoi ! c’était une série étasunienne. Relire mon exposé gêné de mon processus de pensée aujourd’hui me fait rire, évidemment. Mais c’est aussi la preuve précieuse des barrières qu’on peut parfois se mettre par pur peer pressure, et il est vrai qu’à l’époque, les blogs sur les séries américaines et les blogs sur les séries asiatiques ne se mélangeaient absolument pas. Et il n’y avait pas grand’chose entre les deux, non plus.
Aujourd’hui, la contrainte géographique est très différente… et ses conséquences le sont tout autant. Parce qu’à présent, je m’efforce de ne plus parler du même pays pendant deux reviews de suite, je regarde de plus en plus de séries venues d’horizons différents : « ah bah non, je peux pas parler d’une 712e série japonaise ce mois-ci, j’en ai déjà reviewé une cette semaine… du coup je vais mettre ce visionnage en pause pour me concentrer sur cette série sénégalaise ». C’est dommage pour cette série japonaise qui me faisait tellement envie ; mais une fois ma review de série sénégalaise publiée, ça ira mieux et je pourrai finir cette série dont je sais que je ne vous parlerai jamais, ou alors au détour d’un paragraphe, en passant.
Au final, pas de regret : je gagne en variété de mon côté aussi. C’est un sacré cercle vertueux. Et après tout, je me suis fixé ces règles personnelles, alors je peux les abolir à n’importe quel moment. C’est juste que je sais très bien que les suivre m’ouvre beaucoup plus d’horizons !
Il y en avait beaucoup, des blogs de séries, quand j’ai démarré, et je me demandais si j’allais trouver ma place parmi eux sans y être purement redondante ; ma blogroll était interminable. Aujourd’hui hélas, beaucoup de ces lieux de partage et/ou de curiosité ont fermé (au point que j’ai fini par faire une croix sur l’idée d’entretenir des liens dans mon pied de page sur le Dotcom). J’ai l’impression d’être une survivante et je ne sais pas à quoi je le dois, ni même si je devrais m’en vanter… j’essaie de ne pas trop penser à ce que cela dit de moi d’être toujours là, 15 ans après, quand tant d’autres ont évolué vers de nouveaux objectifs dans la vie.
15 ans, c’est 6489 articles (dommage pour le chiffre rond, qu’on atteindra certes bientôt) sur 8202 séries venues de 122 pays au monde. Ce sont des reviews de pilotes, de saisons, des articles de fond, des fun facts quotidiens pendant 5 de ces années, quelques interviews, même. Ce sont 15 années pendant lesquelles certaines portes se sont temporairement ouvertes, quand j’ai fait partie du jury pour une édition de SeriesMania par exemple, ou quand j’ai travaillé comme consultante pour un producteur TV français. L’air de rien ça a aussi été 15 années de doutes. Sur l’intérêt de ce que je fais, la façon dont je le fais, et la raison pour laquelle je le fais, parfois, aussi. Ce Dotcom est devenu une part essentielle de ma vie, entre les articles que je dois délivrer en temps et en heure pour honorer mes engagements auprès des contributrices sur uTip, l’impact sur ma propre consommation pour le meilleur et pour l’un peu moins meilleur… ou les fun facts que je devais impérativement publier à 20h précises quoi qu’il arrive. Elle me manque et ne me manque pas, cette époque !
Si je suis honnête, au bout de 15 années, il n’est pas exagéré de dire que ces milliers d’articles, ce sera probablement l’oeuvre de ma vie. C’est pas grand’chose comme contribution à l’humanité, mais j’aurai vraiment tout donné.
Ce que je sais, c’est que je ne serais pas là après 15 ans sans la poignée de lectrices assidues qui, pour une raison qui souvent m’échappe, tiennent bon. Qui m’encouragent quand j’ai l’impression que ce que je fais est dérisoire (et objectivement ça l’est, je ne vais jamais guérir le cancer). Me lisent quand bien même elles ne connaissent pas les séries dont je parle, ne les verront parfois jamais, mais m’encouragent à poursuivre quand même. Je ne comprends toujours pas pourquoi, mais je suis reconnaissante pour cette confiance qu’elles me portent. Bien plus que je ne suis reconnaissante pour celles qui clament haut et fort que ce que je fais est si formidable, et ne me lisent jamais. Et croyez-moi, je sais qui est qui.
J’ai passé une bonne partie des 15 années écoulées à me demander à quel moment tout ça s’arrête. A un moment je vais « grandir » et laisser tout ça derrière moi, non ? Tant d’autres l’ont fait.
Lentement je commence à réaliser que peut-être que ça ne s’arrête pas. Pas quand on peut grandir avec ce qu’on fait. Alors tant que ça peut se produire, je signe pour 15 années de plus ; le cœur léger, la passion en bandoulière, et le Dieu de la Téléphagie comme seul berger.


Lire la suite »























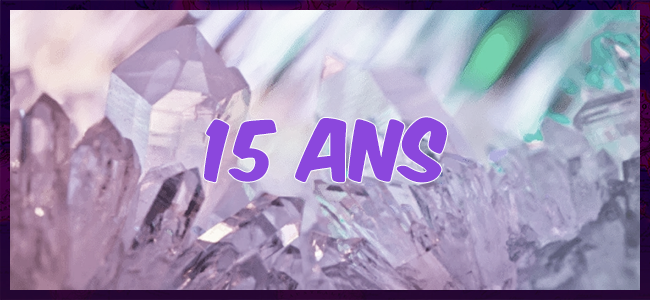



 Au passage, il faut aussi admirer l’extrême délicatesse des
Au passage, il faut aussi admirer l’extrême délicatesse des 



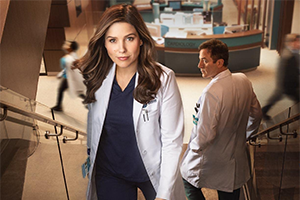 Ce n’est que le premier épisode, et la série est déjà complètement embourbée dans son « tout le monde peut avoir raison ». Good Sam est focalisée sur son but : réconcilier le père et la fille, ce qui ne serait pas la pire idée au monde (bien que peu surprenante), si au moins cet épisode ne versait pas dans le bothsiderism médical : chaque fois que Sam et son père s’affrontent sur un point particulier du cas médical du jour, quelqu’un va avoir raison, le prouver à l’autre, et faire lui concéder ses torts. Sauf que quand Griff a raison, c’est sur un point purement technique, parce qu’il a les connaissances médicales et l’expérience qui se prêtent à reconnaître des choses qui échappent à Sam et ses résidentes ; quand Sam a raison, c’est uniquement sur le plan humain (même si ses interactions empathiques avec le patient lui permettent de décrocher une information importante, elle est moins orientée sur l’angle médical). Du coup c’est facile que tout le monde ait raison quand on ne parle pas de la même chose ! Et puis surtout, ça donne l’impression que tous les épisodes à venir vont jouer à ce va-et-vient entre « non mais moi je sais » et « peut-être mais moi je suis gentille », et ça me lasse d’avance. C’est la fonction primaire d’un premier épisode (a fortiori pour une série médicale) de décrire la formule autour de laquelle la série va se construire par la suite ; même si on aura immanquablement droit à des variations, Good Sam pose les bases d’une dynamique paresseuse.
Ce n’est que le premier épisode, et la série est déjà complètement embourbée dans son « tout le monde peut avoir raison ». Good Sam est focalisée sur son but : réconcilier le père et la fille, ce qui ne serait pas la pire idée au monde (bien que peu surprenante), si au moins cet épisode ne versait pas dans le bothsiderism médical : chaque fois que Sam et son père s’affrontent sur un point particulier du cas médical du jour, quelqu’un va avoir raison, le prouver à l’autre, et faire lui concéder ses torts. Sauf que quand Griff a raison, c’est sur un point purement technique, parce qu’il a les connaissances médicales et l’expérience qui se prêtent à reconnaître des choses qui échappent à Sam et ses résidentes ; quand Sam a raison, c’est uniquement sur le plan humain (même si ses interactions empathiques avec le patient lui permettent de décrocher une information importante, elle est moins orientée sur l’angle médical). Du coup c’est facile que tout le monde ait raison quand on ne parle pas de la même chose ! Et puis surtout, ça donne l’impression que tous les épisodes à venir vont jouer à ce va-et-vient entre « non mais moi je sais » et « peut-être mais moi je suis gentille », et ça me lasse d’avance. C’est la fonction primaire d’un premier épisode (a fortiori pour une série médicale) de décrire la formule autour de laquelle la série va se construire par la suite ; même si on aura immanquablement droit à des variations, Good Sam pose les bases d’une dynamique paresseuse.


 Sauf que la Pham n’est pas ordinaire. Andrew et Camille sont des parents encore assez jeunes, au moins dans leur tête, et ont résolu de ne pas changer d’état d’esprit juste parce qu’elles vivent une vie qui pourrait sembler rangée. Tout est toujours une bonne excuse à être décontractée et à s’amuser, et c’est en particulier vrai pendant ce premier épisode, qui se déroule au cœur de l’été (…oui bon, c’est un choix de diffusion je suppose).
Sauf que la Pham n’est pas ordinaire. Andrew et Camille sont des parents encore assez jeunes, au moins dans leur tête, et ont résolu de ne pas changer d’état d’esprit juste parce qu’elles vivent une vie qui pourrait sembler rangée. Tout est toujours une bonne excuse à être décontractée et à s’amuser, et c’est en particulier vrai pendant ce premier épisode, qui se déroule au cœur de l’été (…oui bon, c’est un choix de diffusion je suppose). Le ton et la démarche de Son of a Critch ne pourraient être plus différentes. La série est l’adaptation de l’autobiographie du comédien Mark Critch (d’où le titre), qui officie aussi comme narrateur de la série. L’idée est pour lui de revenir sur son enfance, ou plus précisément le début de son adolescence, dans les années 80 en Terre-Neuve. En-dehors du fait qu’il s’agit d’une série inspirée par des personnes réelles, Son of a Critch rappelle beaucoup l’approche de Young Sheldon, et d’ailleurs il est assez difficile de se défaire de la comparaison pendant une bonne partie de l’épisode introductif.
Le ton et la démarche de Son of a Critch ne pourraient être plus différentes. La série est l’adaptation de l’autobiographie du comédien Mark Critch (d’où le titre), qui officie aussi comme narrateur de la série. L’idée est pour lui de revenir sur son enfance, ou plus précisément le début de son adolescence, dans les années 80 en Terre-Neuve. En-dehors du fait qu’il s’agit d’une série inspirée par des personnes réelles, Son of a Critch rappelle beaucoup l’approche de Young Sheldon, et d’ailleurs il est assez difficile de se défaire de la comparaison pendant une bonne partie de l’épisode introductif.







