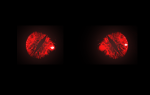« Vrai ? Faux ? L’important est que la légende existe. Le monde moderne a autant besoin de rêves que de certitudes ».
Je parie que vous aviez oublié ! Au début de l’année, je vous avais promis de regarder l’une des fictions évoquées dans le documentaire La saga des feuilletons et des séries, et mon dévolu s’est jeté sur Belphégor ou le fantôme du Louvre. Un classique absolu de la télévision française, tout naturellement ! Il était grand temps que je m’y mette (…oui, je vous avais laissé un indice dans ma review du documentaire).
Belphégor est une série mystérieuse, à bien des égards. D’abord parce qu’elle est, fondamentalement, un thriller : la question est posée très tôt de découvrir qui (ou quoi) peut bien être Belphégor, cette figure sombre qui hante les couloirs du musée du Louvre. Tous les personnages sont fascinés par cette question, quoique pour des motifs variables. Mais pour moi c’était aussi un mystère au sens où je n’en savais, en fait, pas grand’chose. En-dehors de quelques lectures générales, je ne savais pas précisément de quoi la série parlait, de son ton ou quoi que ce soit d’autre.
Il est important de noter que c’est le cas pour beaucoup de séries anciennes, qui, parce qu’elles font moins souvent l’objet de reviews détaillées récentes (et/ou que les reviews de jadis sont moins accessibles pour les téléphages modernes, au choix), ont cette sorte d’aura, renforcée par leur réputation de faire partie du patrimoine télévisuel. On sait que telle ou telle série est importante, mais on ne sait pas forcément en quoi. Comme si on se passait le mot de génération en génération, mais qu’une partie de la légende se perdait.
Tout était à découvrir dans ce visionnage de Belphégor. Imaginez ça : une série de 1965 pour laquelle, en dépit des décennies, je n’avais jamais souffert du moindre spoiler, ou presque (ce n’est que sur la fin que j’ai réalisé qu’en fait j’avais été spoilée par mon père quand j’étais petite, mais j’avais totalement oublié, le temps aidant).
Du coup je vais m’efforcer de vous faire ce même cadeau.

Je crois que ce que j’apprécie le plus dans Belphégor, c’est que la série comprend quelque chose d’essentiel pour la fiction dramatique : son but est avant tout d’étudier les personnages, leurs tourments et leurs motivations. Les retournements de situation inhérents à l’intrigue sont, et doivent rester, secondaires. Créer du suspense n’a pas de sens s’il s’agit uniquement de poser des questions et essayer de donner des frissons en avant de fournir les réponses. En revanche, rien n’a plus de valeur que d’observer comment les protagonistes se confrontent à ces mêmes questions, et trouvent leurs propres réponses ou au moins se positionnent quant aux réponses qu’ils trouvent.
Eh bien précisément, dans Belphégor, le mystère qui se cache derrière le fantôme du Louvre permet d’explorer comment chaque personne touchée de près ou de loin par cette affaire s’y trouve absorbée, et y transfère ses propres fantasmes et préoccupations.
« Il n’y a de mystérieux dans cette affaire que le pouvoir qu’elle a de faire délirer les meilleures cervelles », dira l’un d’entre eux à un moment. Non parce que la nature de Belphégor est prévisible, mais bien parce que chaque protagoniste trouve dans ce mystère l’occasion d’exprimer quelque chose d’intime, et donc en un sens d’un peu fou.
C’est par exemple le cas d’André Bellegarde, qu’on pourrait considérer comme le héros, au moins dans un premier temps. C’est un étudiant en physique-chimie venu de la Province et qui a priori n’a pas grand rapport avec le Louvre, mais il fait connaissance, dans le premier épisode, avec un vieillard fasciné par l’étrange. Je n’ai pas retenu son nom, alors surnommons-le Renard Mulder. Renard est un personnage totalement secondaire, qui est principalement là pour lancer l’intrigue, mais ce qu’il fait est central dans l’univers de Belphégor : il collectionne les coupures de presse relatant des faits étranges et inexpliqués. Il en a une armoire pleine, et pour lui, il n’existe pas de coïncidence… Renard pense que le monde est mystérieux, et que c’est simplement la preuve que notre compréhension en est limitée. André, entendant cela, voit sa curiosité piquée ! Or, Renard Mulder décède peu de temps après… à l’heure exacte à laquelle Belphégor a tué un gardien du Louvre. Coïncidence ? Non, André ne croît plus aux coïncidences, et il se met donc en quête d’une meilleure compréhension du mystère du Louvre.
Cette démarche n’est pas seulement celle d’André. Beaucoup des personnages qui vont par la suite nous être présentés sont tous fascinés par Belphégor, sans nécessairement que ce soit très rationnel. Plusieurs démontrent une passion pour la collection de données (sous diverses formes : les coupures de presse de Renard Mulder, mais aussi des documents anciens). Il y a une soif de connaissance dans Belphégor, et d’un type de connaissance qui reflète une curiosité du monde et de sa complexité, plutôt que de connaissances « formelles », telles qu’on peut les apprendre dans les livres ou sur les bancs de l’université. Par moments, ces personnages sonnent comme étrangement actuels, d’ailleurs, tant leur discours évoque les thèses conspirationnistes d’aujourd’hui, mais Belphégor présente cela plus comme une curiosité qui englobe l’étrange, que comme un déni de réalité.
Ecoutez, si vous cherchez du rationnel dans Belphégor, de toute façon vous êtes mal tombés ! Ce n’est pas le genre de la maison. En témoignent certaines articulations du récit, pour lesquelles les spectateurs sont grandement incités à suspendre leur incrédulité… plutôt que d’essayer de comprendre comment tel personnage a tiré telle conclusion ou, parfois, comment deux protagonistes en sont venus à se rencontrer. Non vraiment, faites comme eux, n’essayez pas trop de vous arrêter sur les détails, et contentez-vous de ce que Belphégor suscite de plus intangible.
L’ambiance de la série est d’ailleurs propice à cela. La série, qui est filmée en noir et blanc… comporte en fait beaucoup plus de noir que de blanc ! Une grande majorité des scènes sont (ou semblent, je ne suis vraiment pas experte) tournées de nuit, ou au moins en intérieur où la lumière reste étouffante. Belphégor affectionne les choses opaques, les plans où l’on distingue à peine ce qui se passe, les ombres qui se faufilent dans le noir. Moins il y a d’éclairages, plus la série s’en donne à cœur joie.
A certains moments, on ne sait pas vraiment ce qu’on regarde, on se fie aux sons (et encore), mais encore une fois, ce n’est pas le but du jeu que d’obtenir une vision nette des choses. Après tout, c’est de là que vient l’angoisse, et Belphégor se veut terrifiante. Evidemment en 2020, l’effet est différent, parce que tant de séries autrement plus explicitement effrayantes nous sont passées devant les yeux, mais dans une certaine mesure, ça se sent encore. Et même, cela s’apprécie.
Pourtant, cela va aussi au-delà. A travers les portraits qui se juxtaposent (car Belphégor est éminemment une série-chorale), il se dit aussi des choses précieuses. Sur la nature humaine, l’identité, et dans une moindre mesure l’amour. Les personnages de la série sont bavards et aiment converser sur tous les tons de ce qu’ils ont à l’esprit, et qui concerne souvent moins le fantôme du Louvre que leurs préoccupations existentielles. Ca devient parfois très, très abstrait !
Toutefois, la série porte également sur des soucis plus actuels… enfin, actuels pour les années 60. En un sens, Belphégor est une série de l’âge atomique ; en soi ce n’est pas surprenant vu son époque, mais sur le papier son thème en semblait à mille lieues. Pourtant, c’en est assez glaçant. Dans une série qui (en théorie) n’a rien à voir avec la course atomique, l’énergie et en particulier la bombe nucléaire sont mentionnées à plusieurs reprises, représentant le danger suprême, l’angoisse qui sous-tend les actions de plusieurs des personnages. Cela ne peut venir du matériau d’origine : le roman dont est issu Belphégor date de 1927 (et d’ailleurs une partie des tenants et aboutissants en a été changée). Ce spectre, si j’ose, plane au-dessus des têtes quand bien même les forces en présence ont peu à voir avec lui.
Et puis sans même parler de thèmes, il faut reconnaître à Belphégor un don pour écrire de belles interactions. Les personnages, même quand les faits les opposent, se retrouvent régulièrement à deviser de leurs pensées les plus intimes avec des étrangers. Dans ces scènes-là, les plans simples et l’absence (ou quasi-absence) de musique donne aux échanges quelque chose de furieusement beau, à l’instar des discussions entre le commissaire Ménardier (sûrement l’un de mes personnages favoris, d’ailleurs) et cette chère Lady Hodwin. Dans ces moments-là, il y a une tendresse incroyable qui émane des répliques, quand bien même cette tendresse est éphémère et devra s’effacer devant la tournure des événements. A ce titre, les deux premiers épisodes sont sûrement mes favoris, parce qu’on y trouve si peu d’action que ces scènes sont absolument partout.
Car oui ! Il y a de l’action dans Belphégor ! Surtout dans les deux derniers épisodes, une fois que beaucoup de révélations (mais pas toutes) ont été faites. Je ne sais pas, au juste, pourquoi cela m’a surprise. Peut-être parce que ses deux premiers épisodes étaient un peu plus bavards. Peut-être parce que j’ai des représentations erronnées des séries des années 60. Peut-être autre chose…
En fait, Belphégor n’était pas du tout la série à laquelle je m’attendais. Au juste, je ne saurais pas bien décrire la série que j’avais imaginée à sa place, mais il n’en reste pas moins que j’ai été surprise à de nombreuses reprises. Ne serait-ce que par son manque d’attachement pour son mystère : oui, l’identité de Belphégor n’est effectivement révélée qu’à la toute fin… mais à peu près toutes les autres informations nous sont délivrées à mi-parcours ! C’est dire si vraiment, le thriller n’était pas sa préoccupation fondamentale. Et vu qu’à moi, ce genre d’approche convient bien, j’étais d’autant mieux disposée à souffrir les errances amoureuses d’André… qui comme vous le savez sont rarement l’angle qui me fascine le plus dans une fiction.
Oh, oh ! Et je ne vous ai pas parlé de l’aspect carte postale ! Des dizaines de lieux de Paris et sa région figurent dans la série. Et en fait, je me suis aussi aperçue que je n’avais pas vu beaucoup de séries françaises des années 60 et, tenez-vous bien, j’ai dû googler certaines pratiques culturelles ! Genre le rideau noir devant l’immeuble de Renard Mulder lorsque les pompes funèbres viennent, ça j’avoue je savais pas que ça se faisait en France.
Vous l’aurez compris, il y aurait encore fort à dire. Hélas pour moi quand j’ai regardé la série, je n’ai pas pris de notes, et me voilà à essayer de rassembler mes pensées avant la fin de l’année.
Il faudra donc que vous ne comptiez que sur vous-mêmes (si ce n’est déjà fait) pour regarder Belphégor à votre tour, et vous pencher sur le mystère du Louvre…























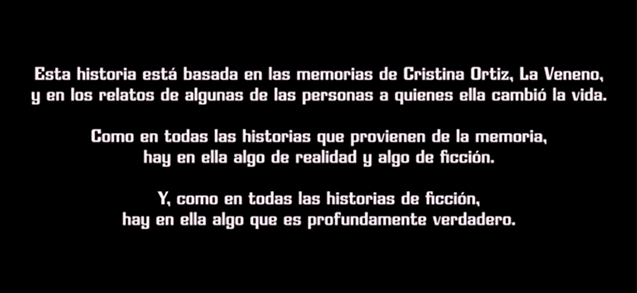 « Etant le fruit de souvenirs, cette histoire contient un peu de réalité et un peu de fiction.
« Etant le fruit de souvenirs, cette histoire contient un peu de réalité et un peu de fiction.


 Il n’est donc pas étonnant que j’aie complètement craqué : How to Ruin Christmas: The Wedding est ce qu’on fait de mieux en la matière. Sa façon de mélanger les codes de la romcom et de la fiction de Noël (même si très franchement, ça ne se sent vraiment que sur la fin que la série se déroule le 25 décembre) est délicieuse, et son attachement à dépeindre des relations réellement en danger de rupture, puis de forcer les personnages à se montrer authentiquement à leurs proches, est touchante. A cela encore faut-il ajouter les costumes (il y a des robes à se damner dans cette série), le décor idyllique (la série a été tournée en plein confinement intégral, pendant 3 semaines, dans un hôtel de luxe), la réalisation ou encore les dialogues. Tout est excellent dans cette production dont les standards ont visiblement été très élevés. Je suis, en outre, totalement tombée amoureuse de Busi Lurayi, qui brille dans tous les registres avec son incarnation de Tumi.
Il n’est donc pas étonnant que j’aie complètement craqué : How to Ruin Christmas: The Wedding est ce qu’on fait de mieux en la matière. Sa façon de mélanger les codes de la romcom et de la fiction de Noël (même si très franchement, ça ne se sent vraiment que sur la fin que la série se déroule le 25 décembre) est délicieuse, et son attachement à dépeindre des relations réellement en danger de rupture, puis de forcer les personnages à se montrer authentiquement à leurs proches, est touchante. A cela encore faut-il ajouter les costumes (il y a des robes à se damner dans cette série), le décor idyllique (la série a été tournée en plein confinement intégral, pendant 3 semaines, dans un hôtel de luxe), la réalisation ou encore les dialogues. Tout est excellent dans cette production dont les standards ont visiblement été très élevés. Je suis, en outre, totalement tombée amoureuse de Busi Lurayi, qui brille dans tous les registres avec son incarnation de Tumi.