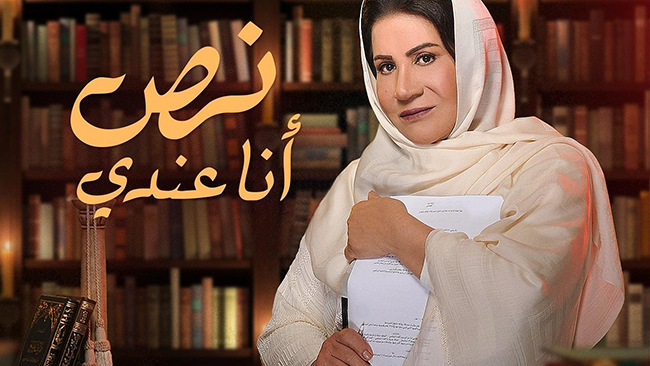Quand tout va mal, dites-vous qu’au moins vous ne vivez pas dans une série de science-fiction allemande. Parce que franchement, entre 8 Tage, Dark et maintenant SPIDES, euh, merci mais non merci. Bonjour l’ambiance.
Cela dit, c’est cool que la science-fiction se développe sur les petits écrans d’Allemagne où elle a longtemps eu du mal à exister, grâce à des plateformes de streaming et des chaînes du câble/satellite. En effet, on parle aujourd’hui de la toute première production originale de SyFy Deutschland.
Hélas on ne peut pas dire que SPIDES soit particulièrement fascinante. Il y a quelque chose dans cette production qui évoque plutôt les séries de science-fiction des années 90, ce qui serait formidable si ça ne faisait pas 20 ans qu’il y a eu des séries de science-fiction depuis. Bon et puis, la nostalgie des années 90, ça ne marche que sur les séries qui existaient dans les années 90, désolée mais c’est pas moi qui fais les règles.
Plus précisément, SPIDES évoque tout ce versant de la SF télévisée qui est né après The X-Files et a tenté, plus ou moins laborieusement, de foutre des conspirations et des aliens à toutes les sauces possibles en espérant qu’à un moment ça finisse par prendre. Spoiler : ça a rarement pris.

Dans le cas de SPIDES, il s’agit d’une conspiration dont on suppose qu’elle n’est pas gouvernementale, mais on a si peu d’éléments dans le premier épisode qu’en un sens ça n’a pas vraiment d’importance. Ce qu’on sait, c’est qu’un mystérieux personnage en fauteuil roulant est notre vilain méchant de service, pour lequel travaillent toutes sortes de scientifiques qui essaient désespérément de développer quelque chose de plus ou moins suspect.
Plutôt moins que plus. Dés le démarrage de cet épisode on sait que ce quelque chose est en rapport avec une drogue appelée « blis » (oui, ils sont sérieux), qui circule dans les clubs les plus en vue de Berlin. Cette drogue est consommée en se versant une goutte ou deux dans les yeux, suite à quoi ceux-ci deviennent brièvement lumineux et tout apparaît au consommateur avec un filtre violet (say no more, sign me up). Beaucoup de personnes qui prennent du blis oublient tout au petit matin. Tout le monde en raffole, même si on ne comprend pas trop pourquoi cette drogue serait plus mieux que n’importe quelle autre vu ses effets en apparence peu originaux… Qu’importe, chacun veut son blis, et le problème c’est que cela a entraîné une vague de disparitions à cause de la perte de conscience et/ou de mémoire occasionnée. Plus étrange encore, il semblerait que certains des jeunes disparus après la prise de blis finissent par réapparaître, mais différents. Différents en quoi ? Juste différents, arrêtez de poser des questions.
Tout cela serait éventuellement intéressant si SPIDES tentait de s’efforcer d’essayer d’avoir l’ombre d’un demi-soupçon de suspense, mais pas de chance, ce n’est pas du tout le choix opéré ici, puisque l’épisode s’est ouvert sur le laboratoire du fameux vilain méchant où l’on a assisté au réveil d’une jeune fille dans un étrange bassin violet. En sus, on a eu droit à de multiples conversations (soi-disant à mots couverts) qui ont rapidement démontré que le blis venait de cette organisation, et aidait à accomplir le plan diabolique de euh, écoutez je suis même pas sûre qu’il ait un nom.
Quant à la jeune fille qui s’est réveillée, Nora, elle devient ensuite la véritable héroïne du pilote de SPIDES ; on apprend qu’elle a sombré dans un coma de deux semaines après une prise de blis, mais qu’heureusement elle est revenue. Hormis une perte de mémoire, dont sa neurologiste assure qu’elle n’est pas dramatique, aucune séquelle n’est à relever. Vu qu’on sait très bien que le blis n’est pas une drogue comme les autres (rapport au laboratoire, pas aux filtres violets), que la neurologiste travaille pour le vilain méchant en fauteuil roulant, et tout le bazar, on va passer l’essentiel de l’épisode à regarder Nora se faire raconter toute son existence par ses parents, son petit frère, sa meilleure amie qui clairement en pince pour elle, son plan cul du moment même… Alors qu’on sait pertinemment que ce n’est pas la vérité, ou au moins pas toute la vérité, et qu’il se trame quelque chose d’autant plus dramatique pendant qu’elle consulte ses albums photos pendant des heures.
Il y a aussi des personnages très secondaires de flics qui ne semblent pas faire avancer beaucoup le schmilblick (Florence Kasumba interprète l’une d’entre elle, si ça peut aider), et qui ne sont probablement là que pour remplir le quota de volaille à la télévision.
Honnêtement, j’aimerais trouver un truc gentil à dire pour apporter un peu d’équilibre à cette review, mais je sèche un peu. Je, euh, trouve que le cast a un excellent accent anglais ?!
Ah oui, parce que ce que je n’ai pas précisé, c’est que la série est produite en Allemagne, mais en anglais. La raison est que le premier script de la série, écrit et pitché en allemand, a été refusé par les chaînes traditionnelles, officiellement parce que la SF n’est pas trop leur truc (je soupçonne que les diffuseurs allemands aient aussi flairé la grosse bouse…) et qu’ils ne voulaient pas investir dans une fiction de genre. Ce n’est qu’une fois NBCUniversal (qui détient la chaîne SyFy) intéressée que le script a été réécrit en anglais par Peter Hume, lequel a travaillé sur des séries comme Charmed, Mercy Point ou Olympus et a donc évincé les créateurs originaux de la série grâce à son CV. Cela a ensuite permis un tournage en anglais avec un cast international, dans l’espoir à terme de pouvoir fourguer la série bien au-delà de l’Allemagne…
Je ne veux pas avoir l’air d’apprendre leur métier aux gens, mais tout dans SPIDES relève de la recette d’une série à succès, on opposite day. D’ailleurs chaque fois que NBCUniversal se mêle de séries européennes, ça ne loupe pas, c’est toujours le pire du pire.
Dit comme ça, je sais que j’ai l’air de ne pas avoir apprécié le premier épisode de SPIDES, et de regretter cette heure de ma vie qu’on ne me rendra jamais.
…Pourquoi vous croyez que je l’ai dit comme ça ?