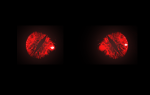Ces dernières années, on a vu un nombre croissant de séries s’intéresser, directement ou indirectement, à l’immigration. C’est normal et même un devoir pour la télévision que de s’emparer de sujets d’actualité ; à mon sens, c’est ce qui nous permet, protégés par la fiction, d’approcher des questions sensibles qui nous préoccupent par ailleurs, et d’y appliquer à raison d’une heure par semaine notre esprit et notre disponibilité émotionnelle. Il y a plusieurs façons de le faire et, si vous allez fouiner dans les tags, vous verrez que des séries comme Lampedusa, Taken Down, Party of Five, Beforeigners ou Carnival Row ont pratiqué des tons variés pour aborder le sujet.
Stateless, qui a démarré il y a quelques heures à la télévision publique australienne, a choisi quelque chose de différent encore.

La mini-série est supposée se passer dans un centre de détention pour demandeurs d’asile, mais ce n’est pas son propos central et d’ailleurs, seule la toute fin de ce premier épisode s’y déroule. On pourrait penser que c’est simplement la mise en place qui aura été longue, mais je ne le pense pas.
Je crois que Stateless a l’ambition d’en faire son décor. Pas son sujet.
Ce serait même une erreur de le croire. Si cet épisode inaugural passe un temps infini hors les murs de ce centre de détention, c’est parce qu’il veut présenter ses personnages, étudier leurs circonstances, et sonder leur âme. Pour mieux s’adresser à la nôtre.
Sofie Werner est celle qui occupe le plus de place ; cette hôtesse de l’air mène une existence assez banale mais étouffante, en particulier dans sa famille où elle se sent négligée, pour ne pas dire méprisée, par ses parents et notamment sa mère. Rien de ce que fait Sofie n’est jamais assez bien, et la jeune femme souffre de la comparaison avec sa sœur aînée, Margot, une femme mariée mère de deux enfants dont l’existence correspond beaucoup plus aux attentes de leurs parents, des immigrés européens assez vieux jeu. Les repas de famille sont insupportables pour Sofie, et le soir de Noël, alors qu’elle essuie une fois de plus les critiques condescendantes de sa mère, Sofie s’échappe par la fenêtre de la salle de bains. Elle finit la soirée à un gala organisé par GOPA, un studio de danse. Enfin… en apparence, car ce que GOPA propose est plutôt de l’ordre du développement personnel. Bien entendu, Sofie est en demande des discours d’amélioration tenus par Gordon et Pat, le couple à la tête de l’organisation. Ce qui échappe totalement à Sofie, mais pas aux spectateurs, c’est que GOPA est tout simplement une secte, et que l’addiction de la jeune femme à la reconnaissance va la piéger progressivement.
A côté de ça, Stateless raconte aussi d’autres histoires, et en particulier celle d’Ameer, un Afghan qui avec sa femme et leur deux filles, tente de rejoindre l’Australie. Pour eux, il est hors de question de retourner en Afghanistan, pour le bien de Mina et Sadi en particulier, mais la traversée n’est pas simple à organiser. Les réfugiés, ce n’est pas ça qui manque, et Ameer va s’en rendre compte en débarquant dans un hôtel délabré où des dizaines de personnes s’entassent pour attendre comme la Providence un bateau affrété par un passeur qui semble très organisé. Ce qui paraissait initialement être un plan relativement sûr devient pourtant stressant : l’attente du moment du départ (qui peut se faire à tout moment), le coût très élevé du voyage, la question de la sécurité de ses filles… La série ne veut pas raconter l’arrivée d’Ameer en Australie (et en cela, diffère de beaucoup de séries s’intéressant à des réfugiés), mais bien s’intéresser à ses préoccupations en amont, à la peur qui le tenaille pour lui-même et pour sa famille, et à la façon dont les événements vont tourner (encore plus) en sa défaveur.
Enfin et dans une moindre mesure, ce premier épisode met en place un autre personnage, celui de Cam, qui bosse dans une casse auto où il parvient à peine à joindre les deux bouts. Il ne mène pas une vie désagréable, mais ce n’est pas non plus la vie qu’il voudrait pour lui ou sa famille. Son ami Phil, surveillant dans un centre de demandeurs d’asile, lui, se fait des couilles en or, et Cam ne peut s’empêcher de jalouser ses finances. Finalement, un peu par hasard, il se retrouve à prendre un verre avec Phil et plusieurs de ses collègues ; ceux-ci l’encouragent alors à se reconvertir et rejoindre leurs rangs. Cam n’a jamais travaillé dans un endroit pareil, mais après six petites semaines de formation, il est envoyé sur le terrain pour s’occuper des réfugiés qui, chaque jour, franchissent les portes de l’établissement.
A noter que Stateless (et son poster promotionnel est assez transparent là-dessus) prévoit de présenter un quatrième personnage par la suite, mais pour le moment il n’en est pas question ici.
Stateless n’est donc pas vraiment intéressée par les débats autour de la demande d’asile. Je ne crois même pas que ça l’intéresse vraiment d’en détailler les mécanismes (et après tout c’est son droit, il y a effectivement d’autres séries pour ça, y compris à la télévision australienne puisqu’il y a eu Safe Harbour précédemment, co-écrite par l’autre scénariste de Stateless, Belinda Chayko). Il n’y a pas d’ambition politique ici.
A la place, Stateless se veut un pur human drama. Du genre qui vous atteint intimement. Une série qui vous parle d’émotions avant tout, qui explore votre vie intérieure sans vraiment vous demander l’autorisation, qui vous éreinte, mais qui le fait à but cathartique. Les personnages de Stateless sont désabusés et épuisés, quand commence la série ; et si à la fin de ce premier épisode, la plupart d’entre eux se portent encore bien mal, la mini-série promet aussi une forme de guérison. Comment en serait-il autrement, vu cette mise en place ? On ne sait pas encore quelle forme elle va prendre, on ne sait pas comment ces personnages (qui pour l’instant ne se sont jamais croisés) vont influencer les uns l’apaisement des autres, on ne sait pas ce qu’il adviendra de leurs circonstances précises. Mais on sent, on sait devant Stateless que la promesse, c’est celle d’une cicatrisation des plaies présentées comme si intenses dans ce premier épisode.
Honnêtement ? Je ne suis pas la dernière à me mettre devant une série tenant un propos politique, et traitant de sujets de société. Loin s’en faut. C’est d’ailleurs ce que je pensais être en train de faire quand j’ai lancé ce premier épisode !
Mais là, je suis plus que satisfaite du choix opéré par Stateless. Je n’en souhaiterais pas d’autre. Je veux que ces personnages souffrent mais qu’ensuite ils aillent mieux. Je veux que, par le pouvoir de la fiction, au lieu de mettre mon esprit et ma disponibilité émotionnelle au service d’un sujet d’actualité, déployer mon énergie à aller mieux avec eux. Tout ce que je veux, tous les dimanches pendant 6 semaines, ce n’est pas grand’chose, juste qu’on me broie proprement, puis qu’on me réanime.

























 Il y aurait encore long à dire sur la série, bien-sûr. Elle est riche de son propos, mais pas seulement. Il y aurait long à dire sur ses aspects les plus esthétiques, notamment ses choix musicaux (là encore, volontairement panafricains, puisqu’on trouve des titres d’artistes sud-africains mais aussi nigériens ou zambiens). Queen Sono a clairement plus de budget que Shadow, et ça se voit à l’œil nu. Il faudrait aussi mentionner sa représentation des corps noirs, et notamment les corps féminins ; Queen Sono n’est pas spécialement afro-féministe, pour autant que je sois capable d’en juger, mais elle est attentive à ce qu’elle montre de son héroïne, et des quelques autres personnages féminins de la série. Les coiffures et looks de Queen mais aussi de Miri semblent représentatifs de leur personnalité et leur engagement, par exemple. J’ajoute que Queen Sono est la deuxième série africaine de Netflix après Shadow à inclure un personnage handicapé moteur dans sa distribution… sur deux séries africaines de Netflix, donc (bon, encore interprété par un acteur valide, mais tout de même).
Il y aurait encore long à dire sur la série, bien-sûr. Elle est riche de son propos, mais pas seulement. Il y aurait long à dire sur ses aspects les plus esthétiques, notamment ses choix musicaux (là encore, volontairement panafricains, puisqu’on trouve des titres d’artistes sud-africains mais aussi nigériens ou zambiens). Queen Sono a clairement plus de budget que Shadow, et ça se voit à l’œil nu. Il faudrait aussi mentionner sa représentation des corps noirs, et notamment les corps féminins ; Queen Sono n’est pas spécialement afro-féministe, pour autant que je sois capable d’en juger, mais elle est attentive à ce qu’elle montre de son héroïne, et des quelques autres personnages féminins de la série. Les coiffures et looks de Queen mais aussi de Miri semblent représentatifs de leur personnalité et leur engagement, par exemple. J’ajoute que Queen Sono est la deuxième série africaine de Netflix après Shadow à inclure un personnage handicapé moteur dans sa distribution… sur deux séries africaines de Netflix, donc (bon, encore interprété par un acteur valide, mais tout de même).






 Je ne veux pas trop vous en dire, et le pilote lui-même est encore dans l’allusion à ce stade, après avoir passé beaucoup de temps à faire de l’exposition pure (et assez peu subtile… les dialogues sont poussifs au possible, notamment). Toutefois, il ne peut pas être un hasard que la plupart des personnages importants de la série soient racisés (Aliya5 et Bodhi2 sont noirs, il y a également deux acteurs asiatiques et une actrice hispanique au casting), que la voix de l’intelligence artificielle de l’archive soit celle d’un homme noir (…qui n’est nul autre que Snoop Dogg lui-même !), et que les formes d’art visibles ou audibles à l’intérieur de l’archive se réfèrent à la culture afro-américaine (et, à première vue du moins, aucune autre), qui semble totalement inconnue à ces adolescents.
Je ne veux pas trop vous en dire, et le pilote lui-même est encore dans l’allusion à ce stade, après avoir passé beaucoup de temps à faire de l’exposition pure (et assez peu subtile… les dialogues sont poussifs au possible, notamment). Toutefois, il ne peut pas être un hasard que la plupart des personnages importants de la série soient racisés (Aliya5 et Bodhi2 sont noirs, il y a également deux acteurs asiatiques et une actrice hispanique au casting), que la voix de l’intelligence artificielle de l’archive soit celle d’un homme noir (…qui n’est nul autre que Snoop Dogg lui-même !), et que les formes d’art visibles ou audibles à l’intérieur de l’archive se réfèrent à la culture afro-américaine (et, à première vue du moins, aucune autre), qui semble totalement inconnue à ces adolescents.