
Bien qu’étant ouverte à beaucoup de genres télévisuels (quoique pas tous), j’ai mes préférences, comme tout le monde. Or, il s’avère que les séries historiques comptent rarement parmi mes préférées. Et en toute sincérité, j’utilise le terme « rarement » à des fins purement diplomatiques ici…
Aussi, lorsqu’est apparue The Great, en 2020, je ne me suis pas pressée pour le regarder. Pour commencer, quitte à regarder une série sur des personnalités historiques russes, autant que ce soit une série russe… et on ne peut pas dire que les séries historiques russes manquent ! D’ailleurs, quelques mois plus tôt, j’avais déjà reviewé Ekaterina, estimant avoir rempli mon quota. En outre, ce que j’entendais de The Great ne me donnait pas envie : elle se destinait, volontairement, à être une série historique inexacte et absurde, ce qui ressemble à la description d’une série se voulant edgy à tout prix. Alors, vous me direz, aucune série historique n’est parfaitement exacte, et au moins l’absurdité volontaire est meilleure que celle, involontaire, de Catherine the Great que je n’avais pas aimée du tout… A ce titre, The Great arrivait après Dickinson, une autre interprétation moderne et un peu décalée d’une figure historique, et qui ne m’attirait pas beaucoup plus.
Toutes les conditions étaient réunies pour que The Great compte parmi les moindres de mes priorités. Alors je n’y ai plus vraiment pensé par la suite.
Trigger warning : maltraitance (et meurtre) d’enfants, tentative de suicide, viol, tentatives de viol, nécrophilie.
Jamais assez on ne le répètera : le timing compte à 712% dans l’appréciation d’une série. Découvrez-la au mauvais moment, au lieu d’attendre d’être dans de meilleures dispositions, et l’échec est assuré.
Il y a quelques jours, un extrait de la saison 2 de The Great est passé dans ma timeline sur Twitter. Convaincue que de toute façon je ne risquais pas le spoiler, vu que je n’avais aucune intention de me mettre devant la série, j’ai lancé le petit lecteur video… Je ne l’ai même pas laissé courir en entier : au bout de quelques secondes, le sourire aux lèvres, j’éprouvais déjà l’envie brûlante de regarder la série par moi-même. Résultat : j’ai englouti la première saison avec joie en l’espace de quelques jours, et m’apprête à vous en parler.
Parce que, eh bien, le « retard« , ça n’existe pas, et les séries n’ont pas de date de péremption, Dieu merci.

Dans The Great, la réalité historique n’est pas à prendre au sérieux, donc. D’ailleurs, cette première saison a pour tagline « An occasionally true story » (une histoire occasionnellement vraie), qui apparaît à titre de rappel juste avant le titre de chaque épisode. Alors disons simplement que dans cette version de la réalité semi-historique, la jeune Catherine est fiancée au jeune empereur de Russie, Peter III, et l’épouse le jour-même de son arrivée à sa cour.
Ce mariage royal constitue le rêve de toute jeune fille de son âge et de sa condition, puisqu’elle est fille d’une famille noble allemande, toute désargentée soit-elle (accessoirement, c’est aussi un rêve supposément envoyé par Dieu à l’archevêque Samsa qui conseille l’empereur, et que la série surnomme « Archie »). Catherine a la sensation de vivre un conte de fée… mais un conte de fée qui était, depuis le début, sa destinée, car elle est convaincue d’être vouée à de grandes choses. Elle arrive au palais impérial de Saint Petersbourg avec des étoiles dans les yeux, prête à tomber follement amoureuse de son royal mari qu’elle n’a, pourtant, jamais vu de sa vie. La désillusion ne tarde pas : non seulement Peter est un odieux personnage, mais toute la cour est dépravée, sale et brutale. Rien à voir avec la vision romanesque que la jeune fille de 19 ans se faisait de sa vie d’impératrice.
Les déconvenues se succèdent dans les heures qui suivent son arrivée, de la nuit de noces à la vie à la cour…
S’il y a bien quelque chose qu’établit The Great immédiatement, et sur quoi la série ne reviendra absolument pas, c’est que son héroïne-pas-encore-éponyme est d’un optimisme à toute épreuve, que rien ne viendra durablement ébranler. En fait, cette capacité de Catherine à s’adapter aux déceptions, et à recalibrer son attitude sans vraiment perdre de vue l’avenir radieux qu’elle voit pour elle-même, force l’admiration. Quand bien même parfois (…ok, souvent), cela ressemble à de l’aveuglement. Toutefois, sa confiance inébranlable en un destin magistral est fondatrice non seulement de la protagoniste elle-même, mais aussi de la quasi-totalité des intrigues la concernant… car très vite, réalisant que Peter n’est pas à la hauteur des enjeux de la Russie, elle envisage de prendre le pouvoir à sa place. Il faut dire qu’elle est plus cultivée que lui, et plus intéressée par les choses intellectuelles ; en outre, elle s’intéresse au sort des Russes, alors que l’empereur ne s’intéresse à qu’à lui-même. Et après tout, n’est-elle pas la personne qui succèderait à Peter s’il lui arrivait quelque chose ?
Il pourrait donc, hypothétiquement bien-sûr, lui arriver quelque chose… L’immense majorité de la saison repose sur les étapes par lesquelles la jeune impératrice va passer, parfois à son initiative et parfois malgré elle, pour accéder au trône.
Il va lui falloir des alliées : on ne prépare pas un coup d’Etat seule dans sa chambre, même quand on a lu tout Descartes.
Sa servante Marial s’impose, rapidement, comme une confidente de choix. Outre le fait qu’elle est la seule à considérer la jeune impératrice comme une personne, Marial a aussi l’avantage d’être une jeune femme noble dont la famille a été réduite à la servitude suite à une, euh… « incartade » du père. Marial a perdu sa condition, mais pas son esprit critique, et certainement pas sa langue acerbe ; son intelligence (certes peu aiguisée par ses conditions de vie) la rend immédiatement sympathique à Catherine. Elle n’a jamais pardonné à Peter de lui avoir retiré son statut pour être désormais traitée plus bas que terre par toute la cour, qui jadis constituait son entourage amical (ou supposément), ce qui la rend immédiatement à l’écoute en matière de plans pour renverser l’empereur. Idéalement dans la violence. Marial est un personnage parfait pour une série satirique comme The Great, parce qu’elle est constituée à 5% de sarcasme, à 90% de colère, et à 712% de rage incandescente ; elle offre quelques uns des meilleurs dialogues de la série et je l’aime d’amour. C’est aussi un contrepoids parfait à tout ce que peut être et représenter Catherine, tout en étant systématiquement traitée comme son égale par celle-ci.
Cette dernière découvre également un co-conspirateur en un membre du conseil de Peter : le comte Orlo, essentiellement considéré comme un gratte-papier risible par l’empereur, mais très lettré et rompu aux manigances de la cour. Il partage avec Catherine une passion pour les écrits des Lumières, et commence à caresser avec elle le rêve d’une Russie moderne et humaniste (…pour le 18e siècle). Hélas c’est aussi un pleutre de la pire espèce, constamment effrayé par sa propre ombre. Certes c’est cette anxiété permanente qui l’a maintenu en vie dans les couloirs du palais pendant si longtemps, mais c’est aussi, parfois, une gêne pour la jeune impératrice pleine d’élan. Orlo voudrait toujours faire les choses sans rien risquer ; c’est un peu compliqué quand on prépare un coup d’Etat.
Par la suite d’autres personnages vont se retrouver pris dans son sillage, comme Leo, l’amant qui lui est imposé par Peter et dont elle finit par tomber éperdument amoureuse, ou le bourru général Velementov, un pochtron notoire qui ne rêve que de réussir à coucher avec elle, mais qui, étant à la tête de l’armée russe, est d’une grande importance dans ses plans. La cour compte aussi toutes sortes de nobles, comme Georgina Dymova, la favorite de Peter ; Grigor Dymov, le mari de celle-ci et ami d’enfance ultra-loyal de l’empereur ; ou encore Elizabeth, la tante de l’empereur dont la série semble avoir décidé qu’elle n’avait jamais été impératrice, et qu’elle est uniquement une sorte de Phoebe Buffay de la cour de Russie.
The Great a l’infinie finesse de ne pas opposer Catherine à l’autre femme de pouvoir au palais de Saint Petersbourg : Georgina « George » Dymov. C’est la courtisane qui partage le plus souvent le lit du roi, et également la plus fine diplomate du palais jusqu’à l’arrivée de l’impératrice. The Great les fait interagir, les compare parfois, mais prend bien garde à ne pas faire de l’une la gentille et l’autre la méchante (préférant donner ce rôle antagoniste à Lady Svenska). Les choses sont plus compliquées, et leurs intérêts, nous rappelle souvent la série (surtout vers la fin de saison), pourraient très bien converger dans d’autres circonstances… si et seulement si. De la même façon, l’excentrique tante Elizabeth n’est jamais ni une menace ni une alliée ; elle fournit de précieux conseils, mais est imprévisible et sa loyauté semble chevillée à Peter. Sans parler, bien-sûr, de l’alliance avec Marial, sans qui Catherine se serait tranchée les veines dés le début, et qui est, plus que nulle autre, la personne qui souffle sur les braises de l’ambition de l’impératrice.
Les intérêts de ces femmes peuvent diverger, et c’est souvent le cas ; mais The Great établit aussi qu’elles peuvent, à l’occasion, trouver un terrain d’entente, au moins sur le fond ; ce qui est absolument impossible parmi les personnages masculins. Leur condition lie ces femmes entre elles, et elles partagent implicitement le secret de se savoir limitées par les hommes. Leurs désirs ne sont incompatibles qu’à cause de ce à quoi le patriarcat les réduit. J’ai hâte de voir comment la plupart de ces relations sont amenées à évoluer dans les saisons suivantes !

The Great ne manque pas d’occasions de s’esclaffer (pardon aux voisines, tout ça), que ce soit à cause des dialogues à bâtons rompus, de l’interprétation impertinente de son excellente distribution, des revirement de situation imprévisibles, ou des excès sans foi ni loi de la cour. Pourtant à ma grande surprise (une agréable surprise !), The Great est aussi incroyablement douée pour la dimension dramatique, voire tragique, de ses intrigues. Ses portraits fourmillent de nuances, qui n’ont pas toutes une utilité narrative, et sont parfois juste placées là pour donner plus de complexité à ses personnages. Le ton excessif de la série permet de sortir des clichés souvent rigides sur la vie des figures historiques, ainsi que d’autoriser des vices à s’exprimer au vu et au su de toutes. L’humanité de chacune est ainsi révélée dans toute sa dégueulasse beauté.
L’attitude sex positive d’Elizabeth, le goût d’Archie pour le masochisme (et sa profonde affection pour Marial, sa cousine), la torture que vit Grigor chaque fois que son épouse (avec laquelle il a pourtant un mariage sincèrement aimant par ailleurs) couche avec l’empereur, la nostalgie dévorante de Marial envers les maigres attaches qui la relient ne serait-ce que vaguement à sa condition passée, les inclinations polyamoureuses de Georgina qui se mêlent à ses obligations vis-à-vis de l’empereur et son amour pour Grigor, la façon dont Velementov est hanté par les milliers de soldats morts sous son commandement, les hésitations sincères d’Orlo qui est terrifié par le pouvoir autant qu’attiré par son usage, les efforts conscients que Leo produits pour vivre dans l’insouciance… Aucune protagoniste ne se limitera à sa propre caricature. Alors que dans une dramédie aussi souvent obscène, ce serait si facile ! Et ça aide bien que, toute trash qu’elle soit par moments, The Great compte des épisodes d’une heure.
Même Peter est humanisé de façon répétée. Les façons de le faire ne manquent pas, qu’il s’agisse de souligner son complexe d’Oedipe (d’autant plus intense que sa mère feue l’impératrice se révèle progressivement comme ayant été profondément maltraitante), son désir pathologique d’avoir l’approbation de son entourage (l’un découlant de l’autre), ou encore sa constance dans la médiocrité (dont il est semi-conscient de façon intermittente). Catherine ressent parfois un peu d’affection pour lui (ou de la pitié, ce qui est suffisamment proche vu les circonstances), et on ne saurait lui en vouloir : par certains égards, Peter est victime d’un hasard de naissance. Il n’a pas choisi d’être aussi puissant, et est terrifié à l’idée de n’être pas à la hauteur, ce qui… est vrai. Au fond de lui, il le sait, mais fait tout pour être conforté dans une illusion chancelante du contraire.
La relation du jeune couple pendant leur première année de mariage est fascinante parce que, bien que l’une et l’autre ne se disent clairement pas tout, leurs conversations sont d’une désarmante sincérité. L’impératrice et l’empereur sont, finalement, dans une situation où il n’y a aucune raison de se mentir (…à part, oui, évidemment, en matière de coup d’Etat !), puisqu’il n’y a aucun amour dans leur mariage. Leurs sentiments peuvent donc s’exprimer ouvertement… ou, disons, la plupart du temps. L’humour pince-sans-rire de la série fait vraiment merveille lorsqu’il s’agit de tracer les contours mouvants de ce mariage arrangé. D’autant que Peter rappelle à sa femme à quasiment chaque conversation combien il la méprise, faisant appel à la naïveté, l’émotivité ou l’inculture « naturelle » de Catherine parce que femme, quand nous la savons plus fine que lui. Il la sous-estime pour ce qu’il croit connaître d’elle ; elle le sous-estime pour ce qu’elle le voit faire. Au moins, le couple royal a cela en commun que chacun méprise l’autre ! Cela donne des échanges succulents, où chacune pense avoir le dessus sur l’autre.

Entre les scènes trash et les portraits détaillés, The Great garde même de la place pour un léger propos sur le progrès, et comment l’obtenir. Quand bien même c’est dans le contexte de l’empire russe.
Catherine est une idéaliste ; elle est lettrée et passionnée par « les idées », dont elle répète à l’envi qu’elle voudrait discuter plus encore. Il n’est pas toujours certain qu’elle soit aussi raffinée qu’elle le pense ; sa naïveté naturelle, pour commencer, est un obstacle à la compréhension de certaines complexités de la vie, et plus encore de certains cheminements avancés. La jeune femme a également une tendance nette à improviser plutôt que mesurer ses actions (à plusieurs reprises, Marial, qui a l’esprit pratique, va lui demander son plan pour accomplir quelque chose, ce à quoi, d’un air pénétrant, Catherine répondra : « cleverly« ). Elle a, en tout cas, la capacité à s’adapter à toute nouvelle information, et de l’appétit pour apprendre, c’est déjà ça… The Great tente régulièrement de lui faire abandonner une part de son innocence, mais la personnalité de Catherine fait que, même lorsqu’elle observe quelque chose qui la confond, qui la révolte ou qui la heurte, elle n’en tire que plus de conviction que les choses seraient différentes si elle accédait au pouvoir. Nul doute que les saisons ultérieures adresseront cette facette de son optimisme, mais pour le moment cela fait surtout passer la jeune impératrice pour une utopiste ayant construit des idées abstraites dans le confort de sa tour d’ivoire. En outre, ce qu’elle a lu semble l’avoir inspirée, mais elle ne comprend pas toujours l’esprit des auteurs qu’elle admire, comme le prouvera une conversation avec Voltaire en fin de saison. L’optimisme aveugle de Catherine, en somme, est aussi son plus grand défaut lorsqu’il s’agit d’accomplir quelque progrès tangible.
A l’inverse, Orlo est parfaitement conscient des limites du monde réel… c’est ce qui, généralement, le pousse à l’inaction. A sa façon, il est aussi un idéaliste, mais il s’est convaincu que si cet idéal immaculé ne pouvait être atteint, alors il saurait se contenter d’une petite victoire. Et pourtant, à cause de ce refus des compromis, il continue de négocier avec lui-même son engagement dans le progrès du pays. Son combat dans un épisode pour laisser au comte Rostov le droit de ne pas raser sa barbe est à la fois très optimiste, mais aussi limité par une certaine idée de ce qui est faisable, surtout… s’il tient à rester en vie. En un sens, Orlo aspire à trop de pureté dans son « militantisme », et tente même de freiner Catherine quand elle désire entreprendre des choses qui seraient un sacrifice moral à certains idéaux, pourvu d’obtenir le pouvoir qui ensuite la laisserait libre (…pense-t-elle) d’appliquer ses idées progressistes. En cours de saison, il se croit changé (un peu naïvement, ce que d’autres lui feront remarquer) par le fait qu’il a dû, dans des circonstances extrêmes, tuer un homme. Mais même si cela le hante, cela ne le change pas vraiment parce que, dans le fond, Orlo préfère le progrès quand il est abstrait.
Catherine et Orlo apparaissent comme deux faces de la même pièce, et j’ai aimé cet aspect du discours de The Great. Il m’a rappelé de loin en loin ce que j’avais aimé le plus dans Continuum, ce discours sur le changement politique auquel on aspire, et les moyens nécessaires pour l’obtenir.
Tout au long de la saison inaugurale de The Great, Catherine va être renvoyée à son statut de femme comme preuve de son incompétence (Peter la traite presque mot pour mot de « sac à foutre » dans le premier épisode). Elle est la seule femme de la cour de Russie à savoir lire, à son grand désespoir, et ne parvient pas vraiment à changer cela, étant bien entendu empêchée par les hommes. Elle voudrait avoir son mot à dire sur les affaires du pays, mais comme on l’a dit, elle est perpétuellement la risée de l’empereur à ce sujet (en outre, elle réalise en cours de saison qu’elle n’en connait pas assez sur la Russie pour se prononcer à de nombreux égards). Plusieurs personnages lui rappelleront que sa fonction consiste uniquement à porter un héritier (oui, si possible mâle) pour la lignée impériale, comme s’il était inconcevable qu’elle gouverne à la mort (…potentielle) de son époux. Et c’est sans parler des personnages masculins qui la désirent, parfois violemment (se référer aux trigger warnings)… Il ne fait aucun doute que Catherine est compétente pour régner, ou disons, il ne fait aucun doute qu’elle est plus compétente pour régner que Peter. Ce qu’elle ignore, elle est prête à travailler dur pour l’apprendre ; une qualité importante pour une dirigeante. Elle s’est en outre convaincue (…les graines ont en réalité été plantées par Marial) que le grand amour qu’elle est venue chercher en Russie est non pas Peter, mais la Russie elle-même, et a donc une motivation pour apprendre. A défaut d’être une impératrice parfaite, en tout cas, elle a du potentiel.
The Great insiste là-dessus autant que sur la façon dont, à l’inverse, Peter est un riche homme blanc à qui tout est toujours tombé tout cuit dans le bec. Ses insécurités sont causées, en grande partie, par le fait que son entourage ne lui fait pas confiance pour diriger le pays (c’était en particulier vrai de sa propre mère, et dans une moindre mesure de son père). Il s’est entouré d’une galerie de « yes men » qui doit rire à ses blagues pas drôles, avoir exactement le même goût que lui pour la luxure et l’excès de boisson, et qui n’a pas le droit de le contredire sans lui passer la brosse à reluire au préalable… La critique du boys’ club est transparente (dans ce contexte, il n’est pas tout-à-fait anecdotique qu’Orlo soit interprété par un acteur racisé, quand bien même The Great est l’une de ces séries historiques « post-raciales » où on fait mine de ne pas remarquer ces choses-là).
The Great joue en permanence sur cet imaginaire, et les parallèles indirects avec ce que ce progrès représente aujourd’hui. La série n’est pas nécessairement à prendre comme une métaphore, mais elle envisage un univers dans lequel, en tout cas, on peut entrevoir la possibilité d’un mieux, loin des structures étatiques (ou religieuses) qui maintiennent toujours les mêmes en place… et les autres à leur supposée place. C’est, malgré son cynisme récurrent, une série qui a l’air profondément inspirée comme cette Catherine qui pense qu’un mieux est possible, même dans un monde dépravé, sale et brutal. Quelque part, et malgré tout ça donne envie de ressentir le même enthousiasme optimiste…
Pour toutes ces raisons (et quelques autres, mais j’ai pitié), la découverte de The Great a été un pur régal… alors que rien ne m’y destinait. Je n’aurais probablement pas ressenti cet engouement à l’époque de son lancement, d’ailleurs ; le fait d’avoir envie de lancer une série est un facteur qui joue immensément dans son appréciation… par opposition au fait qu’elle soit là, récemment disponible, et que tout le monde en parle, ce qui n’est rien d’autre qu’une opportunité (au mieux). The Great est arrivée sur mon écran à un moment où j’avais envie de la recevoir ; ça a joué, j’en suis sûre, sur ma bonne humeur. Quoique House of Lies a également prouvé que je suis friande de trash, dés lors qu’il se dit quelque chose derrière.
L’autre bonne nouvelle c’est qu’en plus, alors que la troisième a déjà été commandée, une deuxième saison m’attend au chaud sur mon disque dur, sitôt que j’aurai fini de rédiger cette review. Donc, euh, si ça ne vous fait rien…


Lire la suite »
























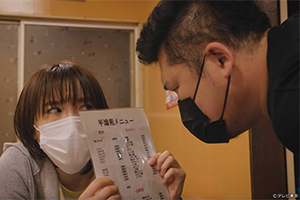 Si vraiment il s’agit d’une série romantique, je vais l’avoir mauvaise. A l’origine j’avais envie de voir Hinekure Onna no Bocchi Meshi, non seulement parce que c’est une « série d’appétit » (ce qui fait que de toute façon j’y aurais tôt ou tard jeté un oeil), mais surtout parce que c’est la première « série d’appétit » que je vois dans laquelle COVID semble exister. Plusieurs des photos utilisées par TV Tokyo pour promouvoir la série incluaient en effet le port du masque (comme ci-contre).
Si vraiment il s’agit d’une série romantique, je vais l’avoir mauvaise. A l’origine j’avais envie de voir Hinekure Onna no Bocchi Meshi, non seulement parce que c’est une « série d’appétit » (ce qui fait que de toute façon j’y aurais tôt ou tard jeté un oeil), mais surtout parce que c’est la première « série d’appétit » que je vois dans laquelle COVID semble exister. Plusieurs des photos utilisées par TV Tokyo pour promouvoir la série incluaient en effet le port du masque (comme ci-contre).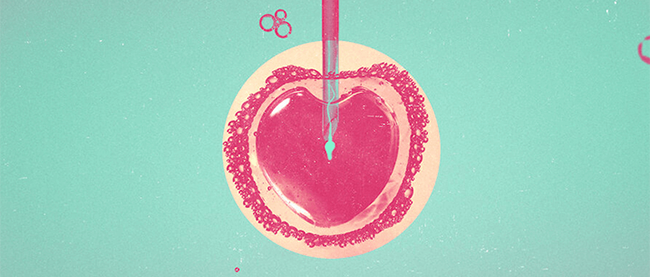









 Car après les déconvenues autour du poste de class captain, étrangement, au lieu de chercher une autre activité, Hannah se sent investie d’une mission : elle va fonder un club « Pride » dans son collège ! Elle a fait ses recherches, elle a préparé ses arguments, alors elle va voir le nouveau principal avec son idée ; d’abord dubitatif, il finit par se laisser convaincre et lui donne accès à une salle pour ses réunions hebdomadaires. Comme First Day a vraiment décidé de ne jamais rien donner à Hannah tout de suite, évidemment, au début le club est un échec ; mais l’adolescente persévère une fois de plus, trouve le courage d’aller démarcher des élèves de dernière année qui sont out, et les convainc de venir. Petit-à-petit, elle a la satisfaction de voir le « Pride » club grandir ; au début, les élèves viennent pour le goûter qu’elle prépare, avant de commencer à jouer à des jeux de société… et, finalement, de commencer à se parler. Sans que First Day ne transforme cela en un groupe de parole, la série détaille en tout cas tout le bien que cela fait à Hannah d’être parmi des personnes qui comprennent ce qui la rend anxieuse. Même si cela donne à Natalie et surtout Olivia l’impression d’être, à leur tour, exclues…
Car après les déconvenues autour du poste de class captain, étrangement, au lieu de chercher une autre activité, Hannah se sent investie d’une mission : elle va fonder un club « Pride » dans son collège ! Elle a fait ses recherches, elle a préparé ses arguments, alors elle va voir le nouveau principal avec son idée ; d’abord dubitatif, il finit par se laisser convaincre et lui donne accès à une salle pour ses réunions hebdomadaires. Comme First Day a vraiment décidé de ne jamais rien donner à Hannah tout de suite, évidemment, au début le club est un échec ; mais l’adolescente persévère une fois de plus, trouve le courage d’aller démarcher des élèves de dernière année qui sont out, et les convainc de venir. Petit-à-petit, elle a la satisfaction de voir le « Pride » club grandir ; au début, les élèves viennent pour le goûter qu’elle prépare, avant de commencer à jouer à des jeux de société… et, finalement, de commencer à se parler. Sans que First Day ne transforme cela en un groupe de parole, la série détaille en tout cas tout le bien que cela fait à Hannah d’être parmi des personnes qui comprennent ce qui la rend anxieuse. Même si cela donne à Natalie et surtout Olivia l’impression d’être, à leur tour, exclues…







