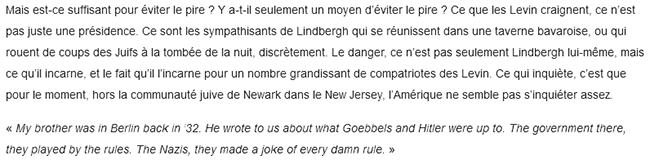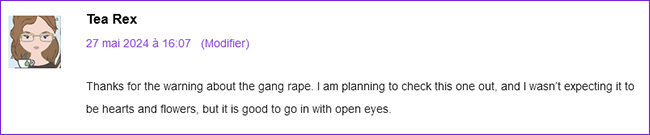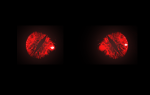J’aime People Watching d’amour (et ne le dis probablement pas assez souvent). Cette websérie animée, proposée par Cracked quand ce nom portait encore un peu d’importance popculturelle, compte parmi les videos de Youtube vers lesquelles je reviens le plus souvent. Elle fonctionne sur le principe d’une anthologie dont les personnages vont et viennent, et dont les thèmes oscillent entre fantastique, science-fiction, et dramédie réaliste observant la nature humaine. Un étonnant mélange.
En vrai, je ne sais pas complètement comment la décrire ; chaque épisode a son propre ton. Mais tous ont en commun de proposer une exploration de la condition humaine, quelque chose que nous oublions bien souvent partager et que la série place une insistance particulière à rappeler. Nous avons toutes en commun de ressentir différentes formes de solitude, à tout le moins… Mais il n’y a dans People Watching aucun défaitisme. Malgré ses sujets parfois douloureux, la série est pleine d’espoir. Un de ses sujets de prédilection consiste à nous rappeler que si nous expérimentons effectivement l’existence seules, nous avons au moins en commun de le faire ; aussi, si nous acceptions de partager avec vulnérabilité un peu de cette expérience, celle-ci serait moins difficile… Tout justement, People Watching exacerbe notre vulnérabilité pour nous rappeler à ce qui nous lie.
Hier soir je n’avais pas le moral, et comme souvent, mes pas m’ont guidée vers la playlist des deux saisons. Comme on ne peut pas parler politique aujourd’hui quand on a un lectorat, parlons donc de People Watching. Et, une fois n’est pas coutume, faisons-le épisode par épisode, puisqu’il n’y en a que 20. Ne vous inquiétez pas, l’avantage d’une anthologie c’est que vous pouvez vous permettre de donner la priorité à certains plus qu’à d’autres, selon leur résonance pour vous.

Note : les épisodes de la première saison apparaissent ci-dessous avec deux titres. Le premier est celui qui s’affiche dans les épisodes, vraisemblablement choisis par l’équipe artistique de la série dont son créateur Winston Rowntree ; l’autre qui est celui, plus clickbait, proposé par Cracked (et ce n’est même pas toujours le même sur le thumbnail non plus !). Si ça n’avait été que moi, je n’aurais utilisé que le premier, mais à des fins de clarté j’ai décidé d’indiquer à la fois le titre original, et celui des videos telles qu’intitulées dans la playlist.
Ah et aussi le lien vers chaque épisode se trouve dans l’image correspondante, comme ça, si vous avez envie, vous pouvez regarder un épisode qui vous attire.
 1×01 – Dating doesn’t work
1×01 – Dating doesn’t work
(ou « Why Speed Dating Is Terrible »)
Le concept : Le speed dating est l’occasion pour plusieurs protagonistes de se confronter au regard des autres.
Comment se présenter à l’autre dans le cadre amoureux ? Et surtout, comment le faire de façon à trouver quelque chose qui ait du sens, sans pour autant dévoiler ce que nous percevons comme nos pires insécurités et défauts ? Candy, pour qui ce n’est pas une première expérience, a décidé que ce soir-là, elle serait radicalement honnête ; cela implique d’aller droit au but et de ne pas chercher à plaire, mais plutôt à dire de but en blanc qui elle est et ce qu’elle veut. La démarche plait de façon très variable à ses interlocuteurs… A une autre table, Jeremy a également décidé d’opter pour l’honnêteté radicale, avec des résultats tout aussi mitigés pour trouver la perle rare ; mais à quoi bon tenter de plaire à tout le monde si c’est pour programmer un échec amoureux futur ?
L’épisode est un gigantesque montage d’extraits de conversations entre des hommes et des femmes qui tentent de trouver l’amour d’autrui, mais se confrontent à l’image qu’elles ont d’elles-mêmes d’abord. Toutefois, les propos de Candy et Jeremy ont tôt fait de se propager aux autres candidates à l’amour, qui tentent d’être un peu plus directes quant à leur personnalité ou leurs attentes. Et ça ne marche pas nécessairement, parce que ça implique de révéler des choses rebutantes… mais comme le dit Christianne : « Yeah, but if I wasn’t horrified to the core of my being right now this would be a huge moment for you, right ? Focus on that !« . L’épisode est une fable douce-amère sur la vulnérabilité, et notre hésitation à nous dévoiler alors même que nous cherchons à créer de l’intimité ; une valse hésitation qui n’est pas toujours couronnée de succès, mais qui, au moins, fait progresser le rapport à soi-même.
 1×02 – The non-religious confessional
1×02 – The non-religious confessional
(ou « Why Non Religious Confessionals Should Be a Thing »)
Le concept : Deux chercheurs ont installé un confessionnal non-religieux dans une rue passante.
Le principe est simple : vous pouvez dire tout ce que vous avez sur le coeur ; sans peur du jugement (d’autant que les chercheurs ne vous voient pas et ne peuvent vous identifier), et sans limite. Comme on s’y attend, après quelques banalités d’échauffement, progressivement les protagonistes commencent à dévoiler des choses personnelles. Ce n’est pas tout-à-fait de la thérapie, car les deux chercheurs se gardent bien d’intervenir au-delà du strict minimum, se bornant à prendre des notes pour quelques projet dont on n’a pas les détails. Mais cela suffit à des personnes comme Safra de traiter le siège inconfortable du confessionnal comme un divan de psy. Là encore, cet épisode est l’occasion d’en apprendre sur la vie intérieure des personnages ; mais à travers leur propos (et leur capacité à pratiquer un peu d’introspection en présence d’inconnues), on voit aussi lentement se dessiner un thème, celui de la solitude. Pas exactement la solitude physique, mais plutôt l’impression d’être seule à penser quelque chose. Le pire genre de solitude, peut-être. Mais… wait for it.
Tous les épisodes de People Watching sont bons ; celui-ci est cependant l’un de mes absolus préférés. Je n’ai jamais vu sa conclusion autrement que derrière un rideau de larmes. People Watching a cette capacité à se pencher sur le sort d’anonymes (on ne connaît pas toujours le nom des protagonistes, qui n’ont pas non plus droit à une exposition traditionnelle pendant la plupart des épisodes permettant de les situer comme on le fait pour d’autres personnages de fiction) pour parler de l’universalité de l’expérience humaine. Son mantra est que, peut-être que si nous acceptions de dévoiler nos pensées les plus intimes qui nous semblent honteuses, si nous acceptions de parler de notre solitude, alors ce sentiment d’isolement et de honte s’effacerait. Au moins en partie.
 1×03 – I Want To Believe
1×03 – I Want To Believe
(ou « Why Dating With Depression Is So (Bleeping) Hard »)
Le concept : suite à un match sur un site de rencontre, Safra a un premier rendez-vous avec Jeremy, pendant lequel la conversation s’oriente sur la dépression.
Peut-être est-ce suite à sa brève interaction avec Candy dans le premier épisode, ou peut-être pas ; toujours est-il que Safra tente d’être radicalement honnête à propos de sa santé mentale avec un parfait inconnu. Dites sur le ton de la plaisanterie ou sous couvert de références popculturelles, les réalités de sa vie parfois empêchée par un état dépressif paralysant apparaissent au grand jour. La discussion s’étire ; plus le temps passe, plus Safra en dévoile sur ses insécurité, s’excuse de ses mécanismes, minimise sa propre expérience : « I just tend to assume I’m just 100 times worse than everyone else« . Jeremy semble réceptif, ce qui autorise Safra à entrer toujours plus dans les détails. Elle explique bientôt qu’elle voit sa dépression comme un homme qui passe son temps à la dénigrer : Depression Guy. Est-ce que ce rendez-vous se passe bien ? On le dirait pendant un moment. Toutefois plus la soirée avance, plus Safra commence à douter.
Bon, au risque de me répéter, cet épisode est magistral (amusez-vous à compter les synonymes dont cet article va être truffé…). Entre ses références à The X-Files et ses métaphores alambiquées, Safra ne s’aperçoit pas qu’elle monopolise la conversation. Elle ne s’aperçoit pas de bien des choses. Le glissement est lent, quasi-imperceptible. Et d’une acuité dévastatrice.
 1×04 – Death is bullshit
1×04 – Death is bullshit
(ou « How Humans Will Eventually Beat Death »)
Le concept : Candy est fauchée par une voiture sur un passage piéton, ce qui la conduit à passer plusieurs mois à l’hôpital. L’épisode se déroule presqu’intégralement dans la chambre d’hôpital dans laquelle Candy fait sa convalescence, avec en voix-off une conversation entre elle et Jeremy.
Confrontée à ce qui a failli être sa propre mort, Candy explique à Jeremy que ce séjour long a été l’occasion pour elle de réfléchir, probablement pour la première fois, à ce que signifie de mourir. Et elle en a conclu que… ça n’a aucun sens ! C’est absurde ! La mort est absurde, et injuste, et nulle. Vraiment nulle. Au sens où elle réduit à néant tout l’univers contenu dans une personne. Dans sa démonstration, Candy ne peut pas s’empêcher d’exprimer de la colère, non pas vraiment à cause de l’accident lui-même, mais à cause de ce que l’accident l’a forcée à regarder en face. Pour elle, ç’a vraiment été une expérience spirituelle et intellectuelle (quoique, elle insiste : pas religieuse), qui a bousculé ses certitudes. Elle a acquis une nouvelle conviction…
Sans doute l’un des épisodes les plus abstraits et métaphysiques de People Watching, Death is bullshit se veut à la fois porteur d’espoir et mu par le désespoir. Dans son lit de convalescence, incapable de bouger (ou si peu), en raison de ses blessures, Candy ne dit rien, tandis que la conversation entre elle et Jeremy se déroule en fond sonore, nous laissant progressivement comprendre qu’elle a lieu après sa sortie de l’hôpital. Mais les images qui se déroulent dans cette chambre d’hôpital ne sont pas dénuées d’intérêt, ni de sens.L’épisode se finit, une fois encore, sur une conclusion parfaitement maîtrisée ; et il faut avouer que People Watching a un sens aiguisé du mot de la fin… car curieusement, peut-être que cette obsession pour la mort cache une autre préoccupation, moins abstraite celle-là.
 1×05 – F·R·I·E·N·D·Z·O·N·E
1×05 – F·R·I·E·N·D·Z·O·N·E
(ou « How ‘Friends’ Invented The Friendzone »)
Le concept : Une conversation entre Ted et Martha à propos de Friends se poursuit au fil des années, dépeignant leur relation platonique à travers les différentes phases de leur vie.
C’est un peu le négatif de l’épisode précédent : cette fois la conversation se tient devant nos yeux. La conversation commence au moment de leur rencontre (Martha portait un T-shirt Friends, bien que de façon ironique), mais après avoir un peu porté sur la série elle-même, la discussion s’oriente sur la portée de Friends, et notamment l’invention du concept de friendzone. « It’s the Robert Oppenheimer of all that Men’s Rights bullshit. Destroyer of worlds, Martha !« . A partir de là, Ted et Martha en viennent à parler de leur propre relation, qui jamais n’a été considérée comme autre chose qu’amicale… du moins, par elles. Leur entourage en revanche est convaincu qu’elles finiront ensemble à un moment ; ou qu’elles le devraient. Comme si une relation n’avait de valeur que dans la mesure où elle serait amoureuse ?
Tout cela se produit alors que nous pouvons voir les multiples expressions du lien amical qui les unit. Du moment de leur rencontre (Ted venait de se faire harceler par un bully) à des nuits à grignoter sur le perron de leurs immeubles respectifs, en passant par un séjour à l’hôpital, une soirée dans un bar, un déménagement, des vacances à la plage, une visite chez le dentiste, une soirée télé, une dédicace de livre sans public… bref, tous ces moments où une amitié se renforce et s’épanouit. Ted et Martha s’insurgent contre l’expression « que des amies », qui vient si facilement à la bouche d’autrui (…et parfois la leur), et qui dénigre une relation pourtant fondatrice dans leur existence. Un joli conte qui réchauffe le coeur, derrière les petites vannes de circonstance : on se sent bien dans la friendzone.
 1×06 – Your Favorite Artist
1×06 – Your Favorite Artist
(ou « Why Your Favorite Artist Doesn’t Want To Meet You »)
Le concept : Flossy donne un concert dans un petit bar ; l’épisode se focalise sur ses interactions avec le public.
Chanteuse-compositrice, Flossy se produit avec une simple guitare dans une toute petite salle. Le cadre est intimiste, mais son audience lui est dédiée. Au moment de l’intermède, toutefois, Flossy ne décolle pas les yeux de son portable, n’offrant au mieux que des réponses laconiques aux personnes enthousiastes qui l’approchent pour la complimenter. Selon leur tempérament, les protagonistes la rencontrant (Safra qui est pleine d’admiration, Jeremy qui voudrait parler de détails qui ont eu du sens pour lui émotionnellement, Glasses qui veut parler de musique, Centa qui tente de la draguer, deux fans venue du Michigan pour l’entendre ce soir…) réagissent différemment à la façon dont Flossy les ignore. On commence à réellement froncer les sourcils quand la même chose se produit avec une chercheuse de talents qui l’approche pour parler d’un éventuel contrat avec une maison de disques : comment Flossy peut-elle n’avoir pas au moins de l’intérêt pour cela ?
La question se pose, et bien-sûr, elle va avoir une réponse. Lentement. Vous commencez à le savoir maintenant, l’âme d’une personne met du temps à se dévoiler à nous, et People Watching est amatrice de conclusions qui déverrouillent notre compréhension. Flossy n’est venue ce soir-là que pour une raison… Your Favorite Artist est une invitation à se mettre à la place, de, eh bien, comme le dit le titre. Pourquoi devient-on artiste, dans le fond ?
 1×07 – Secret Losers Anonymous
1×07 – Secret Losers Anonymous
(ou « The One Self Help Group We’d Actually Join »)
Le concept : Un groupe de parole pour losers, de toute évidence.
Candy, Safra, Flossy, Ted et Jackson se retrouvent hebdomadairement aux réunions des SLA. Chacune est convaincue d’être la pire personne au monde, ce qui explique qu’elles n’ont pas d’amies. Mais chaque participante à la réunion a des raisons différentes de se considérer comme la pire des ratées, bien-sûr. En fait, c’est la seule chose qui les lie : leur impression commune d’avoir une vie pourrie, d’avoir tout foutu en l’air et de n’avoir qu’un avenir fait de solitude. Parfois une solitude physique, mais surtout une solitude émotionnelle induite par le fait que tout le monde les croit bien dans leur vie, impressionnantes peut-être même, et ne s’inquiète pas vraiment pour elles quand elles en auraient besoin. Au point que non seulement elles s’apitoient sur leur propre sort, mais elles commencent à se sentir hostiles (à des degrés divers) aux autres, parce que se sentant incomprises… « The number of times I’ve almost posted on Facebook : ‘does anyone want to come over and hang out’ is just too damn high« , se lamente Jackson.
Secret Losers Anonymous explore la mesure du succès : la façon dont celui-ci s’entend socialement n’est pas la façon dont elle se ressent. Une part de moi aimerait bien avoir les problèmes de Candy (dont le prénom de naissance est Joan, au passage) ou de Safra, mais je dois reconnaître qu’il m’est impossible de ne pas ressentir de la peine devant ce qui les hante. Souvent, People Watching parle de l’expérience humaine comme d’une abstraction intime, mais son objet de prédilection est quand même de situer cette expérience dans le contexte de notre société, de ses attentes, de ses tumultes. Même si les cinq membres de ce groupe de parole se définissent comme des losers isolées, personne n’est une île… C’est précisément ce tiraillement qui dérange : l’impression persistante que ce qui est perçu selon les codes d’une société peu intéressée par l’intime… est si loin de ce qui est. En attendant que la définition du succès soit révisée, en tout cas, il y aura toujours l’option de se plaindre de la solitude en groupe. Cela ne résout rien, mais ça fait temporairement du bien.
 1×08 – Writing to an old teacher
1×08 – Writing to an old teacher
(ou « The Importance of Reaching Out To Old Teachers »)
Le concept : Ted écrit à son professeur de lettres du lycée, Steve Dolan.
En mars 1999, Steve Dolan fait quelque chose d’anodin : il demande à Ted de rester après la classe, et le complimente sur un texte qu’il a produit pour le cours. Cet encouragement à écrire plus, et à essayer de se faire publier, même, est ce qui finira par motiver Ted à se lancer dans une carrière artistique. En mars 2016, pour la première fois depuis des lustres, Ted se retrouve par hasard à penser à M. Dolan et entreprend de lui envoyer un email. Mais la rédaction s’avère compliquée : on l’a entrevu dans les épisodes précédents, Ted n’est pas heureux, et le fait qu’il se considère comme un loser l’empêche de parler de sa vie sous quelque jour positif. Il voudrait remercier son ancien prof, mais en même il ne sait pas vraiment de quoi vu l’état de ses finances ou sa carrière. Sur un mode similaire à Death is bullshit, l’épisode déroule les différentes tentatives de rédiger cet email, avec en voix-off, les mots de Ted formule mais n’envoie jamais, tandis que sa vie se déroule en arrière-plan. Cette fois il n’y a donc pas de conversation, et pour cause : Ted se censure en prévision de la réaction qu’il imagine que Dolan aurait s’il voyait dans quel état est sa vie. Les mois passent, les situations se succèdent, et les brouillons aussi. Leur humeur oscille entre la sincérité et le cynisme, la gratitude et l’insolence. Et cela ne mérite jamais d’être envoyé.
Y aura-t-il un moment où la vie de Ted ne lui fera pas honte ? Où il s’autorisera à parler à quelqu’un du passé sans craindre d’être jugé ? Je ne connais que trop bien ce sentiment. Je me suis moi aussi censurée plusieurs fois au fil des années, « je lui répondrai quand ça ira mieux ». L’impression que ça ne va jamais mieux. Ne plus jamais répondre.
L’épisode s’arrête en mars 2017, quand Ted finit par enfin trouver les bons mots. N’est-ce pas, après tout, comme cela que tout avait commencé ?
Peut-être que je devrais écrire à Mme L…
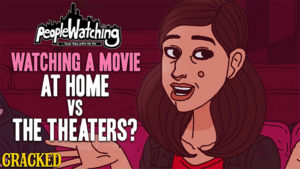 1×09 – In defense of talking during the movie
1×09 – In defense of talking during the movie
(ou « Watching A Movie At Home Vs The Theaters? »)
Le concept : pourquoi peut-on parler pendant le film quand on regarde la télé, mais pas au cinéma ?
Ted et Martha ont passé une soirée à regarder la télé, ce qui pour elles signifie parler à longueur de temps. Elles finissent par avoir l’idée d’aller au cinéma voisin pour assister à une séance au hasard et faire perdurer le plaisir de leur soirée. Sauf qu’une fois dans la salle, bien-sûr, leur conversation est accueillie par des signes plus ou moins discrets de se taire : on ne parle pas au cinéma. Mais pourquoi ? Communiquer est tout l’intérêt de faire quelque chose à plusieurs personnes, après tout. Encore plus quand le film (un blockbuster d’action) est archi-nul ! Dans la salle, plusieurs autres personnes auraient long à dire de ce qui se déroule à l’écran…
In defense of talking during the movie est un sujet plus léger que la moyenne pour People Watching, mais au milieu des répliques narquoises ou des références télévisuelles ou cinématographiques se cache une réflexion sur notre rapport à l’art… et de la solitude que cela peut engendrer. Bon, pas une solitude aussi grave que celle abordée dans d’autres épisodes, mais suffisamment pour nous donner l’impression de louper quelque chose quand on n’apprécie pas un film qui pourtant semble conçu pour plaire au plus grand nombre. Être incapable, de par les rites arbitraires organisés autour d’une projection sur grand écran, de partager nos impressions, points de vue, blagues et expériences, nous isole au beau milieu d’une séquence supposée être collective. N’est-ce pas un impératif qui nous transforme en consommatrices passives au lieu d’être des participantes pleines et entières de l’expérience artistique ? In defense of talking during the movie a même une proposition à faire pour rectifier le tir, mais pas avant de donner l’occasion à Ted, Martha, mais aussi Candy/Joan et Jackson qui assistaient à la même projection, de laisser libre cours à leur parole.
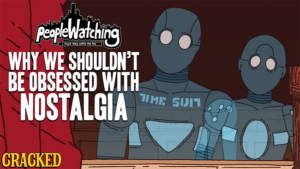 1×10 – Nostalgia
1×10 – Nostalgia
(ou « Why Nostalgia Is Total Bull »)
Le concept : si deux voyageuses du futur venaient observer notre époque, seraient-elles nostalgiques ?
Malgré tous les épisodes sur le speed dating ou le fait de parler (ou non) au cinéma, People Watching est aussi une série qui peut explorer des épisodes high concept comme celui-ci : l’idée d’une nostalgie future. Nostalgia commence par un extrait du spectacle de stand-up de Ted, qui parle de sa théorie selon laquelle les Millennials sont nostalgiques de leur enfance parce que les difficultés du présent leur sont insoutenables. Mais l’épisode s’étend bientôt à la quasi-totalité des autres protagonistes régulières de la série : Joan, Flossy, Safra, Jeremy, Jackson, Martha … toutes parlant de leur transition de l’enfance à l’âge adulte, et de la désillusion qui s’en suit. L’occasion de découvrir un peu du passé de plusieurs d’entre elles (la transition de Jeremy est littérale : on apprend ici qu’il est un homme trans), ou de revisiter certaines scènes d’épisodes antérieurs (comme le confessionnals non religieux, qui fait brièvement une apparition). Entre la désillusion d’avoir atteint l’âge adulte mais de ne pas se sentir adulte, de ne pas avoir trouvé le bonheur, de ne pas avoir trouvé de sens… et l’horrible sensation que le futur est encore plus bouché, les personnages expriment un sentiment typiquement Millennial (People Watching ne se cache pas, par ses références notamment, de se baser essentiellement sur cette tranche d’âge ; mais gageons que les Gen Z s’y retrouveront dans une certaine mesure aussi). Malgré les déceptions, toutefois, Nostalgia se veut plein d’espoir et se refuse à toute nostalgie ; l’épisode est à regarder d’urgence si aujourd’hui, spécialement aujourd’hui, vous avez besoin d’entendre des choses positives.
« I’d like to see a movie about how things do get better, and fear can’t change the world, because love is the only thing motivating enough to shape the future« . Cette phrase de Flossy fait écho à mes appels à plus d’utopies dans la fiction. Cette phrase fait du bien. Si vous ne devez voir qu’un épisode de People Watching ce weekend, que ce soit celui-là.
 2×01 – 2017
2×01 – 2017
Le concept : un documentaire sur l’année 2017 et son impact.
Bien que démarrant une nouvelle saison, 2017 est dans la parfaite continuité de Nostalgia, en cela qu’elle porte un regard sur le passé et l’avenir à la fois, et tente de nous inciter à une sorte de recul par avance. C’est l’épisode qui m’a incitée à me lancer dans un revisionnage de People Watching ce weekend, d’ailleurs, car de toute évidence il fait écho à une période politique et sociale complexe, et… oui, non, pardon, on avait dit qu’on parlait pas politique aujourd’hui. Interrogées par le documentariste, Glasses (dont on apprend qu’il s’appelle en fait Gregory), Jeremy, Safra, Joan, Ted, Martha, Jackson et Flossy se rémémorent cette année, et le tournant qu’elle a marqué aussi bien dans leurs attitudes individuelles que dans la conscience collective.
J’aime beaucoup cette idée d’imaginer le recul que j’aurai dans plusieurs mois ou années ; c’est quelque chose qui m’aide un peu dans mon anxiété (hélas ce n’est pas un remède magique qui guérit de l’anxiété dans sa globalité, mais cela résout certaines situations, en tout cas). Ici, bien-sûr, People Watching a trouvé un angle unique, qui nous est progressivement dévoilé et que donc je me garderai bien de gâcher. Si le regard sur 2017 est sans concession, il est aussi porteur d’espoir, notamment avec cette phrase de Joan : » 2017 seemed like the frigging end times but even the ideal future of Star Trek was built on the ashes of World War 3. Good people only run for office when things have been terrible » (Joan parle beaucoup de Star Trek dans cet épisode, et ce ne sera pas la dernière fois !).
 2×02 – Hanging Out With My Brother
2×02 – Hanging Out With My Brother
Le concept : Jackson se lance dans un débat métaphysique avec son frère Martin.
Au lieu de rejoindre ses potes, Jackson décide de rester chez lui pour regarder Star Wars: The Empire Strikes Back pour la trentième fois avec son frère. Sauf que cette fois-ci, Jackson est perturbé par la présence d’Obi Wan, qui revient sous la forme d’un fantôme pour guider Luke. Quelque chose dans ces scènes le bouleverse alors que ce n’était pas le cas avant. Il faut attendre, patiemment, que People Watching nous donne la clé, comme si souvent, avant de comprendre les enjeux émotionnels qui se trament sous la surface de cette intrigue. La soirée se poursuit donc, avec un dîner dans un diner ou un peu de lèche-vitrine chez un disquaire, et la conversation s’oriente sur la vie.
Qu’est-ce qu’être en vie ? Jackson a fait des schémas, et tout. Il a une théorie : être en vie, c’est être perçu comme étant en vie par autrui. Mais ce n’est pas si simple ! Les relations à distance, les amitiés par internet, et toutes sortes d’autres situations, font que ce que l’on perçoit de l’existence de quelqu’un et son existence réelle peuvent être très différentes. Sa théorie s’étend à d’autres choses que les personnes, comme l’art, par exemple : « if a comic strip or a movie feels so authentic that you react to it with the same emotions you’d react to real things with, is it real ?« . Mais s’il tient tant à sa théorie, c’est pour une bonne raison : il a besoin de se raccrocher à sa conclusion.
 2×03 – Homeless People Bother Me
2×03 – Homeless People Bother Me
Le concept : chaque jour en allant au boulot, Martha passe devant un sans-abri.
Les aperçus que l’on a eu de Martha au fil des épisodes nous ont montré quelqu’un au caractère bien trempé, mais parfois un peu insensible, quand bien même cela ne signifie pas qu’elle ne ressent rien. Mais The non-religious confessional nous a bien averties : elle a du mal à composer avec certaines difficultés lorsqu’elles sont rencontrées par autrui. Est-ce un défaut d’empathie ? Homeless People Bother Me s’attaque à cette question. Les interactions successives de Martha avec le SDF de son quartier, ainsi qu’une conversation à bâtons rompus sur le sujet avec Ted, forment l’essentiel de l’épisode.
La violence du propos de Martha, qui n’a d’égale que sa colère à croiser, jour après jour, quelqu’un qui demande si elle a de la monnaie. Il y a une part de préjugés, certainement, dans son attitude. Mais aussi une conscience qu’elle-même est au bord de la pauvreté, avec ses 60h/semaine dans un fast food qui ne la paie pas assez pour vivre. Homeless People Bother Me met progressivement Martha face à ses contradictions : justement, elle déteste son boulot dont elle se plaint à longueur de temps, alors pourquoi est-elle si outrée à l’idée que quelqu’un n’ait pas de job ? Peut-être parce que ce qui la dérange n’est pas le sans-abri, mais ce que l’existence d’un sans-abri sous-entend.
 2×04 – 37
2×04 – 37
Le concept : que seriez-vous capable de faire pour trouver votre meilleure amie ?
Le 12 octobre 2018 à 22h43, Safra engage la conversation avec une inconnue dans un bar. Mais 37 avance masqué : derrière cette conversation continue entre Safra et Mau (c’est le nom de l’inconnue) se cache en réalité un concept ingénieux et saisissant à la fois. Les deux jeunes femmes se lamentent sur l’état de leur vie amoureuse et plus largement sociale, sur le sentiment de solitude qui naît de ne pas rencontrer les bonnes personnes, et à la place, de devoir faire du tri dans des rencontres médiocres ou de se résigner à l’isolement. Le courant passe incroyablement bien et Safra, qui à l’origine n’était venue dans le bar que pour s’assurer de sortir de chez elle pendant une soirée de dépression, s’épanche de plus en plus quant à sa philosophie sur la vie, les relations, et le rôle de la chance. Il y a tant de facteurs qui entrent en compte ! Hey, vous connaissez Safra maintenant : quand elle commence à parler, on ne l’arrête plus.
Or, Mau n’a aucune envie de l’arrêter. Voilà donc Safra qui se lance dans une énumération de tous les facteurs qui font qu’une rencontre peut échouer, en gardant à l’esprit, bien-sûr, le facteur de la santé mentale : « The worst you feel about yourself, the more you need people, and the more you don’t want to bother them. It’s an impossible situation« . En cela, cette conversation renvoie pas mal à ce que l’on a appris de Safra et son rapport à la dépression dans I Want To Believe. Toutefois, 37 apporte une conclusion bien différente à cet exercice qui pouvait initialement sembler similaire.
 2×05 – 20s
2×05 – 20s
Le concept : un site web qui permet d’enregristrer un vlog par an pendant 10 ans.
People Watching est résolument plus intéressée par des épisodes high concept pendant cette deuxième saison, et 20s en est la démonstration. Sa collection d’extraits de videos donne une fois de plus la parole à toute une brochette de protagonistes quand elles avaient 20 ans : Joan, Martin, Safra, Flossy, Hat, Centa, Ted, Martha, et Janis. Face camera, elles s’expriment, d’abord incrédules plus de façon de plus en plus sincère, quant à leur expérience. Si le format évoque un peu celui de The non-religious confessional, ici le thème est donc spécifiquement avoir la vingtaine. C’est une histoire qui mêle désespoir, phase transitoire et espoir. 20s essaie de parler de la réalité à laquelle se confronte tout le monde, sous une forme ou une autre, au sortir de l’adolescence, avec honnêteté et réalisme, mais veut aussi raconter… eh bien, une fois de plus, ce que cela fait de voir tout cela avec le recul. « It’s not that you were incomplete, it’s that you were exactly as worthy as you are now, but without the ability to see it » : 20s veut donner cette capacité à quiconque regarde l’épisode. Et il n’y a pas de raison que ça ne s’applique qu’à une seule décennie de votre vie.
 2×06 – Prejudice
2×06 – Prejudice
Le concept : comment rencontrer quelqu’un qui ne s’arrête pas à ce qui est superficiellement perceptible ?
Juste au moment où Joan commençait en avoir ras le cul des sites de rencontre, et affirmait à Janis son désespoir face à la gent masculine, la voilà qui matche avec la personne parfaite. C’est inespéré ! Cette personne s’avère être Jeremy, avec lequel toute spectatrice de People Watching aura constaté la compatibilité depuis Dating doesn’t work. La raison pour laquelle Joan décide de contacter Jeremy plutôt que de l’ignorer comme tous les autres mecs qui ont aimé son profil, le facteur déterminant qui fait qu’elle veut lui donner une chance, c’est qu’il ne semble pas avoir de préjugés liés à son apparence. La plastique de rêve de Joan, en effet, a plus d’inconvénients que d’avantages lorsqu’il s’agit d’attirer des personnes sérieuses (« I’m basically just the fucking secretary for my own photograph« ), pour ne rien dire de sa carrière de travailleuse du sexe.
Voilà donc Joan et Jeremy à leur premier rendez-vous. Et ça se passe super bien. Ou bien ? L’intrigue de Prejudice commence du point de vue de Joan, puis s’intéresse à l’interaction des deux personnages pendant une soirée, mais s’oriente progressivement sur la perspective de Jeremy ; ce glissement permet de saisir des nuances qui n’apparaissaient pas forcément de prime abord. Et il y a une forme de solitude qui se crée pendant cette rencontre, un fossé d’autant plus douloureux que Joan et Jeremy sont compatibles mais ne peuvent pas totalement s’extraire de toutes sortes de mécanismes. Factors.
 2×07 – The Women Men Don’t See
2×07 – The Women Men Don’t See
Le concept : formation accélérée au féminisme.
Inspiré par ses interactions avec des inconnues sur OKCupid, Ted confesse à Martha qu’il est fasciné par les profils des femmes qu’il voit sur les sites de rencontre. En fait l’illumination est telle qu’il a décidé d’écrire un set de stand-up sur le sujet de ces « vraies femmes » si éloignées du portrait qui en est fait dans les médias. Martha ne partage pas son enthousiasme, pourtant, et essaie de lui expliquer qu’il ne voit pas la réalité de la condition féminine dans ces profils, mais une autre version toute aussi sélective. Parce que dans le fond, Ted ne voit que les femmes qui acceptent d’échanger avec lui, et ne les voit que par le prisme de ces interactions ; il y a donc toutes sortes de femmes qu’il ne voit pas, et qui représentent au moins autant cette « réalité » qui l’épate tant. Il y a, surtout, des interactions qui se passent sans lui, et auxquelles il n’a même jamais pensé.
The Women Men Don’t See voit Martha donner un cours accéléré de féminisme à son meilleur ami, tandis qu’elles passent la soirée ensemble, alors qu’elle-même ne se voit pas vraiment comme une féministe. Cela passe par donner des exemples de choses qui sont totalement passées sous le radar de Ted, des détails qui montrent que les femmes élaborent des stratagèmes pour survivre à la violence qui échappent (plus ou moins volontairement) aux hommes. Malgré ses explications, pourtant, Martha confesse qu’il y a des choses qu’elle ne révèlera jamais à Ted. Pour ces choses-là, peut-être qu’il devra observer par lui-même. S’il le peut.
 2×08 – The Museum of Alternate Realities
2×08 – The Museum of Alternate Realities
Le concept : que diriez-vous à celle que vous êtes dans une réalité alternative ?
En sortant du club de strip tease après le boulot, Joan s’aperçoit qu’il peut des trombes et se réfugie dans un bâtiment qu’elle n’avait jamais remarqué jusque là : ledit Musée des Réalités Alternatives. Après une brève visite (pleine de détails sur lesquels je vous conseille de mettre l’épisode en pause pour les apprécier), elle est conduite à l’attraction-phare du musée : une salle de réunion où il lui est possible de discuter avec celle qu’elle est dans trois autres réalités. Si le scepticisme est de rigueur au début (« Okay, THAT’S impossible !« / »But what if it wasn’t ?« ), la voilà donc à se comparer à trois femmes qui lui ressemblent, mais dont aucune n’est strip-teaseuse. Où a-t-elle merdé pour finir par échouer dans la darkest timeline ?
The Museum of Alternate Realities compte parmi mes épisodes de People Watching les plus revus au fil des années. Le concept, encore une fois, permet de gagner en perspective, mais cette fois non pas en introduisant le concept de recul temporel, mais contextuel. Le principe des roads not taken qui me fascine, et People Watching en fait ici une utilisation parfaite, notamment grâce aux cadres sur les murs qui permettent d’illustrer les propos et même les vies des protagonistes (c’est un procédé que la série utilise en réalité beaucoup sous une forme ou une autre, mais qui ici a vraiment atteint le sommet de son art). Dans un monde différent, Joan serait donc différente… mais à quel point ? Il s’avère que pas de beaucoup : si ses circonstances changent, en revanche sa personnalité et surtout ses valeurs restent les mêmes. C’est donc l’occasion pour Joan de se confronter à elle-même, au regard qu’elle porte sur elle-même et sa trajectoire, à son sentiment d’échec (abordé déjà dans Secret Losers Anonymous). The Museum of Alternate Realities est un exercice de pensée qui fait regretter qu’un tel musée n’existe pas ; l’entrée couterait certainement moins que des années de thérapie.
 2×09 – Love
2×09 – Love
Le concept : Janis a une façon bien à elle de décider qui mérite de louer son appartement.
C’est l’appart parfait : toutes les voisines sont des bibliothécaires, le loyer est minuscule, il n’y a aucun insecte ni animal indésirable… alors Janis veut donner les clés à quelqu’un qui mérite vraiment l’endroit. Elle explique à Joan que puisqu’il s’agit de l’appartement idéal pour une personne seule, elle attend des candidates à la location qu’elles lui prouvent qu’elles sont la personne la plus seule au monde. A mesure que l’épisode avance, d’autres personnes défilent devant Janis et tentent de lui prouver qu’elles sont isolées au dernier degré : Jeremy, Ted, Jackson, Flossy et finalement Gregory.
Au début, toutes se lancent dans une compétition acharnée pour prouver qu’elles ne sont pas dignes d’amour, et que cela les condamne à la solitude éternelle. Mais aucun de leurs arguments ne convainc Janis, qui ne se laisse pas avoir par quelques anecdotes tristes ou des banalités sur le célibat. Cela ne l’empêche nullement de continuer d’écouter leurs monologues, ou de les encourager à en dévoiler toujours plus avec des petites remarques. L’épisode adopte un tournant (plus tôt que la plupart des épisodes de la série, d’ailleurs) quand Janis renverse la vapeur : si vous êtes si seule que ça, alors vous êtes incapable d’amour, pas vrai ? Et là, c’est le choc. Personne ne veut admettre ne pas être capable d’aimer. Plusieurs s’insurgent : c’est leur capacité à aimer qui leur fait ressentir cette solitude. Ce revirement conduit les candidates à dévoiler des choses sur elles qui sortent de l’apitoiement, et les poussent dans une direction bien différente, pendant que Janis continue de siroter son verre de vin rouge… trouvera-t-elle la personne incapable d’amour qui mérite son appartement pour personne seule ?
 2×10 – Hope in Every Box
2×10 – Hope in Every Box
Le concept : .
Le dernier épisode de la série revient auprès de Safra, et lui donne l’occasion de parler de dépression. Mais aussi de futur. De surprises. De choix.
« Part of every day is hard to deal with, part of every year, and a huge part of my life is just trying to feel better before and after a setback for myself or for humanity. Trying to believe despite more bad days will definitely follow, trying to be happy with only being happy some of the time, trying to glimpse hope and the memorize what it looks like« .
D’espoir.






















 Par exemple ? Sur la Lune, on n’élève pas son propre enfant. Lorsqu’un bébé naît, il est retiré à ses parents immédiatement et confié à d’autres ; après quelques années, l’enfant est confié à encore une autre famille, et ainsi de suite jusqu’à l’âge adulte. Un enfant ne rencontre sa mère biologique (« mada« ) qu’au moment du décès de celle-ci, quand juste avant qu’elle ne s’éteigne il leur est donné une occasion de se découvrir, et de parler du chemin parcouru l’une sans l’autre. Cette pratique, explique Paul Sarno, est destinée à éviter que des familles ne se liguent les unes contres les autres, que des dynasties se forment autour du pouvoir (et cette leçon a été apprise dans le sang par la Lune il y a un siècle et demi, lors d’une première tentative de colonisation). Ce mode d’éducation rotatif, lui, s’assure que chaque membre de la communauté considère tout enfant comme le sien, avec bienveillance ; parce que techniquement tout enfant pourrait effectivement être le vôtre ! Sur la Lune, oeuvrer pour le bien commun prend aussi ses racines dans cette vision de la vie en communauté. Moonhaven se déroule alors que ces pratiques sociales sont ancrées depuis un siècle sur la Lune, et sont largement acceptées ; mais de toute évidence, l’implémentation sur Terre se prépare à être houleuse.
Par exemple ? Sur la Lune, on n’élève pas son propre enfant. Lorsqu’un bébé naît, il est retiré à ses parents immédiatement et confié à d’autres ; après quelques années, l’enfant est confié à encore une autre famille, et ainsi de suite jusqu’à l’âge adulte. Un enfant ne rencontre sa mère biologique (« mada« ) qu’au moment du décès de celle-ci, quand juste avant qu’elle ne s’éteigne il leur est donné une occasion de se découvrir, et de parler du chemin parcouru l’une sans l’autre. Cette pratique, explique Paul Sarno, est destinée à éviter que des familles ne se liguent les unes contres les autres, que des dynasties se forment autour du pouvoir (et cette leçon a été apprise dans le sang par la Lune il y a un siècle et demi, lors d’une première tentative de colonisation). Ce mode d’éducation rotatif, lui, s’assure que chaque membre de la communauté considère tout enfant comme le sien, avec bienveillance ; parce que techniquement tout enfant pourrait effectivement être le vôtre ! Sur la Lune, oeuvrer pour le bien commun prend aussi ses racines dans cette vision de la vie en communauté. Moonhaven se déroule alors que ces pratiques sociales sont ancrées depuis un siècle sur la Lune, et sont largement acceptées ; mais de toute évidence, l’implémentation sur Terre se prépare à être houleuse.